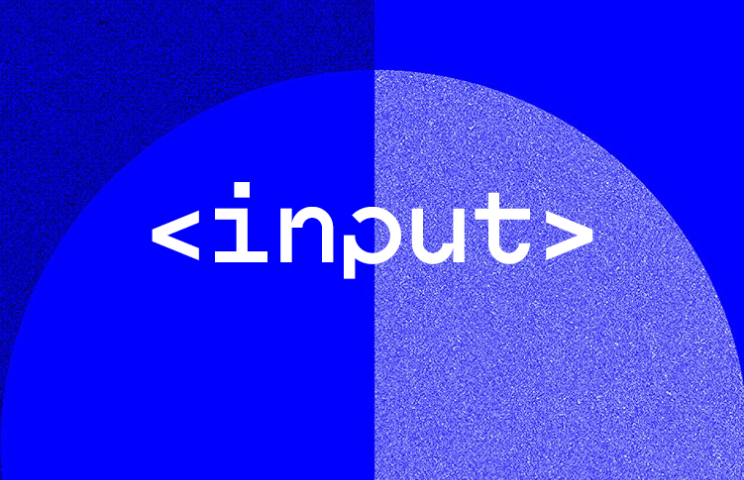Qui perd gagne, nouvelles technologies, laboratoire de la post modernité
Parler sur les nouvelles technologies, ouvre Michel Maffesoli, c’est se mettre à l’écoute d’un phénomène transversal, c’est-à-dire qui touche tous les domaines de la vie sociale.
Les nouvelles technologies, tout comme l’économie sur laquelle elles reposent, ont, à proprement parler, quelque chose de la contamination : elles se répandent dans notre quotidien et rejaillissent dans presque toutes nos activités, bien au-delà ce moment de quintessence qu’on aura pu leur connaître, donc aujourd’hui encore ; elles nous entourent sous la forme d’une multitude d’objets totems, scarifiés, appropriés et nôtres.
Or le fonctionnement des start-ups, ces entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies, allait, en de nombreux points, à l’encontre le l’économie classique, dont la prérogative est de gouverner une somme de bien et de valeurs, de maîtriser et de dompter l’échange et les objets. Les start-ups cherchaient à établir une économie « affectuelle », portée par la certitude d’un changement imminent dans les comportements de production et de consommation. Mais, en quelque sorte comme à l’image du mythe du Golem, rappelle Maffesoli, la création – la nouvelle économie – finit par s’effondrer sur ses créateurs : investisseurs, entrepreneurs et capitaux-risqueurs.
Jacques Reboul, ancien PDG de Siemens et Président de Bull France, expose alors les résultats d’une étude effectuée auprès des jeunes dans les entreprises qui gravitaient autour de la sphère Internet, dont il releve ces deux caractères :
1) Les jeunes y fonctionnent principalement en réseau, de sorte qu’importe énormément les collègues de travail.
2) Ils tendent à avoir une culture numérisée, c’est-à-dire à préférer les medias sous leur forme numérique (textes, musique, films*) plutôt qu’en objets.
Les cinq points, conclut Reboul, qui motivent un jeune à rester dans une entreprise sont, par ordre d’importance, le projet en lui-même, le charisme du dirigeant ou de l’entreprise, la proximité du manager, la tribu ou le groupe de référence au sein duquel il évolue dans l’entreprise et, finalement, l’argent.
Stéphane Hugon, chercheur au Ceaq et co-responsable du Groupe de Recherche sur les Technologies et le Quotidien, poursuit l’analyse : Si la net-économie a suscité tant d’intérêt, c’est probablement parce qu’elle s’est faite le lieu, le réceptacle expérimental de bon nombres d’images partagées. A la fois le lieu d’expression de valeurs en construction, en émergence : le rapport au travail, la distinction entre la vie privée et la vie personnelle, le thème de la responsabilité, de l’adulte, la synchronicité et la multiplicité parfois contradictoire, la responsabilité sociale. Le thème du virtuel, aussi, à la fois comme matériau, comme produit, comme valeur imaginaire, mais aussi comme perspectives, et enfin également, lieu de refonte des expertises. Mais, toujours, un lieu de dépense – de soi, d’argent.
Cette notion est reprise notamment par Georges Bataille, dans un petit texte sur la notion de dépense. Bataille rappelle que ce qui est intéressant avec le potlatch, c’est qu’il propose une production de valeurs non pas dans l’accumulation, mais dans la capacité de destruction de marchandises. « C’est la constitution d’une propriété positive de la perte – de laquelle découle ma noblesse, l’honneur, le rang dans la hiérarchie – qui donne à cette institution sa valeur significative. » Donc effectivement, qui perd gagne. D’autant que, ces marchandises sont sacrifiées lors de rituels de rencontres et d’ouvertures communautaires.
Ce dont témoigne, finalement, Michaël V. Dandrieux, chercheur au CEAQ et indépendant dans les nouvelles technologies : le rapport à la production elle-même, au sein de ces start-ups, favorisaient l’émergence de phénomènes nouveaux. Dans une entreprise, Dandrieux raconte comment de jeunes directeurs artistiques sympathisaient avec le personel de service, habitués à des rencontres matinales, lorsqu’on ne pouvait plus vider les poubelles sous les bureaux sans réveiller celui qui dormait.
Le monde réel, (res), le monde des choses, n’avait plus rien de commun avec la production des services virtuels (virtus) : sites Internet et autres applications logicielles. Une forte identité de pionniers du virtuel s’exprimait (dormir sous son bureau comme marque d’importance de la tâche à achever) mais, en même temps, une forme de vide étrange trahissait une inadéquation dans la manière de vivre sa propre production. En effet, le monde réel l’est parce qu’on y partage ses expériences avec autrui (e.g. la trace de nos trajets), mais le monde virtuel, comme la vertu, doit se lier à quelque chose pour exister (la force du bras n’est rien sans le bras), pas de virtuel sans réel. Or toute la communication en ligne se faisait sur l’échange du vide : chat, commerce en ligne, applications ludiques* Que ces expériences aient été réelles pour qui les faisait n’est pas à remettre en cause. Mais personne, de l’autre côté de la machine, ne pouvait en témoigner. En entreprises, les pionniers bâtissaient, finalement, des sites virtuels pour des clients virtuels et revendiquaient leur identité en criant très fort (trottinettes, lunettes de soleil en hiver, mailing lists érotico-ludiques*), mais dans une chambre sourde. L’être-ensemble et la légitimation du groupe par la construction d’identités fortes auraient-ils fait basculer les repères économiques de ceux qui, sûr d’eux, manipulaient des millions d’euros ?
Finalement : qui perd gagne ; ce que disait autrement Maffesoli : la contradiction en acte est le propre de la post-modernité.
Michaël V. Dandrieux