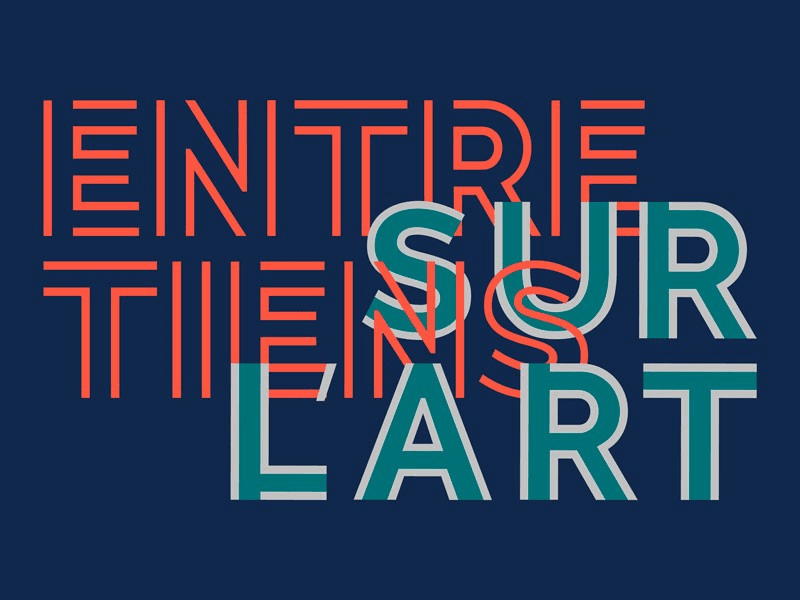Nicolas Moulin
Nicolas Moulin (né en 1970) investit le terrain de la science-fiction par le biais de la photographie, de la vidéo, de l’installation ou du son. En 2001, il présente Vider Paris, une vidéo projection de cinquante images de la capitale, retouchées avec Photoshop, dans lesquelles ne subsiste aucune trace de vie comme après un cataclysme.
Hautement anxiogène, l’art de Nicolas Moulin parle d’un monde contemporain désertique et glacial d’où l’humain est absent ou réduit à l’état de momie enfermée dans un sarcophage de béton.
À l’occasion de ces Entretiens sur l’art, Nicolas Moulin dialoguera avec Jean-Bernard Pouy, célèbre auteur de « polars », inventeur du personnage du Poulpe, apparu à la fin des années 1990, et à l’origine du renouveau de la littérature policière française.
C’est la première fois qu’ils s’entretiendront ensemble en public. Un événement à ne pas manquer puisque Jean-Bernard Pouy est l’oncle de Nicolas Moulin et que c’est à lui que le jeune artiste doit sa plongée dans l’univers de la science-fiction.
Textes lus par Jean-Bernard Pouy sur les images d’une des vidéos de Nicolas Moulin, Métane (1999), dont les séquences ont été tournées en Islande.
Jean-Bernard Pouy lit un extrait du texte « Rapport à Alpha du Centaure » de Norman Spinrad qui accompagne les photographies de Nicolas Moulin « Vider Paris » .
– Il lit ensuite un texte de John Brunner « A moi-même à l’occasion de mon vingt et unième siècle »
Catherine Francblin (CF) : Le premier texte que vous avez lu de Norman Spinrad accompagne les photographies de Nicolas Moulin dans le livre « Vider Paris » paru aux éditions Isthmes. Norman Spinrad est-il un auteur culte pour vous, Nicolas ?
Nicolas Moulin (NM) : Spinrad fait parti de mes auteurs préférés car il a écrit deux livres formidables : « Jack Baron et l’éternité » et « Rock machine ». Quand j’ai fait « Vider Paris », j’avais envie d’un texte de science-fiction. Avec Michel Baverey (Isthmes éditions), on l’a contacté par internet en lui envoyant des images de « Vider Paris » de manière anonyme. Le contact s’est établi et il a écrit quatre petites nouvelles, quatre interprétations bien à lui. J’avais envie d’un truc décalé qui ne soit pas illustratif. Ce sont quatre fictions sans narration précise.
CF : Nicolas Moulin (né en 1970), est un artiste pratiquant la vidéo, la photographie et l’installation. Il participe actuellement à l’exposition « Notre histoire » au Palais de Tokyo, avec une installation qu’on pourrait mettre en relation avec le titre de ce débat : la quête d’un paradis artificiel, le désir d’emprunter : « la voie du ciel ». Nicolas Moulin est surtout connu pour sa série de photos : « Vider Paris », un ensemble d’images de la capitale retouchées avec Photoshop, dans lesquelles ne subsiste aucune trace de vie comme après un cataclysme.
Nous avons démarré avec les images d’une de ses vidéos : « Métane » (1999), dont les séquences ont été tournées en Islande. Ce film présente une vision proche de celle qu’on aurait de la planète mars.
NM : C’est une sorte de western. Au-delà des mythes martiens que je laisse à d’autres, je m’intéresse au territoire, potentiellement colonisable par l’Amérique et surtout par la Chine. A mon avis, les Chinois seront les premiers sur mars. A l’époque, ça m’intéressait de filmer les déserts centraux de l’Islande qui, géologiquement, sont assez identiques et de les colorer avec des moyens techniques assez simples. C’est un film « low tech ». J’ai filmé de vieux écrans. En fait, c’est un faux film de transmission. Les bugs sont volontaires, le balayage aussi. Je voulais faire un travelling, un travail sur le paysage. A l’époque, je n’avais pas forcément l’idée de produire de la fiction mais celle de produire du simulacre, du faux.
C’est un moment de contemplation. Ce n’est pas forcément une réponse à l’actualité de Mars, c’est un prétexte pour parler de territoires inconnus. A l ‘époque, et c’est toujours le cas aujourd’hui, on cherchait de la vie sur Mars. On n’en trouvera certainement pas car sur Mars il y a bien de la vie, mais de la vie terrienne. En effet, ils ont envoyé des sondes qui ont été mal nettoyées et, sur ces sondes, il y avait des bactéries terriennes qui se sont reproduites et qui ont colonisé Mars.
Je me suis intéressé au mythe des nouveaux paysages que l’Amérique a exploité dans les westerns. Cette prospective sur Mars, c’est encore l’idée de conquérir de nouveaux territoires. J’étais fasciné par cette image orange de Mars qui ressemblait à des images sépia de westerns. J’ai choisi l’Islande car, comme Mars, l’Islande va devenir un parc d’attraction pour touristes milliardaires. Je pense que bientôt l’espace sera réservé aux milliardaires et non pas à la recherche.
JBP : A chaque fois qu’une sonde arrive dans un coin qui n’a jamais été atteint, ce sont des images très compréhensibles qui sont montrées. Elles peuvent être imaginées à l’avance par le terrien de base. Ce n’est pas la peine d’aller sur Mars pour trouver ce type d’images car avec un ou deux trucages et un peu de patience, on peut pratiquement faire la même chose. En revanche, je rêve qu’un jour une sonde envoie des images qui ne soient absolument pas perceptibles comme, par exemple, la traversée d’un nuage de méthane qui ferait que tout le monde penserait que sa télé est en panne. Ce qui est terrible, c’est ce qu’on voit de l’extérieur, du lointain, du mythe : des pierres oranges avec vaguement une montagne et un volcan éteint. Ce sont toujours des images proches de nous et il suffit peut-être d’aller les copier sur Terre. Ce n’est sans doute pas la peine d’aller si loin pour chercher des images qui sont scientifiquement d’une pauvreté époustouflante alors qu’on trouve les mêmes en Islande où le billet coûte quand même moins cher qu’une capsule pour aller sur Mars. En revanche, le jour où ils se permettront de passer des images non reconnaissables, invisibles et proprement scientifiques, ils ne le feront qu’une fois car les spectateurs ne s’y intéresseront pas. Est-ce que c’est déjà de la représentation ? Peut être.
CF : Vous avez dit que Nicolas lisait les textes que vous citiez en introduction vers 14-15 ans. Vous le connaissez bien car vous êtes son oncle. Vous êtes vous-même très intéressé par la science-fiction. Pourquoi avez-vous fait découvrir ces textes à Nicolas ?
JBP : C’est la circulation de la culture dans la famille.
CF : Vous êtes écrivain, vous avez notamment inventé le personnage du Poulpe et créé une célèbre collection autour de ce personnage. Vous êtes également à l’origine du renouveau du polar français et vous avez écrit des quantités de livres tirés à des centaines de milliers d’exemplaires.
JBP : A l’époque où j’ai découvert toute cette littérature anglo-saxonne de pointe, je n’écrivais pas du tout, j’ai commencé 15 ans après. Dans les années 1970, il y a eu un mouvement d’auteurs qui se détachait de la science-fiction et qui est maintenant revenu, c’est-à-dire « Darkvador », le « space opera » qui remplit maintenant les rayonnages avec les grandes sagas, les grands trucs religieux, l’héroïc fantasy. A l’époque, il y a une quinzaine d’années, il y a eu la « prospective fiction » groupée autour d’une collection (Robert Laffont) avec une quinzaine d’auteurs qui parlaient du futur en prenant acte de ce qui se passait au moment où cela se passait et qui essayaient d’imaginer ce que cela pouvait devenir d’une manière scientifique, idéologique ou morale. Ils ne se sont pas trompés. On a cité « Jack Baron et l’éternité » de Norman Spinrad qui est sur un sujet assez précis : la télévision. La télévision, dans les années 1960, ce n’était pas le sujet primordial et vaguement menaçant qu’il est devenu aujourd’hui. C’était un moyen qu’on considérait un peu de haut avec plein de gens ringards et des costumes à paillettes, on ne pouvait absolument pas imaginer l’importance mondiale et même politique que cela allait avoir. « Jack Baron et l’éternité » a décrit ce que nous voyons maintenant : la télé-réalité, l’état co-dirigé par les directeurs de télé.
C’est un don de prévision sur plus de 40 ans. John Brunner avec « Stand on Zanzibar » (1968), préfigure déjà ces problèmes de répartition, d’individualisme, de la fin des idéologies communautaires, de la néo-colonisation. Il prévoit tout avec exactitude comme le retour de l’utopie qu’on sent arriver.
CF : On parle pourtant de la mort des utopies.
JBP : Et bien non, je crois que les utopies arrivent. Tout cela était prévu, parfois de manière poétique. Brunner qui travaillait sur les poètes américains était plutôt quelqu’un de la « beat generation ». Il ne faut pas oublier, à l’époque, l’importance et l’influence des psychotropes qui donnaient un côté visionnaire.
Cette école de science-fiction s’est arrêtée et a été remplacée par le récit religieux et la création de mondes qui rêvent d’une entité qui sauverait ou détruirait le monde. Le « space opera » est également revenu avec un discours politique qui ressemble aux sagas islandaises du début du millénaire ou aux Chevaliers de la table ronde. On est entré dans la poésie et le lecteur moyen de science-fiction a été débarqué. Les autres lecteurs sont revenus aux vieilles lunes de la science fiction comme « Darkvador » qui est mon héros préféré.
CF : Nicolas, vous m’avez dit que vous ne liriez pas aujourd’hui la science-fiction de la même manière. Considérez-vous qu’il n’est plus possible de se projeter dans le futur ? Préférez-vous parler en terme de fiction plutôt que de science-fiction ?
NM : Je n’ai jamais eu envie que mon travail se limite au domaine de la science-fiction. Je n’ai pas envie de devenir le monsieur science-fiction français de l’art. La science-fiction c’est ma culture, c’est comme la musique électronique. J’écoutais les Kraftwerks à quatre ans, c’est un son qui m’a accompagné. Et puis il y a le fantasme de la guerre froide. A l’époque ce n’était pas un fantasme. J’ai grandi à la campagne dans un endroit assez joli, j’ai toujours pensé à partir de 7, 8 ans que cet endroit était à court terme condamné à disparaître dans un bombardement. Ce qui m’intéresse dans la science-fiction c’est la projection dans l’avenir d’un certain présent.
Mais, aujourd’hui, au moins en Europe, on va plus vite, la fin des utopies entraîne la fin des projections dans l’avenir. Dans les années 1970, c’était l’apogée des utopies en architecture avec des mouvements comme « Superstudio ». Ils spéculaient. J’aime bien la spéculation mais aujourd’hui, je pense que le monde est devenu très conservateur et n’a pas forcément envie de spéculer sur son avenir. En Asie, les gens ne spéculent pas mais construisent des tours de 600 mètres. A Paris, on fait des lois pour ne pas construire au-dessus de 37 mètres. Tout le monde est catastrophé par le danger de la Chine mais, en fait, c’est le déroulement normal des choses. Ces gens-là ne vivent pas dans la même sphère temporelle que nous. On peut se tourner aujourd’hui vers l’Asie pour voir notre futur proche. Avec les nouvelles technologies, il suffit d’attendre un ou deux mois et on voit notre futur.
Dans les années 1950, on imaginait les robots comme dans les années 1930, c’était la suite de « Métropolis ». Puis l’industrie de l’électroménager est née et on s’est aperçu que c’était une image kitsch. Ce qui était sérieux c’était le grille-pain, l’aspirateur, la machine à laver. Aujourd’hui, en Asie, des compagnies font des recherches pour sortir le premier androïde qui fera tout à la main. On est en train de faire des robots qui vont faire la vaisselle à la main. C’est un retournement très intéressant. Autrefois, les villes sur Mars, on les imaginait avec des grands dômes ultra-technologiques. Je pense que s’il y a des villes sur Mars un jour, il y aura des dômes avec la butte Montmartre en dessous. C’est normal, c’est le parc d’attraction.
Il y a un autre truc qui m’intéresse dans la science-fiction ce sont les prophéties qui pourraient devenir des programmes politiques. Quand on lit « L’apocalypse », on a l’impression que des personnes comme Bush en font un programme politique. A la fin, après avoir tout ravagé par le feu, le monde aura un gazon impeccable avec des maison Bouygues alignées régulièrement et des centres commerciaux. Ce sera la cité d’or.
JBP : Je pense au personnage du peintre dans « Quai des Brumes » quand il dit : « Quand je peins un nageur, je peins un noyé ». Pour Nicolas, on pourrait dire : « Quand je peins un nageur, je peins un mec qui commence à mal respirer ».
J’ai été frappé par son oeuvre présentée au Palais de Tokyo : un ciel avec des traces de gaz des avions. C’est très zen, contemplatif et en même temps, on ne peut pas s’empêcher de penser : c’est un B52 qui passe et il est chargé. Le calme, la réflexion, la contemplation et même ce côté impressionniste sont gonflés par le danger. C’est terrible.
CF : Parlez-nous un peu de l’évolution de votre travail.
NM : Je ne vous présente pas mon travail chronologiquement. Je vais commencer par « Novomond », ma première tentative de faire des images de science-fiction. J’ai commencé ce travail il y a longtemps. J’aimais bien le paradoxe d’une photographie qui représenterait un futur alors que la photographie est toujours la trace d’un passé. J’ai fabriqué des paysages urbains en usant de distorsion qui pouvaient représenter un monde futur. C’est une tentative de présenter un monde désincarné. Ce sont des photographies prises à la lumière artificielle en plein jour ce qui explique le côté bleu.
Mon idée était de présenter une énigme. Une présentation par diapositive avec un son de Bertrand Lamarche sans en donner la source. Je voulais que les gens essaient, à leur manière, de trouver une provenance à ces images. J’ai remarqué que c’était assez générationnel. Certains se demandaient où c’était, ce que c’était et certains pensaient simplement qu’il s’agissait d’images de synthèse. C’est un travail issu d’une petite gymnastique très simple. J’étais plaqué aux façades des immeubles et je prenais en photographie le ciel. C’est une distorsion de l’espace qui transforme les verticales en horizontales. L’installation comprend 80 images et se trouve au musée d’art contemporain de Vitry.
Je fais toujours régulièrement ce type de photographies quand je trouve des images intéressantes. Ce travail est inspiré du cinéma comme le premier film de Georges Lukas « THX 1138 », certains livres de Balard. J’avais envie de représenter le fantasme d’une planète bétonnée à 100%. L’idée était de fabriquer une fiction vide de tout habitant, une manière de transformer le spectateur en narrateur. J’ai commencé ce travail en 1996 et je l’ai arrêté en 2003.
Plus tard, j’ai fait « Vider Paris » qui est un peu mon tube. C’était une autre tentative. Pour le coup, ce sont vraiment des images de synthèse. J’ai passé pas mal de temps à photographier Paris, puis ensuite, à l’aide de Photoshop, j’ai collé des murs jusqu’au deuxième étage. J’ai enlevé systématiquement toute trace de vie, tout mobilier urbain, voiture, etc. C’était un travail besogneux mais j’avais envie que ça ait l’air simple. J’ai fait une projection de 50 images avec un son électronique qui a été réalisé par un ami. Dans ce travail, je n’avais pas du tout envie de parler d’un futur de Paris. La science-fiction est ici évidente, car on sait bien que cela ne s’est jamais passé donc c’est probablement l’image d’un futur. J’avais plutôt envie de parler de fantasme.
J’ai choisi d’utiliser des visions de Paris qui sont assez génériques, c’est-à-dire le Paris du Baron Haussmann. C’est une vision de Paris que partagent tous les pays. J’ai vidé Paris pendant des années, cela m’a pris à peu près 20 heures de travail par image.
CF : Cette série est très connue, très frappante, angoissante mais n’est-ce pas parce qu’on reconnaît les lieux ? Est-ce que vous pourriez faire la même chose avec « Vider Chamonix » ?
NM : Oui je pense que j’aurais pu l’appliquer. Si j’avais été londonien, j’aurais vidé Londres. J’aurais pu vider n’importe quelle ville. Ce qui m’intéressait, c’était de montrer le squelette d’une ville dont la fonction première serait dépassée.
CF : Le fait qu’on reconnaisse les lieux, que cela ait l’air réel est d’autant plus troublant.
NM : Je l’ai montré dans d’autres pays que la France et je pense que l’effet est le même. A partir d’un certain nombre d’images, les codes sont très simples et je pense qu’on peut tout à fait imaginer n’importe quelle ville murée jusqu’au deuxième étage. Mon choix de murer jusqu’au deuxième étage s’explique simplement : si on mure uniquement le premier étage, on peut encore entrer. J’ai agi très logiquement comme une entreprise de BTP.
Je présente ce travail comme une espèce d’errance, je n’ai pas du tout envie d’imposer un itinéraire. J’ai évité les endroits pittoresques de Paris parce que je n’avais pas forcément envie que les gens les identifient. Je préférais que le spectateur soit plus face à un phénomène urbain qu’à son quotidien.
CF : Ce qui est intéressant dans le texte de Spinrad, c’est lorsqu’il considère la ville comme une oeuvre d’art, une oeuvre d’artiste qui serait conservée telle quelle.
NM : Quand je l’ai fait, j’ai imaginé un monde où tout le monde serait connecté à internet et dont plus personne ne sortirait. Potentiellement, dans l’avenir, nos villes seront vides. On va vivre de plus en plus dans une réalité virtuelle. On va découvrir un monde où, petit à petit, l’extérieur va se vider. Moi, c’était ma fiction personnelle. J’ai essayé d’enlever tout repère pour les gens. Encore une fois, c’est tout simplement un travail sur le paysage fantasmé.
Dans le même type de travail, un travail plus récent « Avia fluenza » que j’ai montré aux Galeries Lafayette. « Avia fluenza » est inspiré de mouvements d’architectes intéressants : « Superstudio », les radicaux italiens ou bien encore Claude Parant avec « Architecture principe ». A l’époque, on a spéculé sur des projets mégalos, immenses. Il suffit de regarder les projets de « Superstudio » qui sont devenus de la pure spéculation. Ces architectes n’avaient pas l’intention de construire quoi que ce soit. Je me suis servi de leurs travaux pour commencer une série qui s’appelle « Avia fluenza ». C’est un travail de collage car je tiens toujours à fonctionner de manière assez simple. On ne peut pas échapper au collage, à la peinture, à la photographie. Ces collages consistent tout simplement à prendre un paysage et un élément d’architecture en le déformant un peu pour créer un monde faussement archéologique.
L’idée de frontières m’intéresse. On a vécu longtemps dans un monde partagé en deux blocs séparés par des murs. Je pense que c’est une idée qui va disparaître puis réapparaître. Le monde dans lequel on va vivre va être divisé en différentes zones. Je me suis amusé à spéculer sur cette idée de zone.
J’avais envie de parler de stéréotypes parce qu’aujourd’hui, l’image a une histoire assez longue. L’idée de faire des nouvelles images me paraît assez vaine. Ce qui est intéressant c’est d’essayer de reprendre des stéréotypes pour toucher l’inconscient collectif et faire des images que les gens ont l’impression d’avoir déjà vues. C’était ma tentative pour ce travail.
CF : Encore une fois, ce sont des lieux sans vie humaine. Il y a de l’eau mais le paysage est vide et assez angoissant…
NM : …ou assez reposant, ça dépend. Les personnages ne sont pas nécessaires. Dans le cadre d’un paysage, inclure un visage est inutile. Si on a envie de créer un espace de fiction avec le moins possible de narration, l’absence de présence humaine aide. Elle aide le spectateur à devenir le narrateur. On devient soi-même l’observateur de ce qui est montré. Il n’est pas forcément utile de rajouter des personnages qui auraient, eux-mêmes, leur histoire.
Quand je travaille, j’essaie d’élaguer le plus possible, d’enlever le maximum de repères, de faire des travaux sans mode d’emploi. La fiction dépasse l’image.
Prenons l’exemple de l’installation « le dernier referme la porte en entrant » à Transpalette de Bourges : j’ai fabriqué un centre d’entraînement sans repère. Je pense que la fiction sera de plus en plus dans le contexte et non dans l’image. On pouvait visiter ce centre d’entraînement en tant que spectateur en se promenant dans les allées ou, en tant qu’acteur en s’installant dans les sarcophages de béton. Vous étiez à la fois figurant et cobaye.
C’est une installation que j’ai réalisée avec 15 caissons en béton armé. J’ai proposé à des volontaires de venir séjourner dans ces caissons. Cela a eu pas mal de succès. Les gens restaient, en moyenne, deux, trois heures. C’était plutôt une bonne surprise. Je tenais à ce que les gens respectent un protocole et soient en uniforme pour éviter le voyeurisme. Ces séjours étaient devenus quotidiens pour certaines personnes.
CF : C’était une expérience pénible ou agréable ?
NM : Je pense que c’était une expérience plutôt agréable.
CF : Jean-Bernard Pouy, comment avez-vous ressenti cette exposition de Nicolas ?
JBP : J’ai pensé aux fameux caissons dans « Alien ». Je pense que le travail de Nicolas est essentiellement basé sur le temps. Le temps se tord, ralentit, accélère et c’est ce qui me semble intéressant. Je n’ai pas voulu aller dans le caisson, il y a quand même des limites ! La décompression du réel peut aussi se faire dans un lieu d’art. On sortait du réel, on était ailleurs et c’est pour cette raison que cette expérience a eu du succès. C’était très étrange.
CF : Au Palais de Tokyo, on est invité à se détendre, à s’allonger pour regarder le ciel. C’est effectivement une expérience sur le temps. Cela me fait penser également à l’installation à Bourges, on est dans une position de relaxation où il ne se passe pas grand chose. On est presque dans une expérience à la James Turrell. On regarde, avec un certain sentiment mélancolique.
JBP : C’est une contemplation dangereuse.
NM : Ma volonté, au Palais de Tokyo, était de créer une salle d’attente avec quelque chose d’indéterminé. L’idée était d’inciter les gens à se dissocier de l’extérieur pour s’immerger dans quelque chose et à y rester un certain temps, à rompre avec certaines habitudes spatio-temporelles, à accepter de dériver. Cela m’intéressait de montrer des avions d’une manière subliminale. J’aimais bien l’idée d’amener les gens dans une position contemplative avec quelque chose qui est potentiellement catastrophique. C’est aussi un sentiment d’impuissance. Je n’ai pas du tout cherché à créer quelque chose d’agréable ou de désagréable. Là n’est pas la question. La question relève de l’isolement. Pour moi, c’est une manière de positionner l’art comme un stupéfiant. Donner à l’art un statut d’invitation à la démission plutôt qu’à la réflexion. Le meilleur moyen qu’on a aujourd’hui, si on veut lutter, ce n’est pas du tout la frontalité mais la démission ou se cacher. Je crois que l’avenir de certaines formes politiques sera là.
CF : Jean-Bernard Pouy et Nicolas Moulin, vous n’êtes pas de la même génération. A une époque, nous pensions qu’il fallait se battre pour obtenir un changement politique. Mais vous, Nicolas, vous pensez plutôt qu’il faut cesser de s’affronter au réel.
NM : Aujourd’hui, on vit dans un monde qui n’est pas totalitaire mais total. Les objectifs politiques sont tous polarisés sur la même chose. Il y a une unité de pensée liée à l’économie. La seule chose qui nous reste, c’est une sorte d’évasion. L’acte de se cacher devient très subversif, car on vit dans un monde de surveillance. Si vous échappez à la surveillance, vous êtes potentiellement dangereux. Si vous décidez de passer votre vie dans un caisson en ayant besoin du moins de choses possibles, vous êtes potentiellement plus dangereux que quelqu’un qui essaie de changer ce qui est là. J’aime bien cette idée d’une résistance de l’ordre de l’anti-héroïsme.
CF : Jean-Bernard Pouy, vous qui avez vécu les évènements de mai 1968, qui êtes quelqu’un d’engagé, à travers vos personnages, dans un combat assez libertaire, qu’en pensez-vous ?
JBP : On était contre tout ce qui était organisé, étatique, donc je me reconnais bien dans l’idée de résistance, de clandestinité mentale. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui existe toujours dans des écrits utopiques et réapparaît aujourd’hui dans tous ces mouvements comme les « travelers ». C’est un mouvement qui est toujours prégnant, qui tend à avoir des présupposés idéologiques. On le voit chez ceux qui prônent la décroissance.
Ce qui m’intéresse dans le travail de Nicolas c’est le temps. Si on regarde pendant trois heures un tire-bouchon fixement, le tire-bouchon va devenir très dangereux alors qu’au départ, c’est un instrument de plaisir. Filmer une trace d’avion, une architecture, un moment, avec le temps, tout à coup, cela devient problématique. A chaque fois que j’ai vu son travail, c’était ça qui me posait problème. L’art fige le temps en général ou le bloque pour qu’il donne un signe ou un message tandis que là, c’est à géométrie variable. Le signe se déplace, varie, se ballade, revient et ça c’est très bien et très embêtant pour le spectateur.
CF : Pour revenir à ces questions de générations, que pensez-vous Nicolas des livres de Jean-Bernard Pouy ?
NM : Ma grande référence a été « Spinoza encule Hegel » que j’ai lu à 12 ans. Pour moi Jean-Bernard arrivait à la maison avec des bandes-dessinées, des livres, de la musique. C’était un révolutionnaire.
CF : L’art contemporain est un milieu considéré comme assez élitiste alors que Jean-Bernard fait une littérature populaire, même si elle est de qualité. Est-ce que vous êtes intéressé par ce décloisonnement des genres que prône Jean-Bernard Pouy ?
NM : L’art contemporain n’est pas forcément quelque chose d’élitiste, mais c’est ce que l’on en fait qui est parfois élitiste. Il suffit d’aller le dimanche au Palais de Tokyo pour voir que l’art contemporain n’est pas forcément élitiste. Je fais de l’art contemporain car c’est une pratique où la plupart des artistes explorent des franges à la limite de l’architecture, de la science, de la philosophie, de la sociologie. Je pense que les livres de Jean-Bernard ne sont pas volontairement populaires. Je me méfie des termes comme « populaire » car, derrière ce mot, il y a toujours le mot « populiste ». Si on parle de littérature populaire, il faudrait définir ce qu’est le peuple.
JBP : La littérature populaire, ce n’est pas la littérature pour le peuple. C’est la littérature qui est faite pour être lue par le plus grand nombre. C’est la littérature qui ne met pas en avant les codes, les grilles ou les références acquises pour pouvoir lire ces textes. Si vous apprenez à lire avec « Ulysse » de James Joyce, ça va faire mal. Si vous faites lire Christine Angot à une personne à qui on n’a jamais parlé d’autofiction, elle va trouver ça débile alors que moi elle me fait marrer. La littérature populaire s’adresse au plus grand nombre avec un premier niveau de lecture mais ce n’est pas pour ça qu’elle doit se priver de jeux de culture et d’allusions qui montrent les goûts et les préférences des auteurs. Certains sont des « buses » et d’autres sont des intellos mordorés qui, tout en écrivant une histoire extrêmement basique, introduisent des choses que certains lecteurs remarqueront et que d’autres ne remarqueront pas.
CF : Dans cette littérature populaire, on traite de certains sujets dont on ne traite pas ailleurs. Par exemple, dans un de vos livres, vous parlez beaucoup des punks, des rockers… Il y a tout un travail d’enregistrement d’un langage très particulier.
JBP : C’est un bon exemple. On pense que la littérature populaire, et notamment le polar, c’est le jazz. C’était peut-être le jazz en 1930. Moi, je suis né en 1946, j’avais 8 ans quand Elvis Presley est arrivé. Ma musique c’est d’abord le rock’n’roll. Le polar se doit de refléter le contemporain et le réel. C’est une littérature qui perd de sa valeur ethnographique assez vite. Si Paris était détruit par une bombe atomique, où les ethnographes trouveraient-ils des renseignements sur la vie quotidienne d’aujourd’hui ? Ils ne retrouveraient rien à la Bibliothèque Nationale sur le prix d’une bière, d’un café ou sur la musique qu’on écoute. Le langage évolue vite. Ils trouveraient tous ces renseignements dans la littérature populaire. L’autre jour, j’étais au café, deux peintres en bâtiment s’engueulaient et il y en a un qui a dit à l’autre : « Tu me fais chier.com ». En même temps, le langage ne bouge pas tellement, le verlan existait déjà au XIXè siècle. Notre boulot n’est pas non plus de singer. Mais on peut faire comme Barthes et donner un état précis d’un langage, d’un comportement. C’est notre devoir.
CF : Vous aimez la littérature balzacienne.
JBP : Effectivement, je suis balzacien contre Flaubert. J’aime bien Flaubert, mais il m’ennuie. Je suis pour une écriture rapide, si possible écrite à plusieurs. Ecrire le plus possible et témoigner rapidement sur tous les sujets. Il faut pouvoir le faire et ne pas trop se prendre la tête. Je préfère témoigner de mon temps plutôt que de mon talent d’écrire et polir mon texte pendant deux ans à la Flaubert.
CF : Quand vous avez créé ce personnage du Poulpe et la collection où on le voit évoluer, vous êtes-vous fixé des règles, comme par exemple exprimer un certain nombre d’idées sur la société, sur la police ?
JBP : C’était SAS d’extrême gauche. En 1995, Juppé était au gouvernement, il y avait les grandes grèves. On en avait assez que dans la littérature de gare, il n’existe que « SAS spécial police », on voulait au moins un héros. La seule idée, c’était qu’à chaque fois ce soit quelqu’un de différent qui l’écrive. Les caractéristiques devaient être les plus simples possibles. On a donc créé une bible d’une bêtise totale. On a décliné le mot populaire (le plat ? le pied de porc, la boisson ? la bière) pour créer une enveloppe qui n’ait pas de sens et dans laquelle tout le monde essayait d’entrer. Je ne pensais pas du tout que cela aurait un tel avenir et un tel succès.
CF : J’ai connu vos livres à travers mon fils. Pourquoi êtes-vous tellement aimé par les jeunes ?
JBP : Je ne sais pas. Cela s’arrête à 18 ans, après ils passent à des écrivains sérieux comme ils disent.
CF : Vous connaissez bien leur monde.
JBP : Oui et les gens de mon âge m’ennuient. Je crois que j’ai 18 ans d’âge mental. J’ai été animateur culturel et je suis toujours fourré dans les lycées à faire des ateliers d’écriture. Si je ne le fais pas, ça me manque. Je m’entends seulement avec les gens de cet âge-là, après ça coince.
CF : Nicolas, vous avez de plus en plus envie de vous attaquer au format cinéma. Quels sont vos projets ?
NM : Plus ça va, plus mes problématiques se rapprochent du cinéma. Ca peut aller de Chris Marker à Kenneth Anger ou Derek Jarman. Des gens un peu à la frange du cinéma justement. Pas forcément le cinéma dans le sens écrire un scénario, le réaliser puis le montrer dans une salle. C’est plutôt travailler en équipe, essayer de créer un hybride de cinéma. Si je fais un film, il ne sera pas projeté au cinéma, ce sera une installation. J’aimerais en parler en terme cinématographique mais je le ferai certainement en vidéo. Ce sera à la frange du cinéma avec des personnages de fiction.
CF : Est-ce que « Gerry » de Gus Van Sant, avec ces paysages sublimes, vous a intéressé?
NM : Il y a des passages que j’aime beaucoup dans « Gerry ». Tout à l’heure, je parlais du « Cauchemar de Darwin », ce film m’a encore plus intéressé car il a l’aspect d’une fiction et c’est, en fait, un documentaire. De plus, c’est un film apocalyptique mais qui parle de quelque chose qui se passe vraiment. Même si je ne ferai jamais de documentaire, c’est aussi ce type de cinéma qui me touche de plus en plus. Si on remonte un peu plus loin, j’aime aussi « L’ambassade » de Chris Marker, un film qui parlait de son temps tout en étant assez visionnaire. Les films de Kenneth Anger ou Derek Jarman sont plus des expérimentations plastiques. Cela ouvre à l’idée de faire un film, une fiction avec un diaporama, une succession d’images fixes.
CF : Est-ce que vous pouvez imaginer l’idée d’un scénario avec Jean-Bernard Pouy ?
JBP : Non je hais le cinéma.
CF : Et si ce film s’intitulait « La voie du ciel est dans les systèmes d’air conditionné ». Quel en serait le sujet ?
NM : C’est un terme désuet « La voie du ciel est dans les systèmes d’air conditionné ». C’est un mélange de mysticisme désuet et de climatisation. J’aime le côté dérisoire de la chose. Cela peut être une sorte d’enfermement. A partir du moment où l’on est dans un abri atomique ou enfermé sous terre, la voie du ciel est vraiment dans les systèmes d’air conditionné. C’est toujours l’idée du conduit d’aération qui vous mène vers un ailleurs qui n’existe pas forcément. Mais sans aucun mysticisme car je suis complètement athée.
Je n’ai pas encore parlé de quelque chose qui m’intéresse. Ce sont les états de conscience altérés comme le coma. « La voie du ciel est dans les systèmes d’air conditionné » est le premier titre que je voulais donner à la pièce qui s’intitule « Etametastabl » que j’ai montré au Frac Paca en avril 2005. Je trouvais ce titre trop narratif pour une pièce, mais j’aime bien cette phrase qui peut être l’image d’un coma d’une personne qui va mourir dans un hôpital. Toutes ces idées autour de la fin mais, en fait, on ne finit jamais comme un héros mais toujours de manière désuète.
CF : Cela a beaucoup de rapport avec un travail que vous avez fait où vous filmez des bords de trottoirs et des choses très quotidiennes. Mais vous les cadrez de telle manière qu’on a l’impression d’être nulle part ou dans un autre monde.
NM : C’est un travail réalisé à l’occasion du printemps de Cahors. J’avais fait des faux films satellite. J’avais filmé des cratères de trottoir avec une petite caméra infrarouge. J’en avais fait un faux document scientifique en noir et blanc. C’était une installation vidéo à double projection. La première avec des fausses vues de satellites et la deuxième était une fausse vision d’un atterrisseur au sol. Je reprenais tous les stéréotypes des images satellites « à la manière de ». J’ai fait ce travail à un moment où je m’intéressais au fait que la NASA envoyait autour de Mars des sondes qui faisaient perpétuellement des images. Sur Terre, elles sont traduites par un ordinateur qui en sélectionne certaines. C’était aussi l’idée d’image fantôme, d’une image qui est prise par une machine et envoyée à une autre machine et mise à la poubelle. J’ai voulu donner une forme à ces images fantômes, à toutes ces images inintéressantes scientifiquement produites par ces machines qui orbitent autour de Mars.
CF : Nicolas Moulin, vous venez de réaliser une oeuvre au Frac des Pays de la Loire à Carquefou. Parlez-nous de cette nouvelle installation.
NM : C’est ma première sculpture. On m’a invité au Frac des Pays de la Loire. Dès que j’ai vu l’endroit, j’ai pensé à un film de science-fiction intitulé « Rollerball ». C’est un film tourné en 1975, qui évoque le monde en 2010, décrivant un monde géré par de grands consortiums et où le sport sert à canaliser la violence. A un moment, dans le film, une bande d’aristocrates décadents tire sur des sapins et les font brûler au lendemain d’une fête. A ce moment apparaît une sculpture en inox de cinq, six mètres de haut qui représente une flèche. Pour moi, cette sculpture, c’est l’art de l’an 2000 imaginé dans les années 1970. J’ai reproduit cette sculpture dans le parc de la ville de Carquefou. Carquefou est une ville qui ressemble à ce que prévoyait « Rollerball ». Un monde rempli de lotissements « Kaufmann & Brand », une compagnie qui fait des villes sécurisées comme à Los Angeles dans lesquelles les gens sont heureux et très propres. Ils ont gardé le centre-ville très vieux, mais ils l’ont tellement poncé qu’on dirait qu’il est en mousse de polyuréthane. C’est un monde mutant mais c’est le monde dans lequel on vivra bientôt partout, même à Paris. C’est un symbole, une balise, un repère au sein de cette exposition.
Je présente cette pièce dans le cadre d’une exposition de groupe « Les ateliers internationaux ». Il n’y a pas de thème parce que c’est une exposition qui est censée être le fruit des rencontres entre les artistes et notre manière d’aménager nos travaux les uns avec les autres. Moi, je suis allé me mettre dehors. C’est un peu comme quand je vais m’enfermer au fond du Palais de Tokyo, j’ai du mal à cohabiter physiquement. Je ne suis pas contre, mais je n’y arrive pas.
Pour plus de renseignements sur Nicolas Moulin et pour visualiser certaines de ses oeuvres : http://www.galeriechezvalentin.com/