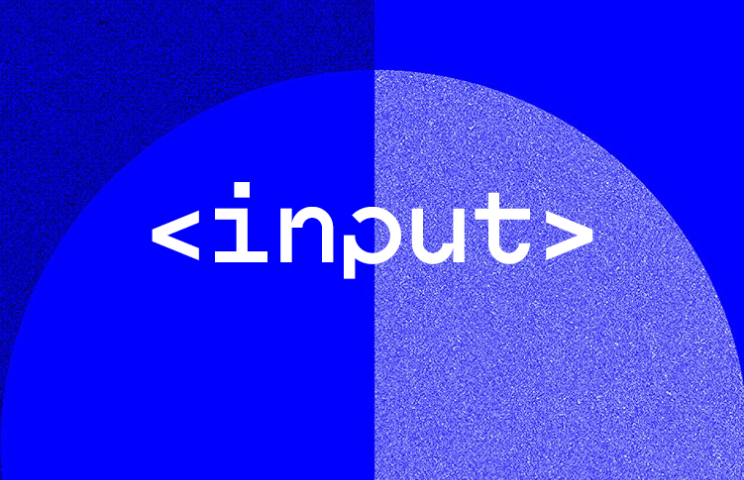Didier Marcel
Alors que la représentation du paysage est traditionnellement l’affaire de la peinture, Didier Marcel s’attache à mettre le paysage à portée de main dans des sculptures destinées à l’espace intérieur, l’appartement ou la galerie.
Avec un morceau de moquette verte, il suggère une prairie. Ailleurs, il évoque un paysage de neige en disposant des rondins de bouleaux sur une moquette blanche. Ailleurs encore, ses maquettes de machines agricoles* ou d’architectures modernistes adressent un signe d’adieu à une nature fantasmée considérée comme pure et hors du temps. Didier Marcel commentera en images les principaux moments de son oeuvre depuis les années 90.
Xavier Douroux, co-directeur du centre d’art du Consortium à Dijon, interviendra sur le thème de « l’autre mondialisation » en replaçant le travail de Didier Marcel dans une famille d’artistes interpellés par la culture populaire, le sentiment du local, le folkore.
Le travail de Didier Marcel est actuellement présenté dans l’exposition des lauréats du Prix Ricard S.A., au Grand Palais dans le cadre de « La Force de l’art » ainsi que dans l’exposition « Sol Systeme » au centre d’art Passerelle de Brest du 22 juin au 15 octobre.
Catherine Francblin (CF) : Didier Marcel a récemment présenté plusieurs oeuvres dans l’exposition « La force de l’art ». Tout d’abord, ses éoliennes dans l’espace d’Eric Troncy, puis son œuvre Coucher de soleil dans l’espace consacré aux sept prix Ricard décernés depuis 1999. Coucher de soleil est une machine agricole ancienne – une andaineuse – présentée sur une moquette de couleur bleu. D’autre part, le musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg lui consacre actuellement une exposition « (S)cultures ». On peut lire à la fois « sculptures » et « cultures », « cultures » aussi bien au sens culturel qu’au sens de la culture des champs. Dans cette exposition, Didier Marcel présente une œuvre très intéressante : une portion de terre labourée dont il a réalisé un moulage et qu’il a accroché au mur comme un tableau. Il a également relevé le sol comme il l’avait fait au Grand Palais de telle manière que l’on voit l’œuvre comme un paysage en perspective. A côté de cette œuvre présentée à Strasbourg, sont exposées des oeuvres de l’arte povera et notamment de Pino Pascali. On parlera tout à l’heure de cette proximité intellectuelle avec l’arte povera.
Xavier Douroux, j’aimerais te poser une première question. Didier Marcel habite Dijon, tu t’occupes du Consortium, vous avez une proximité géographique évidente. Je me souviens que vous l’aviez invité quand le Consortium était commissaire de la Biennale de Lyon. Quelle est la nature de tes relations avec le travail de Didier Marcel ? Quelle est ta proximité avec lui ?
Xavier Douroux (XD) : C’est effectivement une affaire de proximité et, dans le temps, c’est une affaire qui commence à durer. Au départ, je l’ai connu comme spectateur à Besançon. Il venait voir systématiquement tout ce qu’on organisait. Ensuite, il y a eu une première expérience de travail en commun à l’Athaneum en 1992 ; un centre culturel situé sur le campus universitaire de Dijon. On a invité Didier Marcel à de multiples reprises dans des expositions en dehors du Consortium comme à la Biennale de Lyon. Eric Troncy ne cesse de le programmer dans des grandes réalisations qui sont, à chaque fois, des projets de direction artistique plus que de commissariat d’exposition. Pour moi, il y a surtout un événement très important qui est son emménagement sur le territoire dijonnais qui m’a amené à avoir une relation de proximité. En un simple coup de téléphone, je peux être dans son atelier, parler de ses projets en cours et cela fait partie des choses qui me ravissent. C’est sans doute une des raisons qui nous ont mené à penser à lui pour la Biennale de Lyon. Il y a, à la fois des raisons de fond, liées au projet de la Biennale mais également des raisons circonstancielles. A un moment donné, on avait une fenêtre qui ouvrait sur le paysage lyonnais. Cela correspondait à un projet que Didier pouvait gérer. C’est cette proximité qui fait que les réflexes sont là. Il y a eu un déclic formidable en 2001. On voit dans l’atelier de Didier Marcel une présentation avec ses mobylettes jetées par terre sur ce socle circulaire et là, immédiatement, on s’est dit : nous en avons besoin pour le projet actuel qui mélangeait plusieurs champs artistiques : « I love Dijon ». Cela a été le moment où la conviction a remplacé l’empathie.
La prochaine étape, ce sont Les Presses du réel qui vont publier le premier livre de référence sur Didier Marcel. C’est une construction qui s’élabore petit à petit, une forme d’engagement de plus en plus forte. On ne le défend pas parce qu’il est dijonnais même s’il participe d’un phénomène. Il y a en effet une scène artistique extrêmement riche à Dijon avec une dizaine d’artistes ce qui n’est pas si fréquent en France aujourd’hui.
CF : Didier, peux-tu nous présenter ton travail depuis 1988 ?
Didier Marcel (DM) : Les titres sont très peu présents chez moi, mais le titre de la soirée « Sculpture, paysage & living-room » est de moi. Je pense que ce titre synthétise bien ce qui se passe sur la durée dans mon travail. La sculpture est pour moi un objet fini, une histoire de masse et de densité qui concerne des petits objets. Le paysage est ce qui est ouvert à l’air, à l’espace, au sol et surtout aux limites d’une représentation. Le living-room est la synthèse des deux choses : c’est à la fois le lieu et surtout le cadrage des représentations.
Je vais maintenant vous commenter mes images.
– Je tenais à montrer d’où je venais quand je parle de sculpture. J’ai commencé en 1988 par des objets de taille très modeste. Il y a déjà un côté iconique et un souci de représenter quelque chose.
CF : Quels étaient les matériaux utilisés ?
DM : Les premiers sont en plâtre, c’est presque une sorte d’anti-matériau qui se fait avec la main. Il y a une relation directe et immédiate au modelage.
– Je vous montre une maquette qui est une des pièces de l’exposition dont parlait Xavier Douroux à l’Athaneum. Il s’agissait de la maquette du lieu. Les idées émergent d’un travail de préparation. Vous allez me dire que ce n’est pas très original mais si cette maquette existe, c’est que j’ai reçu un jour par fax le plan du lieu et que ce plan formait déjà deux trapèzes, c’était déjà pour moi une forme à travailler. L’évolution, par rapport aux petits objets, est que les maquettes sont pour moi des objets creux alors que mes premiers objets étaient fermés et pleins.
– Ici, c’est une des premières installations où il est encore question de maquette. Des morceaux réels de paysage entrent dans l’exposition. Ce sont deux rochers de cinq tonnes, tout ça dans un lieu entièrement fermé par une petite vitrine sur rue. Les deux rochers sont une sorte de menace qui jouent avec la vitrine.
– Ici, on voit une évolution assez évidente dans mon travail de choses qui sont reprises et s’organisent les unes avec les autres. Dans le paysage, on a à la fois le salon et le jardin, c’est une exposition réalisée en collaboration avec des artistes japonais.
– Ici, [ndlr : l’œuvre est composée de bottes de paille enfermées dans une boîte de plexiglas] on voit comment des éléments du paysage réel sont mis en boîte par ce cylindre en plexiglas. C’est à la fois une façon de les présenter, de les distancier, de leur donner un côté lavable à l’éponge ; le côté domestique et le côté sculpture d’appartement. On a à la fois l’image d’un paysage et un morceau de réalité complètement perturbé. Ce sont des objets réels à peine redimensionnés.
– Voici les fameuses éoliennes. Elles se sont vraiment inscrites dans ce lieu qui était le centre d’art contemporain de Sète. C’était une grande salle de 20 x 10 mètres. Habituellement, je trouvais que les artistes ne s’en sortaient pas très bien avec l’échelle démesurée des lieux. J’ai donc eu cette idée de fermer le lieu avec des plexiglas et tout à coup, on avait une sorte de réversion du lieu. Les éoliennes sont venues habiter ce vide d’air. On ne pouvait pas rentrer, on regardait les objets tourner et on avait une vraie sensation du lieu retourné. C’était le début d’un morceau de paysage, une perspective mise à distance par cette boîte fermée.
Pour l’exposition de Sète, j’avais également créé deux autres installations qui n’avaient pas grand chose à voir entre elles, à ceci près que ce sont trois morceaux de paysages qui s’enchaînaient. Ici, c’est une petite cabane qui est à Dijon que j’ai fait copier. On l’a copiée scrupuleusement, c’est vraiment une façon d’y coller un timbre poste et de l’envoyer ailleurs. Autre morceau de paysage, c’est une fourrure synthétique posée au sol sur laquelle sont déposées des branches de bouleaux. Ce qui me plaisait était cet écrasement des deux motifs : la fourrure et les branches de bouleaux. Cela crée une sorte de scintillement et fait apparaître un paysage enneigé. Petit détail plastique, j’avais entouré la salle de plinthes au sol pour créer un tableau encadré.
CF : Comment sont fabriqués ces bouleaux ?
DM : Ce sont des vraies branches achetées dans la forêt. Je ne distingue plus un objet fabriqué, d’un objet moulé ou d’un objet repensé. J’ai également une sorte de liberté avec les échelles. Je pense que le stade de la maquette a été décisif. On est passé d’un objet plein à un objet creux qu’on a pu dominer et dans lequel on a pu projeter quelque chose. J’ai pu organiser des lieux à une autre échelle.
– Voici l’œuvre avec les mobylettes dont parlait Xavier Douroux tout à l’heure. C’est une œuvre qui s’est faite dans mon atelier. Tout à coup, l’atelier a été vidé et est devenu une sorte de clairière. C’est une hypothèse personnelle, mais dans cette clairière s’est installée une œuvre qui représente elle-même une clairière. Je parlais des échelles et des matériaux qui se heurtent pour arriver à former un tout qui forme une narration. C’est une scène très simple d’adolescent. On voit ce qui est représenté mais on ne voit pas ce qui se passe. C’est la question du hors champ. La question du salon commence également à se profiler.
CF : Ce type de pièce est un peu particulier dans ton travail. Tu disposes ici un objet ready-made qui n’appartient pas à l’ordre de la nature, qui raconte une histoire.
DM : Mon angle d’attaque porte sur la manière dont le paysage est habité. Quand je représente un paysage avec une botte de paille, la question de l’homme est derrière. Le paysage n’est jamais qu’une notion théorique et philosophique.
– Ces quatre formes sont réalisées à partir de moulages d’arbres réels. On a une sorte de velours, une surface très douce. Ces pièces tournent sur elles-mêmes. A partir de ce moment, beaucoup de choses vont tourner dans mon travail. C’est la rencontre d’une chose très décorative avec une chose très primitive qui est la question du motif dans la sculpture. On a une sorte de pré-architecture formulée avec ces quatre colonnes. Si on veut faire une jolie métaphore, on peut parler de la forêt comme cathédrale.
CF : Tu insistes ici sur le côté artificiel des couleurs, tu n’es plus dans l’imitation de la nature.
DM : Cette œuvre s’est précisée par rapport à ce lieu qui est le centre d’art de Thiers. Les artistes se sont impliqués d’une manière très personnelle dans ce lieu et je ne me sentais pas concerné. J’ai eu l’idée de faire des objets très finis, très aboutis, très décoratifs. Les couleurs n’ont fait que renforcer cette question du décoratif et de l’ornement dans un lieu d’une brutalité inouïe. C’est un ancien bâtiment industriel dans une vallée avec une paroi constituée de rochers naturels et une cascade qui passe en dessous.
– Ici l’installation à « La salle de bains » à Lyon en 2003. Cette exposition avait lieu dans un espace tout petit à la période de Noël. Je leur ai demandé de tapisser les murs, le sol et le plafond de papier aluminium. C’est devenu très scintillant comme un papier cadeau. Le lieu vide était à la fois très chaud parce que tout scintillait et très froid parce que nous étions dans un frigo. J’ai même vu des gens au vernissage qui, par réflexe, approchaient leurs mains du feu comme s’ils avaient une relation, à leur insu, avec cette sculpture.
Cette œuvre est partie d’une véritable scène. Elle est née d’un feu de forêt fait par des bûcherons la nuit, quelque chose de très primitif, presque un tableau de Jérôme Bosch très violent. Petit à petit, quelque chose de très distancié apparaît qui est toujours un feu.
CF : Est-ce que ton inspiration vient de choses que tu remarques réellement en te promenant dans la campagne ou plutôt des images, des films que tu peux regarder ?
DM : Je pars du réel. C’est assez important pour moi. La question de la réalité m’intéresse. Je veux qu’un objet ait sa propre logique, soit totalement fini et qu’on perçoive encore d’où il vient. La transposition fait que les choses doivent êtres figées, abouties. Quand on termine des branches de bois par des morceaux d’inox très chics, la question de la nature se heurte au décoratif.
– C’est le projet que j’ai présenté pour la biennale de Lyon « C’est arrivé demain » en 2003. Dans ce projet, il est question du point de fuite. De la fenêtre, on voyait le Rhône. A travers la maquette, on voyait le paysage et quand on se trouvait à l’entrée de la salle, on voyait l’allée qui nous conduisait à la maquette, qui nous conduisait elle-même au paysage. C’est une scène qui est évoquée et sculptée.
– C’est un autre paysage réalisé à Taiwan dans une fondation spéciale avec des sculptures en bronze partout. Ma réponse a été de faire un paysage de campings avec des gonflables très modestes. La pièce s’appelle Maquette. Si on prend un peu de recul, c’est l’ensemble du site qui devient un conte de fée.
– Ici la pièce de La Force de l’art, exposée au Havre. L’andaineuse a enfin un titre Coucher de soleil. Cette machine était pour moi un trait d’union dans l’histoire de l’art, à la fois Van Gogh, Millet et Duchamp pour la question de l’ombre portée. C’est une machine qui a servi à faire les foins dans les années d’après-guerre et qui comporte des soleils. C’était pour moi assez merveilleux. Le sol est devenu une estrade inclinée qui constitue le ciel du paysage. La carte postale Coucher de soleil est sous nos yeux.
CF : Cette andaineuse n’existe plus aujourd’hui. Est-ce une forme de nostalgie d’une époque révolue ? Est-ce parce que l’objet est beau ? Je comprends moins bien cette œuvre. Est-ce que cet objet fonctionne encore aujourd’hui dans les fermes ?
DM : C’est devenu une sorte de rareté. Quand on se promène dans nos campagnes, on s’aperçoit qu’une machine qui n’est plus utilisée finit dans un coin du paysage. Je suis allé la rechercher avec une image d’enfance. Mais quand j’ai voulu m’en procurer une, ça a été un cauchemar absolu, c’est quasiment introuvable. C’est une sorte d’antiquité populaire. J’aime aller rechercher ce qui n’intéresse personne immédiatement pour le réintroduire dans le champ actuel. Est-ce de la nostalgie ?
CF : C’est l’évocation d’un monde disparu.,
DM : Oui, mais un monde recomposé. Je crée une carte postale à partir d’un objet.
– Voici des vues de mon exposition (S)cultures à Strasbourg. J’ai fait labourer un morceau de terrain, j’ai cadré un morceau qui m’intéressait et l’on a fait une prise d’empreinte. C’est vraiment un coup de charrue, puis un moulage. C’est presque du modelage. Je l’ai ramené dans le champ de la sculpture et de la représentation. Le lieu est très vide en dehors de ces trois bas-reliefs en résine monochrome accrochés au mur.
CF : J’aimerais revenir sur cette question de la carte postale. L’andaineuse est un objet qui n’a plus cours. Alors que lorsque tu montres une cabane avec un tag, des architectures ou une éolienne, nous sommes dans un paysage rural d’aujourd’hui, délabré et défoncé par l’époque industrielle, qui n’est plus ce paysage rural du XIXe siècle.
Xavier, tu voulais souligner l’intérêt du travail de Didier Marcel par rapport à d’autres artistes qui travaillent sur une définition du contemporain.
XD : Je ne suis pas du tout consommateur de l’art de Didier Marcel, je suis un simple spectateur. C’st un des artistes aujourd’hui qui nous permet de ne pas être un spectateur ready-made, mais un spectateur qui retrouve son autonomie d’interprétation. Je n’ai pas d’explication sur le travail de Didier, je ne comprends pas toujours ce qu’il veut dire et ce qui justifie un certain nombre de choses. Par contre, chaque fois, j’ai un plaisir énorme devant la qualité formelle de l’apparition des choses et devant une sorte d’intelligence par rebonds dans les situations.
Quand je dis que je retrouve une certaine autonomie, c’est qu’avec le travail de Didier Marcel, on peut jeter un coup d’éponge comme sur une toile cirée dans un café sur beaucoup de choses. Par exemple, en France, on est omnibulé par une tradition d’analyse explicative liée au ready-made. Le ready-made chez Didier Marcel est de l’ordre de la banalité. Deux œuvres de Marcel Duchamp me paraissent être une mise en perspective possible du travail de Didier Marcel. Premièrement, sa porte paradoxale du 11 rue Larrey, toujours ouverte et fermée : quand on ouvre cette porte pour entrer dans la chambre, elle ferme la salle de bain ; quand on entre dans la salle de bain, elle ferme l’atelier. Cela me paraît assez lié à la première partie de son travail qui sont des situations, même à petite échelle. Le deuxième lien avec Marcel Duchamp se situe dans le livre qui raconte les expériences de femmes de Duchamp. Le livre est de Lydie Fischer Sarazin-Levassor , épousée par Marcel Duchamp pour son argent. Malheureusement, elle n’était pas suffisamment riche et il va la quitter assez vite mais ils ont tout de même vécu deux ans et demi ensemble. Elle raconte leur aménagement dans un appartement près du parc Montsouris. Ils n’avaient pas assez d’argent pour refaire le papier peint et Duchamp s’est précipité pour acheter un lot de papier buvard rose chez un buraliste. Il va en tapisser l’ensemble de sa pièce principale.
Ces deux pièces sont beaucoup plus proches de ce qui pourrait rester du ready-made chez Didier Marcel dans l’usage de situations que véritablement le rôle de l’objet. Didier Marcel est un des rares artistes qui me paraît en connexion avec l’émergence de toute une scène de la sculpture. Elisabeth Wetterwald, ici présente, est la seule critique qui ait eu l’intelligence et l’aplomb de dire : il y a des choses qui émergent. Je rends également hommage à Arielle Pelenc qui avait conçu il y a un an une exposition intitulée Sculptures d’appartement au musée de Rochechouart. Si l’on regarde le travail de Didier Marcel, à l’aune de l’apparition de cette génération d’artistes européens et américains – je pense à des sculpteurs anglais comme Gary Webb ou à des américains comme Jason Meadows ou Roger Hiorns – on a quelque chose qui va nous amener ailleurs. Ce type de sculpture d’appartement croise l’idée du living room. Cette génération d’artistes pourrait vivre dans un 150 m2 et n’utiliser que 15m2.
Je trouve que Didier Marcel pourrait vivre à l’échelle du paysage, mais il n’en prend qu’un morceau, c’est plus quelqu’un du potager que du paysage. Cette génération d’artistes fait des oeuvres extrêmement sophistiquées dans les matériaux, dans leurs assemblages, dans la complexité de situations créées sur le plan formel. C’est une sculpture de la raison, formaliste, construite et également de la situation avec des imprévues et des conséquences inattendues. Il y aussi cette dimension chez Didier Marcel. Enfin, tous partagent le goût de l’invention.
Cette capacité à faire image chez ces sculpteurs comme Gary Webb est aussi de travailler sur l’idée du déjà-vu. Alors que Didier Marcel considère qu’on a des choses sous le regard. C’est quelqu’un de visionnaire qui va plus du côté de l’art brut que de l’art sophistiqué ou de l’art relevant d’une lecture d’histoirien d’art. Il partage avec ces artistes l’idée de l’extravagance, de l’artifice, du grotesque. Didier Marcel a une démarche proche d’un architecte qui travaille à Besançon Adelfo Scaranello. J’ai écrit un texte sur cet architecte qui s’appelle « Local Time Architecture ». C’est l’idée de quelqu’un qui réalise une architecture en prenant souvent comme point de départ des granges ou des maisons en bois qui sont des éléments communs d’architecture rurale.
Quand je parle du côté art brut de Didier Marcel, imaginez quelqu’un qui soit plus du côté du facteur Cheval. C’est un bâtisseur, quelqu’un qui pratique l’art de statufier des choses bizarres, qui a cette dimension un peu grotesque. Cela me fait penser à la « moiss-bât », on a cette idée d’un partage d’une culture commune qui n’est pas « high ». On peut remettre en cause l’autorité du pop art, de jeu entre la « low » et la « high » culture. Je pense que nous ne sommes pas dans une verticalité mais dans une horizontalité entre ce qui est populaire et ce qui est extrêmement cultivé. Néanmoins, l’art brut de Didier Marcel n’est pas du tout un art qui ne connaîtrait pas la scène artistique. Il y a souvent, chez Didier Marcel comme chez d’autres artistes de l’art brut, un rapport à l’auto-fiction.
C’est un artiste qu’on ne peut plus regarder avec tout l’appareil critique dont on s’est embarrassé pour commenter l’art de la modernité ou encore celui des années 1970 et 1980. Il faut que nous-mêmes, en tant que spectateur, nous réinventions un certain nombre de libertés par rapport à cette oeuvre. Considérer que Didier Marcel appartiendrait plus au champ de l’art brut est un point extrêmement positif. J’aime ce travail, j’aime le voir, j’aime ne pas le comprendre. J’aime pouvoir effacer toutes catégories que j’avais comme des freins dans la lecture de l’œuvre.
Pour la pièce actuellement présentée à Strasbourg, on pourrait penser au champ labouré de Pino Pascali, présentée dans la salle d’à côté. Mais je pense que l’on a tout faux, à une exception près. Pino Pascali n’a rien à voir avec l’arte povera, il a été pillé par Kounellis. Je n’aime pas l’arte povera, je n’en ai jamais montré, mais j’ai montré Pino Pascali. C’est à travers Didier Marcel qu’on va regarder l’œuvre de Pino Pascali et non l’inverse. Il me fait beaucoup plus penser à une personne qui serait de ce monde de l’art brut et qui aurait vu les reliefs de Matisse (les torses du Musée d’Art Moderne de la ville de Paris). La référence c’est Matisse vu à travers le prisme de quelqu’un qui se permet une liberté naïve et cela devient d’une autre maturité.
Je n’y vois finalement pas beaucoup de choses qui ont à voir avec le paysage.
CF : Que penses-tu Didier de cette référence à l’art brut ?
DM : Je n’ai pas grand chose à rajouter après l’exposé assez savant de Xavier. Pour moi, l’art brut est une catégorie qui a des limites connues. Il concerne des pathologies lourdes.
XD : L’art brut, ce n’est pas l’art des aliénés ! On peut penser à Dubuffet quand on voit l’art de Didier Marcel. Le terme d’art brut est né en 1946. Mais le terme n’est pas une référence à l’histoire de l’art. Il permet de se dire qu’il y a là une ouverture qui va permettre à Didier Marcel de faire naviguer ses propositions et ses situations dans des territoires beaucoup plus larges que ceux où l’on aurait tendance à l’enfermer.
Didier Marcel n’est pas un artiste du terroir ou de la ruralité. Ce n’est pas un artiste qui collectionne le matériel agricole. Il met cette dimension locale à l’intérieur d’un territoire mondial.
CF : J’ai un peu de mal à comprendre ce que tu entends par le terme d’art brut, mais ce que tu as dit m’a quand même énormément plu parce qu’on voit très souvent le travail de Didier comme un travail sur le paysage. Néanmoins, pour moi, il ne s’agit pas du paysage français. Tu as rapporté son travail à une problématique internationale ou une sorte de mondialisation qui me paraît très juste. Tu as également souligné la qualité formelle de ce travail. Je pense aussi que la grande cohérence de son œuvre réside dans cette rigueur formelle. C’est là où je ne sais pas si le terme d’art brut – toujours référencé pour moi à quelque chose de surchargé, de baroque – correspond au travail de Didier Marcel qui est dans une forme d’épuration et d’abstraction.
Est-ce que tu connais les artistes évoqués par Xavier Douroux comme Gary Webb ou d’autres américains ? Existe-t-il des relations avec ton travail ?
DM : Oui et non. Je ne connais pas tous ces artistes mais je pense que devant une œuvre qui est un objet sculpté qui engage des matériaux, des techniques, des résolutions, des échelles, je me sens immédiatement questionné. Non, car je n’y aurai pas immédiatement pensé puisque Gary Webb est quelqu’un qui se heurte très violemment, qui a à voir avec une esthétique de mégalopole. Quelque chose qui consisterait à définir des gens qui seraient sur une esthétique « internationale » et qui auraient enregistré les codes.
XD : Derrière cette élégance, effectivement, il y a une certaine brutalité. Tout comme il y a une vraie brutalité dans le travail de Didier Marcel. Sous cette apparence de sophistication, il y a aussi un choc brutal de format, de convention, de catégories. Je chercherais aujourd’hui quels sont les artistes, au niveau international, dont je pourrais rapprocher le travail de celui de Didier Marcel ?
DM : Que penses-tu de Nancy Rubin ?
XD : J’aime beaucoup le travail de Nancy Rubin, mais on est encore dans quelque chose qui est une gestion du rebut et qui est de l’ordre du pop. Peut-être plus du côté de Chris Burden, le mari de Nancy Rubin, dans cette dimension de brutalité, d’aiguille qui oscille entre le normal et l’anormal. Pour moi, Didier est quelqu’un qui produit de l’anormal. Ce sont des situations qui ne sont pas rassurantes.
CF : Il y a une dimension d’énigme assez forte, d’inquiétude. On a aussi vu dans son œuvre le renouvellement de problématiques liées à la sculpture de la part d’artistes ayant appartenu au mouvement de l’ « earth art ». Et puis, dans l’arte povera, on ne peut pas négliger Mario Merz. Quand on voit les fagots de Mario Merz, on est dans quelque chose qui renverse la frontière entre l’espace domestique et l’espace naturel.
DM : Je suis pétri de cette découverte de l’arte povera qui a été un véritable choc pour le développement des idées et des formes. J’aime particulièrement Luciano Fabro qui aborde la question du mythe et de l’universalité avec une très grande sophistication, un rapport à l’ornement qui me touche plus que tout.
XD : Mais il n’y a pas de dimension politique dans ton travail alors que l’arte povera est né d’un vrai projet idéologique et philosophique. Tu fais une œuvre apolitique, formaliste qui nous permet enfin de nous repositionner. Elle n’est pas autoritaire.