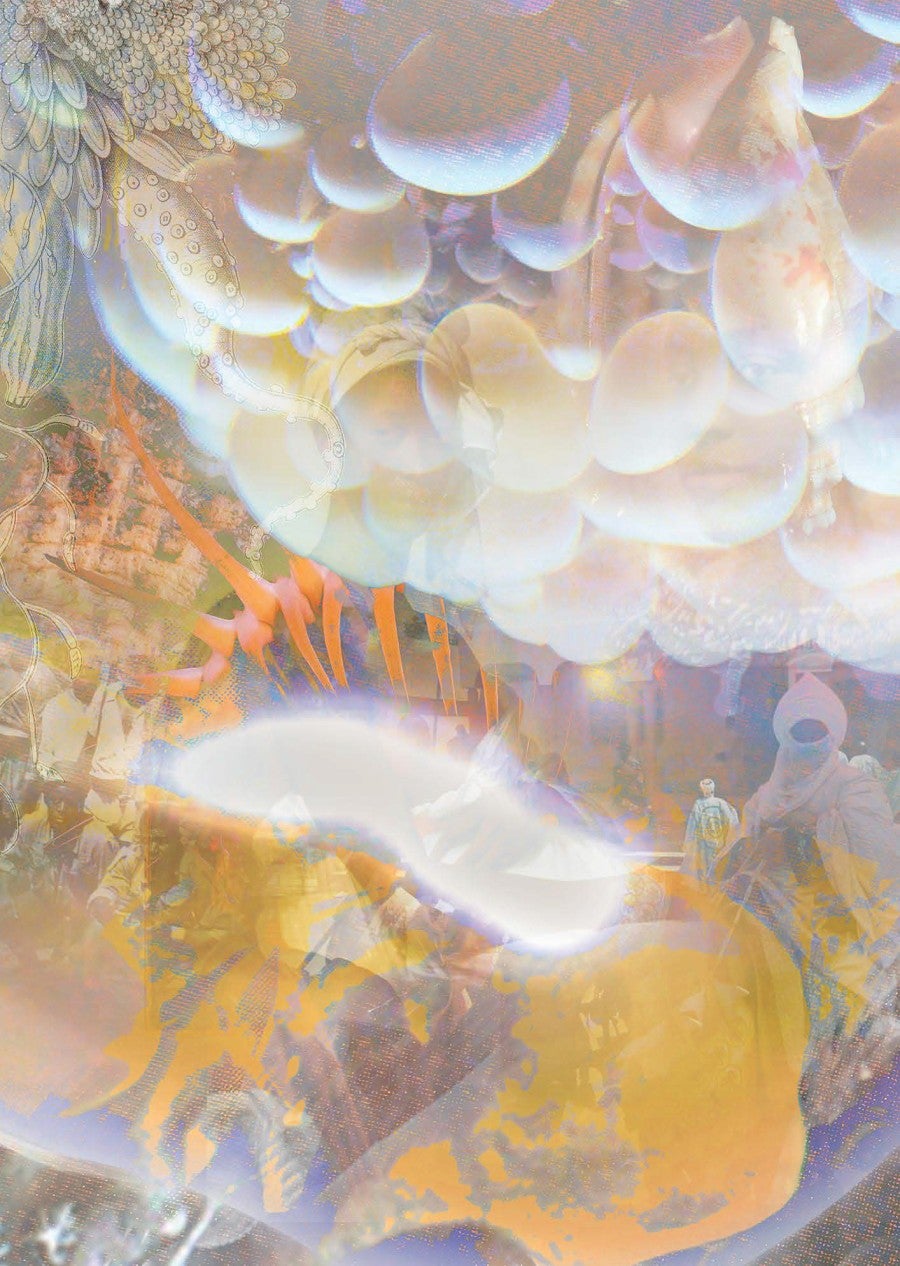À lire
Un laboratoire des luttes : récits alternatifs, stratégies d’émancipation et production de savoirs dans la scène artistique contemporaine en France

Anysia Troin-Guis est lauréate de la première Bourse d'écriture TextWork.
La désidentification est un concept lié à la psychologie et à la sociologie fondé par José Esteban Muñoz dans son ouvrage Disidentifications. Il s’agit d’analyser les œuvres et démarches d’artistes qui remettent en question les stéréotypes de race ou de genre auxquels iels ont été assigné.es : en somme, les artistes qui tentent de subvertir les codes de la culture dominante (masculine, blanche, hétérosexuelle et cisgenre). Cf. José Esteban Muñoz, Disidentifications, Minneapolis, Londres, University of Minnesota Press, 1999.
L’intersectionnalité est une notion issue des sciences sociales et politiques, élaborée par des théoriciennes féministes racisées, dont Kimberlé Crenshaw, afin de pallier un manque concernant la prise en compte des multiples processus de rapports de pouvoirs qui s’imbriquent entre eux, décloisonnant les rapports de domination entre les formations sociales (race, genre, sexualité, handicap, religion…) et générant des formes de discrimination complexe. Pour une approche synthétique et historique de la notion, voir Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz, Pour l’intersectionnalité, Paris, Anamosa, 2021.
L’afrofuturisme renvoie à un mouvement au long cours dont découle une esthétique, née au milieu du XXe siècle, liant culture noire et science-fiction (voir notamment Sun Ra pour la musique ou Octavia E. Butler pour la littérature). Le terme apparaît sous la plume de Mark Dery dans son texte fondateur « Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose », in Flame Wars: The Discourse of Cyberculture, Durham, Duke University Press, 1994.
https://www.labellerevue.org/fr/dossiers-thematiques/universal-zombie-nation-lbr-11/entretien-josefa-ntjam
Paul Gilroy, L’Atlantique noir : modernité et double conscience [1993], trad. Charlotte Nordmann, Paris, Amsterdam, 2017. Le sociologue, héritier des Cultural Studies, élabore un cadre théorique pour analyser les productions culturelles de la diaspora africaine et renouveler une histoire culturelle issue de l’esclavage et de la traite négrière. L’intérêt de son propos repose dans la mise en avant d’une culture hybride, transatlantique, qui refuse l’essentialisation nationaliste et se construit sur la rencontre des territoires entourant l’Atlantique, territoires africains, caribéens, britanniques et américains, informant une production hybride à l’instar de la fluidité des identités diasporiques.
Cf. Kodwo Eshun, « Further Considerations on Afrofuturism », The New Centennial Review, vol. 3, no 2, 2003, p. 287-302. The Otolith Group réalise d’ailleurs en 2010 le film Hydra Decapita, basé, lui aussi, sur l’univers de Drexciya.
Cf. Zygmunt Bauman, La Vie liquide, Rodez, Le Rouergue/Chambon, 2006. Le théoricien forge cette expression pour désigner les sociétés contemporaines dont les lois, l’économie de marché sont constamment soumises au flux du changement et sont basées sur la surconsommation, rendant les conditions de vie précaires et les relations interhumaines superficielles.
Quentin Deluermoz, Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Éd. du Seuil, coll. L’Univers historique, 2016, p. 26.
Notamment Fallon Mayanja, Aho Ssan, Hugo Mir-Valette (editingworldgrid), Nach, Sean Hart, Nicolas Pirus, Steven Jacques, Bamao Yendé & Le Diouck, Monochrome Noir, Crewrâle93 et Lala &ce.
Notamment les jardins, les expositions universelles ou certains monuments.
Dans un autre texte, il écrit : « L’anthropophagie est le culte voué à l’esthétique instinctive de la nouvelle terre. C’est la réduction en morceaux des idoles importées, pour permettre l’ascension des totems raciaux. C’est la terre elle-même de l’Amérique en train de filtrer, de s’exprimer à travers les tempéraments vassaux de ses artistes. » Oswald de Andrade, Anthropophagies, trad. Jacques Thiériot, Paris, Flammarion, 1982, p. 261.
À ce titre, voir le travail fondamental de Tarsila do Amaral.
https://pointcontemporain.com/gaelle-choisne-entretien/
Gaëlle Choisne écrit : « Le mot zombie trouve ses origines dans la culture haïtienne et signifie en créole “esprit” ou “revenant”. Prenant sa source en Afrique, le concept de zombie a pris une grande importance dans la culture haïtienne où il est lié à l’esclavage et à l’oppression dans l’île. Par la prise d’une potion, un homme ou une femme, dont le décès a été cliniquement constaté et dont les funérailles ont eu lieu au vu de tout le monde, revient à la vie par l’intermédiaire d’un sorcier en vue de l’asservir. Aujourd’hui encore, l’omniprésence de la figure du zombie s’explique par la persistance en Haïti des structures politiques archaïques. Cette figure négative fait référence à l’état de passivité dans lequel vit le pays et qui permet à l’oligarchie de maintenir ses privilèges. » La Feuille de boucher, éditée à l’occasion de l’exposition « Gaëlle Choisne Cric Crac », présentée au centre d’art contemporain La Halle des bouchers de Vienne, du 14 février au 3 mai 2015.
Dénètem Touam Bona, « Les métamorphoses du marronnage », Lignes, vol. 16, no 1, 2005, p. 39.
Notamment Frantz Voltaire, directeur du Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, et Monique Dauphin, militante féministe, engagée dans le mouvement des femmes immigrantes haïtiennes au Québec.
Notamment L’Emprise des ténèbres de Wes Craven (1988), Mondo Trasho de John Waters (1969), ou le clip Thriller de John Landis et Michael Jackson (1983).
Manuel Zapata Olivella, El árbol brujo de la libertad : África en Colombia, orígenes, transculturación, presencia, ensayo histórico mítico, Valles, Universidad del Pacífico, 2002, p. 129. Traduction par Marine Cellier.
Pour une réflexion plus poussée sur les relations entre transcription de l’histoire et empowerment, voir Marine Cellier, Makandal en métamorphose. Héroïsmes et identités dans la littérature caribéenne, thèse de doctorat sous la direction de Crystel Pinçonnat, Aix-Marseille Université.
À ce sujet, José Esteban Muñoz écrit dans son ouvrage fondateur, Cruiser l’utopie. L’après et ailleurs de l’advenir queer : « On le prend trop souvent pour une simple célébration de la culture queer noire. Sa pratique est perçue comme une simple appropriation de la haute couture ou d’autres aspects de la société de consommation. Je propose de voir dans ces mouvements autre chose qu’une célébration : il faut y voir une trace indélébile de la survie racisée de queer noir*es », trad. Alice Wambergue, Paris, Brook, p. 150.
Ibid., p. 151.
Christelle Oyiri, Sophye Soliveau, Kelly Carpaye, Eden Tinto Collins, Joseph Decange, Frieda, et Pierre Et La Rose.
La performance a été réalisée avec la participation de la chorale Maré Mananga, Christelle Oyiri aka Crystallmess, Sophye Soliveau, Kelly Carpaye, Eden Tinto Collins, Joseph Decange, Frieda, et Pierre Et La Rose.
Dans la même perspective d’une redistribution, ici financière et symbolique, voir le workshop mené par Gaëlle Choisne dans le cadre de l’exposition de Mohamed Bourouissa, « Urban Riders », au musée d’Art moderne de la ville de Paris (2018), avec un groupe de réfugiés, venant d’Érythrée, du Soudan, de Syrie ou d’Afghanistan, autour de l’artiste franco-cubaine Hessie (1936-2017).
Mawena Yehouessi, texte d’exposition À Plusieurs, disponible sur https://www.fraclorraine.org/media/CP_Aplusieurs_MAI2021.pdf.
Notamment avec Mawena Yehouessi aka M.Y, Nicolas Pirus, Fallon Mayanja, Hugo Mir-Valette (editingworldgrid) et Borgial Nienguet Roger.
Différent·es artistes sont ainsi invité·es : Yussef Agbo-Ola, Julien Creuzet, Hlasko, Elsa Mbala, Jenny Mbaye, Memory Biwa et Robert Machiri, Aisha Mirza et Mahta Hassanzadeh, Liz Mputu, Nolan Oswald Dennis, Bogosi Sekhukhuni, Justine Shivay.
https://blogs.mediapart.fr/kteguia/blog/190521/plusieurs-frac-lorraine-ou-d-un-enfer-pave-de-bonnes-intentions.
Sara Ahmed, Sara Ahmed, « Le langage de la diversité », trad. Noémie Grunenwald, GLAD!, 07, 2019, disponible sur https://doi.org/10.4000/glad.1647.
Sara Ahmed, « Généalogies scientifiques, pratiques et privilèges citationnels : “Les murs de l’université” (Living a Feminist Life) », trad. Aurore Turbiau in Fabula-LhT, n° 26, « Situer la théorie : pensées de la littérature et savoirs situés (féminismes, postcolonialismes) », dir. Marie-Jeanne Zenetti, Flavia Bujor, Marion Coste, Claire Paulian, Heta Rundgren et Aurore Turbiau, octobre 2021, disponible sur http://www.fabula.org/lht/26/ahmed.html.
Cette réflexion a été écrite un peu avant la parution de l’article de Libération du 8 juillet 2022 décrivant des situations de harcèlement et d’abus sexuels par un enseignant de cette même école d’art. Cette concomitance illustre bien qu’il est nécessaire, plus que jamais, d’instaurer une véritable réflexion et des changements au niveau pédagogique dans les écoles d’art et de donner des espaces de travail et de parole sécurisants pour les étudiant·es. Cf. https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/harcelement-sexuel-propos-racistes-humiliations-la-villa-arson-une-ecole-dart-au-climat-deletere-20220708_TBWTYONCQ5C53OU3A4X5BVIBUU/
Voir la présentation de la plateforme La surface démange, disponible sur : https://villa-arson.fr/actualites/2021/09/la-surface-demange/
Cf. bell hooks, Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, 1994.
Art. cit. ; la philosophe explique ainsi cette expression : « J’ai décrit les citations comme des briques universitaires, à l’aide desquelles on construit des maisons. Quand les pratiques citationnelles deviennent des habitudes, les briques forment des murs. Je pense qu’en tant que féministes nous pouvons espérer provoquer une crise autour de ces pratiques, ne serait-ce qu’une hésitation, un questionnement, qui pourraient nous aider à ne pas suivre les sentiers citationnels trop bien battus. Si l’on veut provoquer une crise dans la citation, on tend à devenir la cause d’une crise. »
À ce sujet, on peut consulter le podcast très récent Paye ta vie d’artiste ! réalisé par Manifesto XXI et coproduit par le Printemps de l’art contemporain, qui a organisé au SOMA, à Marseille, une rencontre intitulée « #balancetonécoledart : vers de nouvelles pédagogies » sur la pédagogie, la précarité et les rapports de pouvoir dans le monde de l’art, dès l’école : https://manifesto-21.com/podcast-paye-ta-vie-dartiste-ecole-dart/.
bell hooks, Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, South End Press, 1990, p. 149.
Virginie Bobin est par ailleurs membre du comité éditorial de TextWork.
Voir en ce sens, les travaux d’Emily Apter, notamment Zones de traduction. Pour une nouvelle littérature comparée, trad. H. Quiniou, Paris, Fayard, 2015, ou le plus récent ouvrage de Tiphaine Samoyault, Traduction et violence, Paris, Seuil, 2020.
Judith Revel, « Construire le commun : une ontologie », Rue Descartes, vol. 67, no 1, 2010.
« Qalqalah قلقلة ou l’aventure de l’hétérolinguisme. » Entretien par Éric Mangion et Luc Clément. Publié sur Switch on Paper le 21 octobre 2021.
La liste exhaustive des traducteurs : Rémi Astruc, Orestis Athanasopoulos Antoniou, Laetitia Badaut Hausmann, Antoine Barberon, Katia Barrett, Paul Batik, Nelson Beer, Amina Belghiti, Emma-Rose Bigé, Mélanie Blaison, Elisabeth Boshandrey, Kathleen Bonneaud, Ana Cecila Breña, Eugene Brennan, Nina Breuer, Willie Brisco, Aimo Buelinckx, Salomé Burstein, Ninn Calabre, Ève Chabanon, Ghalas Charara, Virginie Chavet, Marie Chênel, Camille Chenais, Etienne Chosson, Lisa Colin, Alexandre Collet, Christel Conchon, Thomas Conchou, Sofia Dati, Laure de Selys, Jérôme de Vienne, Florent Dégé, Judith Deschamps, Fig Docher, Eugénie Dubreuil, Diana Duta, Jacob Eisenmann, Abderrahmane El Yousfi, Marion Ellena, Lou Ellingson, Phoebe-Lin Elnan, Iris Fabre, Kim Farkas, Cédric Fauq, Claire Finch, Lucas Fritz, Léa Gallon, Nathalie Garbely, Léa Genoud, Leo Gentil, Valentin Gleyze, Sarah Holveck, Sandrine Honliasso, Caroline Honorien, Nina Kennel, Nora Kervroëdan, Nadir Khanfour, Soto Labor, Tarek Lakhrissi, Ana Marion, Hélène Mateev, Callisto McNulty, Juliette Mello, Léna Monnier, Lucas Morin, Violette Morisseau, Elena Lespes Muñoz, Margot Nguyen, Jordan Nicholson, Pierre Niedergang, Rokhshad Nourdeh, Léo Osmu, Rebecca Oudin-Shannon, Laura Owens, Sophie Paymal, Marielle Pelissero, Céline Peychet, Baptiste Pinteaux, Madeleine Planeix-Crocker, Céline Poulin, Rosanna Puyol, Catherine Quéloz, Eva Fleur Riboli-Sasco, Mathieu Rajaoba, Lily Robert-Foley, Delphine Robet, Pauline Roches, Guillaume Rouleau, Luce Rouyrre, Neige Sanchez, Samy Sidali, Jon Solomon, Chloé Subra, Myriam Suchet, Oona Sullivan-Marcus, Laura Trad, Emma Tricard, Sandar Tun Tun, Esther Um, Gemma Ushengewe, Mona Varichon, Alice Wambergue, Mawena Yehouessi.
Avec la participation et les créations de, notamment, Anis Khamlich, Alex Bakabum, Allieu Jallah, Abdo, Ahmed Ba, Abulah Koroma, Austin Ebora Muoghalu, Abdul Mustapha Koroma, Amadu Jalloh Alhade, Abdul Mustapha Koroma, Bai, Ben Rayane, Brian Recha Jongis, Calistus Anaezionwu, Fouad, Isha Koroma, Isaac Hura, Jabbie, John Mansaray, Kai Biango, Moussa Fofana, Mohamed Sawaneh, Mohamed Lamarama Jalloh, Mehdi, Mohamed A’Sesay, Matthew Ohajiani, Nana, Paul, Raymond, Peter, Sylla, Souleymane Traore, Suleyman Mohammed, Sesay Foday, Sario Camara, Oneyeke.
À partir du mois de mars 2021, des ateliers ont été menés avec de multiples artistes : deux membres du groupe Ramziya Hassan (danse orientale) et Anis Khamlich (chant, karaoké), Nina Gazaniol (vidéo), Erika Nomeni (écriture/rap), Alou Cissé Zol (danse contemporaine), Andrew Graham (danse waacking), Silvia Romanelli (costume et maquillage drag queen), Elsa Ledoux (impressions sérigraphies), Daouda Keita (danse contemporaine), Maria de la Vega (danses latines).
Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz, op. cit., p. 42-43.
AOZIZ est un réseau marseillais qui travaille avec des groupes mixtes de personnes en situation de handicap et de non-handicap et des personnes minorisées et discriminées.
En ce sens, travaillant depuis quelques années avec Liam Warren, j’ai proposé d’écrire le texte de l’exposition afin de problématiser les enjeux d’une telle démarche et d’aider à la médiation de l’exposition et des performances avec les publics.
Olive Martin et Patrick Bernier, X et Y c/Préfet de... - Plaidoirie pour une jurisprudence, performance créée en 2007, en association avec Sébastien Canevet et Sylvia Preuss-Laussinotte, interprétée par S. Canevet et S. Preuss-Laussinotte et produite par Les Laboratoires d’Aubervilliers.
Pour une analyse approfondie de cette performance hors norme, voir Cécile Debost, « Plaidoyer pour une jurisprudence », Les Cahiers de la Justice, 2015, vol. 1, no. 1, p. 23-27.
Voir https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/bureau-des-depositions
Entretien privé avec les coauteur·trices (juin 2022).
José Esteban Muñoz, op. cit., p. 318.