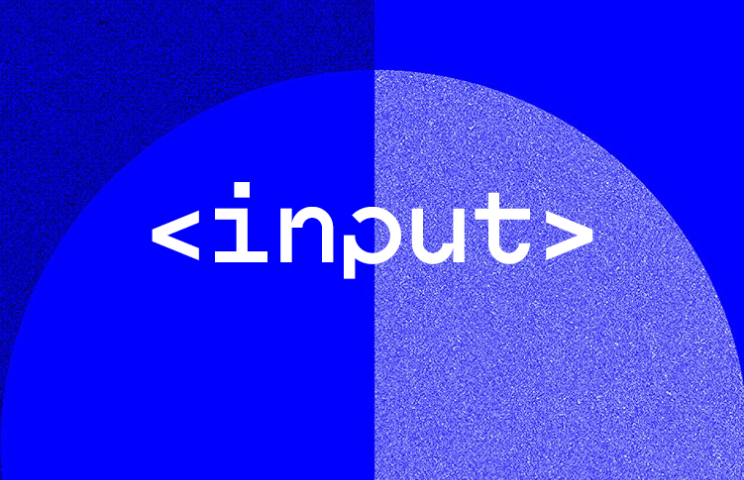Anne Ferrer Anne Malherbe
Les sculptures monumentales en tissu et vinyl de l’artiste Anne Ferrer (née en 1962) expriment, sur le mode humoristique, l’allégresse d’une sexualité rayonnante, qui se joue de la différence des sexes comme de la frontière séparant le règne animal du règne végétal.
A ses côtés, la jeune critique d’art Anne Malherbe s’appuiera sur la signification des matériaux employés par l’artiste pour souligner la dimension ironique de son travail. Elle s’interrogera sur la puissance organique qui l’anime et sur sa résonance proprement « féminine ».
Retranscription de l’entretien du 3 mai 2007
CF : Cet Entretien sur l’art est consacré au travail de l’artiste Anne Ferrer. Anne Malherbe, historienne et critique d’art, normalienne, nous accompagne également. Elle a publié plusieurs articles sur la jeune génération de peintres et prépare une exposition sur le dessin des femmes : Dessins au féminin, à la galerie de Frost. Anne Ferrer réalise de nombreux dessins. Est-ce chez toi une pratique régulière et quel lien entretiennent ces dessins avec les sculptures que tu produis ?
AF : J’aime dessiner sur des grands formats au sol ou sur des petits carnets de croquis. Le dessin est l’articulation du travail. Je dessine de manière très directe, parfois irrationnelle. Je ne suis aucune règle. Je dessine très spontanément sans m’imposer une idée au départ. Le projet vient dans la réalisation. Je pose les couleurs sur le papier et les idées viennent au gré des arabesques et des mouvements. Petit à petit, le sens prend forme, la forme prend sens.
J’essaie d’éviter la répétition. Après chaque dessin, je suis dans un état physique et mental qui me permet de passer au volume.
CF : Les dessins sont-ils des préparations à la sculpture ? Ont-ils le statut d’œuvre ou des projets ?
AF : Le dessin est avant tout viscéral, il est mon premier moyen d’expression. Le dessin vient très naturellement, il prend forme et nécessite ensuite le volume. Je vois chaque dessin en volume, peut-être parce que je viens d’une famille d’architecte.
CF : Tu es née en 1962 à Toulouse. Nous avons découvert ton travail lors des Ateliers 92 au Musée d’Art Moderne de la ville où tu présentais de grandes carcasses d’animaux écorchés, dans la tradition de Rembrandt et de Soutine. Ce n’était pas des peintures mais des œuvres en volume, réalisées avec des matières textiles. Tu t’es ensuite tournée vers le végétal avec notamment des fleurs géantes qui explosent de couleurs et sont toutes en allusions sexuelles. Puis, dans les années 2000, ces fleurs se sont mises en mouvement avec des mécanismes simples et sont devenues plus agressives et inquiétantes en se transformant en animaux carnivores.
Pour cet entretien, nous avons choisi un titre humoristique : « L’ironie a-t-elle un sexe ? ». Il me semble que cette ironie, présente dès les premières œuvres, est allée croissant. En 1988, pour la thèse que tu as soutenue à Yale aux Etats-Unis, tu avais déjà écris un article intitulé « L’ironie est-elle un outil efficient pour faire de l’art ? » qui tournait autour des artistes féministes découvertes dans les années 80 : Cindy Sherman, Barbara Kruger, Sherrie Levine, qui t’ont beaucoup influencée. Tu étais donc déjà polarisée par la question de l’ironie dans le travail de ces artistes. L’ironie est un terme qui semble simple mais qui se complexifie lorsqu’il est confronté au grotesque, à l’humour. Tous ces termes ne sont pas équivalents et Anne Malherbe va nous expliquer comment ils se définissent les uns par rapport aux autres, car cette question est centrale, non seulement dans le travail des artistes américaines citées mais aussi dans l’art contemporain où l’on a assisté au développement de ces termes, comme l’idiotie ou le burlesque.
AM : L’ironie est une figure de pensée, une attitude. Elle se caractérise par un contraste entre le sens du discours énoncé et la pensée de celui qui l’énonce. Par exemple, Montesquieu dans L’esprit des lois : « les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique pour s’en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher, si on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. »
Cet extrait est de la pure ironie car ce que Montesquieu semble exprimer sur un ton extrêmement sérieux, il ne le pense pas. Montesquieu adopte un point de vue qui n’est pas le sien, ce qui ajoute de l’intensité et rend plus efficace sa démonstration. En adoptant le point de vue de ceux dont il veut saper le discours, il en montre la vanité. Ainsi, l’ironie est une arme. L’une des contreparties de l’ironie est qu’elle court le risque de ne pas être comprise. L’ironie est souvent pratiquée à froid, sur un ton neutre. Le ton ironique de Montesquieu ne se comprend que par son contexte et si l’on a compris les démonstrations précédentes. L’ironie a pour autre caractéristique d’établir une connivence entre l’ironiste et celui qui l’écoute. Elle se caractérise aussi par la distance entre le sujet qui parle et son propos et donc par la liberté qui s’instaure entre ce sujet et son discours. L’ironie est donc une arme offensive -qui s’exerce contre quelque chose ou quelqu’un- et défensive car elle se caractérise par la prise de distance, c’est un art de l’esquive.
L’ironie se distingue du burlesque qui n’est ni une figure de pensée ni une figure de style mais une catégorie esthétique. Au départ, il s’agit d’un genre littéraire développé au milieu du XVIIè siècle. C’est une forme de comique au second degré qui consiste à énoncer un discours qui implique le genre tragique, par le propos qu’il énonce, mais qui est évoqué dans un style –avec un vocabulaire et un ton- qui ne convient pas au fond du propos. Le burlesque est le genre de la disconvenance, le non accord entre le style, le niveau de langage et le sujet. Le burlesque est un plaisir ludique, il n’a pas l’intention de dégrader le propos initial, mais il lui rend hommage par la liberté de ton prise par rapport au discours d’origine. Le burlesque est une catégorie très littéraire qui peut être transposée au travail de Anne Ferrer.
Le grotesque vient quant à lui des beaux-arts, il désigne, à l’origine, les ornements découverts dans le palais de Néron à Rome au XVè siècle qui consistaient en des figures inventées monstrueuses, contre-nature, caractérisées par l’hybridation et l’excès. Le grotesque désigne une inventivité qui se dirige vers le bouffon, le bizarre, le caricatural, le fantasque, l’insolite.
Enfin, l’humour est, selon le petit Robert, « une forme d’esprit qui consiste à regarder la réalité en en dégageant les aspects plaisants et insolites. » L’humour est une forme de légèreté, il allège la réalité. Pour Freud il est un mécanisme de défense contre la souffrance du monde. L’humour se donne l’apparence de la normalité, il est énoncé sous une forme banale et sur un ton paisible, mais le propos humoristique comporte une forme de dysfonctionnement, pour réduire à une broutille l’angoisse provoquée par la réalité, la noirceur du monde. A la différence de l’ironie, l’humour n’implique pas un renversement des valeurs. En revanche, comme l’ironie, il se caractérise par une mise à distance du réel ou de soi-même, lorsque l’humour revient à l’autodérision.
CF : Merci pour la précision des définitions de ces différentes catégories auxquelles nous allons avoir affaire en prenant connaissance du travail d’Anne Ferrer.
AF : J’ai présenté mes premiers travaux dans une ancienne boucherie désaffectée qui me servait d’atelier et dont le propriétaire participait régulièrement à des foires agricoles, auxquelles il m’avait invitée pour assister à la présentation des bêtes qui sont habillées, déguisées pour l’occasion et qui déambulent sur des podiums. Après 6 ans passés aux Etats-Unis, ce côté froufrou me manquait. J’ai découvert en même temps et avec beaucoup d’enthousiasme les défilés de Chantal Thomas, de Nina Ricci. J’ai eu envie de jouer avec ces oppositions entre le monde de la mode, le monde morbide des foires agricoles et cette boucherie insalubre dans laquelle j’ai réalisé ces premiers travaux, avec quelques tissus et chiffons. Mes premiers matériaux étaient modestes et rarement utilisés par les artistes à cette époque. L’iconographie ne faisait pas clairement partie du domaine artistique.
J’ai donc réalisé cette série de 18 pièces, montrée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et composée de bêtes sur pieds et de bêtes suspendues que j’ai appelées mes « carcasses ».
Je me souviens que je cachais ces carcasses, je n’avais pas le courage de les montrer. Mais, dans le cadre de mes études à l’Institut des hautes études en arts plastiques, Pontus Hulten m’a incitée à montrer ce travail. A l’époque, je n’étais pas prête. J’ai eu besoin d’un moment de réflexion pour assumer de le montrer. Je me souviens que je ne me sentais pas encore tout à fait femme, j’étais terrorisée par l’idée que le corps de la femme pouvait porter un enfant. J’étais obsédée par cette idée et j’avais peur, en portant un enfant, de devenir comme une poupée russe, creuse, et que mon cerveau disparaisse, que mon être ne soit plus qu’un contenant.
Jouer avec les oppositions me stimulait : jouer de choses à la fois suaves et violentes, gourmandes et cruelles. Je voulais exprimer dans ce travail à la fois l’épouvantable, le dégueulasse et le délicieux et le sublime. La matière textile est particulièrement appropriée à ce type d’activité. J’ai sûrement hérité de mes professeurs, aux Etats-Unis, Barbara Kruger ou Vito Acconci (à propos desquels j’ai écrit sur l’ironie). Eux aussi jouaient de ce type d’oppositions. Je me souviens notamment que Barbara Kruger écrivait « Nous sommes les esclaves de votre suave prison ». Elle montrait, avec cette phrase lapidaire et poétique, une femme assise, comme si des fléchettes l’avaient coincée dans cette position. Cela m’a fait réfléchir à la situation des femmes et à leur prise de parole, dans le monde en général et dans l’art, en particulier. J’étais alors fascinée et gênée à la fois, car ces artistes américaines ont balayé tout ce qui pouvait ressembler à une expression picturale, dans le sens expressionniste, émotionnel, et elles ont laissé le terrain à l’art « masculin ». En effet, Lucian Freud, Julian Schnabel se permettaient de faire de la peinture qui dégoulinait alors qu’elles étaient cantonnées à un art conceptuel, plus austère. C’est pourquoi j’ai souhaité apporter, dans mon travail, une touche plus vivante, plus douce, plus féminine.
Ce sac de couchage par exemple donne envie de l’attraper, de le serrer dans ses bras, de l’appréhender de manière physique et pas seulement intellectuelle. La physicalité des matériaux mous et fragiles que j’utilise me permet de proposer un travail flexible, malléable, pas seulement dans la forme mais également dans l’idée. Ainsi, ce sac de couchage, en forme de truie, pouvait se zipper et se dé-zipper et le spectateur pouvait se faire embrasser, au sens littéral, par la bête.
J’ai réalisé ensuite des Lits de camps et montré ce travail au Art Institute de Chicago, avec Erwin Wurm. L’idée était d’inviter les gens dans la chambre des filles et dans celle des garçons à se vautrer sur les attributs physiques, maternels ou sexuels de mes bêtes qui étaient des cochons, des vaches, des chèvres : des bêtes clairement identifiées comme des animaux de consommation, destinés à la boucherie.
Pour l’exposition « Découvertes », en 1993, j’ai choisi de montrer des pièces qui n’étaient que des contenants joyeux. Ce travail n’a plus de rapport avec la boucherie, j’ai balayé le pathos qui m’intéressait au début. Il était devenu important pour moi de me dégager de cette dureté et d’arriver à plus de légèreté. Ces Cochons-valises permettaient de s’installer en position fœtale, mais comme ils étaient capitonnés, ils avaient une parenté avec le cercueil. Dans ce travail, il y a un lien entre le tragique et le léger.
J’ai réalisé les Putching balls avec l’idée de les faire ressembler à des silhouettes humaines et animales et de jouer avec l’ambiguïté des rapports homme/animal. Pendant l’exposition une des pièces a été éclatée par un visiteur. J’ai été choquée par ce vandalisme que j’avais provoqué puisqu’on ne réalise pas des sacs de frappe sans courir ce risque. J’ai ensuite terminé la pièce qui ressemblait à une banane épluchée et qui est devenue par la couture une fleur. 100D’un événement malheureux, j’ai rebondi vers un autre travail, l’exposition « Les fleurs du mâle » que j’ai montrée à la galerie Nathalie Obadia. Ce travail s’étalait de manière à la fois obscène et joyeuse. J’aime ce mélange de joie, de légèreté et de dureté.
Dans les premiers travaux, les bêtes sur pied, par exemple, il y a presque une dialectique entre les oppositions, la douceur et la cruauté. Cette opposition disparaît grâce aux fleurs, car la fleur est à la fois mâle et femelle : un fondu s’opère alors entre les oppositions.
La pièce intitulée Le baiser reproduisait un mouvement de culbuto, comme les jouets d’enfants. Avec les Ventilateurs, j’ai répondu à un critique qui avait écrit « Anne Ferrer brasse du vent » et j’ai utilisé ce titre Anne Ferrer brasse le vent pour une pièce, sorte de machine, composée de ventilateurs habillés. Cette pièce, qui ressemble à une méduse, tourne. A la vitesse 1, les tentacules caressent le visage dans un mouvement lent et à la vitesse 10 elles deviennent un fouet.
CF : Cette pièce permet en effet de jouer sur l’ambiguïté. Elle est à la fois séduisante, jolie, apparemment innocente et violente. Pour revenir sur la question « L’ironie a t-elle un sexe ? », je ne sais pas si ton travail parle d’un sexe plutôt que d’un autre, mais il y a du sexe dans ton travail, c’est-à-dire qu’il y a à la fois de la douceur et de la violence, aussi bien dans l’animal que dans la fleur. Celle-ci est effectivement à la fois mâle et femelle et l’animal renvoie à notre animalité, donc à notre sexualité. Ce travail permet d’aborder la question sexuelle de manière détournée, par allusion, plus que par un « statement ». C’est cette ambivalence qui donne un ton ironique à ton travail.
AM : L’ironie se situe à deux niveaux. L’ironie du travail d’Anne se situe dans ce qu’on pense de l’art, du décoratif, de ce qu’est la couture, le tissu, une fleur ou un animal car elle emploie ces motifs et ces techniques en les détournant, en montrant d’eux un côté inattendu. Elle opère ainsi un renversement de sens. On attend d’une fleur qu’elle soit jolie et dans son travail elle peut être agressive. On pense qu’une fleur est mièvre et là elle devient éminemment sexuelle. C’est en ce sens qu’il y a ironie. Il existe une autre distance, un autre niveau d’ironie : son travail a quelque chose d’impertinent, d’agressif, d’inconvenant. En même temps une distance s’installe car certaines pièces sont gonflables et peuvent donc être dégonflées, comme si finalement Anne ne croyait pas complètement à l’agressivité de son travail, comme si elle tournait l’œuvre en dérision.
AF : Effectivement, les œuvres deviennent des organismes, presque des êtres pensant, mais elles changent d’état et ne sont jamais définitives. J’ai toujours eu le sentiment que lorsque la sculpture devient définitive, elle se fige. Les artistes qui m’ont toujours attirée, comme Oldenburg, Acconci, Eva Hesse, Annette Messager, Louise Bourgeois ont souvent utilisé un humour qui n’a pas ce côté définitif, figé. Les matériaux jouent également un rôle puisque j’utilise des matériaux, modestes, domestiques et cette ironie est « féminine ».
AM : Je pense que nous pouvons établir une distinction entre l’ironie au féminin et le cynisme au masculin à partir de l’exemple des cochons coupés en deux. En comparant cette pièce aux vaches de Damien Hirst, coupées en deux et conservées dans du formol, on est dans le cynisme pur, froid, alors qu’avec les porcs coupés en deux d’Anne le burlesque s’instaure. Tout en traitant de sujets sérieux, Anne ne se prend pas au sérieux.
CF : Tandis que les artistes américaines sur lesquelles Anne a travaillé, Jenny Holzer, Sherrie Levine, se prennent extrêmement au sérieux.
AF : Il y avait tout de même de l’ironie dans leur travail, une dimension plus cérébrale, alors que je recherche quelque chose de plus appréhendable, que l’on peut toucher, voire goûter. Comme cette Langue en silicone qui tourne, montrée à New-York, ou cette Manche à air en skaï, montée sur un ventilateur qui fait non de la tête, que j’ai présentée au musée du Luxembourg. Il existe une version mâle qui indique une seule direction et la version femelle en indique deux.
A l’occasion du parcours Saint Germain, il y a deux ans, j’ai montré mes bestioles qui font non de la tête dans la boutique de Sonia Rykiel. J’avais également habillé la façade de la boutique avec des fleurs tentaculaires, activées par des ventilateurs qui gonflaient la pièce.
CF : On remarque l’utilisation fréquente de couleurs rouges, orangées, des roses. Après les textiles, un matériau est ensuite fréquemment utilisé, ce sont ces matières gonflables. Comment les travailles-tu ?
AF : L’installation de la boutique de Sonia Rykiel a été réalisée par une petite entreprise textile à qui j’ai fourni un patron, mais en général je fais tout, car pendant la réalisation des pièces, la pensée opère et m’oriente.
J’aime aussi que mon travail prenne de l’envergure dans un espace et par exemple, la Fondation Salomon m’a proposé d’installer une Fontaine dans sa fondation à Annecy. Il s’agit d’une fontaine à 1000 trous, en bronze. J’ai particulièrement apprécié de transformer quelque chose de très dur, lourd, comme le bronze, en un objet très aérien quand il fonctionne.
La sculpture suivante a été réalisée à partir d’un patron, comme pour mes pièces en tissu, mais avec un matériau rigide, qui flotte. Elle est installée au domaine de Chamarande. Pour ces pièces plus rigides, ce sont les matériaux qui m’intéressent, comme pour ces cochons en résine, installés sur l’eau. J’ai intitulé cette pièce Esther Williams, en hommage à la natation synchronisée que j’ai adoré pratiquer.
AM : Cette dernière pièce se situe véritablement dans le burlesque avec la disconvenance du style entre la natation synchronisée sensée être élégante et gracieuse, mais ici pratiquée par des cochons.
AF : Je crois que ce n’est jamais vulgaire et le matériau dans lequel ces truies sont réalisées les rend presque comestibles. Je cherche à réaliser des pièces gourmandes, qu’on a envie de dévorer des yeux. En mars 2006, j’ai réalisé une pièce pour l’atelier des enfants au Centre Pompidou. J’ai invité les enfants à utiliser les modules gonflables de mes pièces pour fabriquer leurs propres jeux de construction avec des machines pour laver les voitures afin de purifier les gens qui entraient. Actuellement, je travaille à recycler une mine de vêtements en les enroulant comme des sortes de Kebab autour d’un axe.
CF : Anne a une utilisation particulière des matériaux. Il s’agit de matériaux peu utilisés dans le domaine de l’art, et surtout de la sculpture, sinon depuis les années 70 et l’Arte Povera. Quel sens pouvons-nous donner à ces matériaux, par rapport à cette question de l’ironie ?
AM : L’usage de ces matériaux donne un côté artificiel aux fleurs et aux animaux qu’Anne réalise, de l’ordre non du factice, mais du faux qui ne se cache pas. L’artificiel remonte à Baudelaire qui a fait l’éloge de l’artifice, du maquillage qui permettent à l’être humain de s’éloigner de la bassesse de la nature. Si, chez Baudelaire, tout ce qui relève de la mode, de l’artifice correspond à la quête d’un idéal consistant à s’élever au-dessus de la nature, on ne trouve pas cette quête dans le travail d’Anne. Il y a plutôt chez elle une dérision de l’idéal. Les œuvres gonflables ne se situent pas du côté de l’élévation, mais plutôt de l’enflure ; elles risquent de se dégonfler, donc tournent le sublime en dérision.
Le matériau est l’outil d’un détournement, comme on en observe dans les carcasses d’animaux qui correspondent à cette figure traditionnelle de l’histoire de la peinture de la bête écorchée, qu’on retrouve chez Rembrandt, puis Soutine. Mais l’usage du tissu, du latex, de la couleur rose, travestit la figure d’origine et lui donne un aspect burlesque. L’artificiel n’est pas dans la forme mais dans le matériau. La forme est une exagération, une hybridation. Le matériau introduit la rupture, l’artifice et aussi le kitch qui consistent en la dégradation des valeurs esthétiques académiques. Le kitch est un art d’effets qui se montre flatteur et complaisant envers les facilités d’un goût non cultivé. Le kitch existe de plein droit dans l’art depuis le mouvement pop et le nouveau réalisme, il s’est développé dans les années 80, à partir du moment où il n’y a plus d’idéal, de valeurs, de croyances où tout est relatif.
En examinant le passage du dessin à la sculpture, un basculement s’opère. Certes les dessins sont exubérants, ils montrent un travail d’imagination très libre, mais la finesse du support -le papier- maintient l’œuvre dans les limites du bon goût, de l’acceptable. En revanche, lorsqu’on passe en trois dimensions, on bascule dans le hors norme, dans l’encombrement et l’hyper-visibilité du matériau. Interviennent alors le comique, le dérangement, la menace car le ventilateur peut se mettre en mouvement brusquement et devenir un fouet.
CF : Les dessins restent dans l’ordre du beau alors qu’avec les sculptures se pose peut-être la question : est-ce de l’art ?
AF : C’est justement ce que je cherche. Avec le sac de couchage réversible, je ne voulais pas faire de l’art mais faire un sac de couchage réversible parce que cela n’existe pas. J’avais même enlevé la structure qui maintenait les cochons, précédemment et ce sac défiait la définition même de la sculpture.
AM : Le travail d’Anne est un anti-art noble, car l’art noble doit se tenir, défier les lois de l’apesanteur alors que le mou s’effondre. L’élévation est ici tournée en dérision par le gonflement. Le mou avait déjà été introduit, notamment par Marcel Duchamp. Avec le gonflable, Anne introduit un art qui se redresse, mais de façon paradoxale puisqu’il se redresse grâce à l’air.
CF : Lorsque Anne Malherbe parle de la dérision du sublime à travers ces matériaux qui se gonflent, puis s’écroulent, je pense à la notion de carnavalesque, dont Mikhaïl Bakhtine a parlé dans son livre sur François Rabelais et qu’il définit comme un moment provisoire de renversement des valeurs, des hiérarchies. Selon Bakhtine la carnaval n’est pas une manifestation mineure mais une expression essentielle de la culture populaire et qui a une dimension subversive. Le carnaval était une façon symbolique de renverser toutes les hiérarchies existantes, entre le pouvoir et le peuple, entre le noble et le trivial, entre le haut et le bas, entre le raffiné et le grossier, entre le sacré et le profane. Ce renversement culminait avec l’élection d’un roi de carnaval qui remplaçait symboliquement le roi et que les gens fêtaient. Dans l’œuvre de Rabelais, Bakhtine retrouve cette vision carnavalesque du monde, c’est-à-dire une vision qui se sert de certaines formes de la culture populaire pour s’affranchir du sérieux des détenteurs de l’autorité : les intellectuels, les religieux. C’est une manière d’attaquer leur prétention à une vérité éternelle et inoxydable. Cette dimension carnavalesque me semble être présente dans le travail d’Anne, à la fois par sa débauche de matériaux qui ne sont pas nobles et par le caractère festif, ludique de son travail.
AF : Le carnaval a une importance pour moi, de même que le défilé de militaires, de majorettes. J’ai été également fascinée par les processions religieuses, comme la Sanch à Perpignan.
CF : Le carnaval est en effet une manière d’écluser des pulsions, de laisser s’exprimer des sentiments liés au désir, à la sexualité et que la vie en société nous oblige à cacher.
AM : On retrouve d’ailleurs dans certaines des œuvres une forme de rituel initiatique puisqu’il faut rentrer dedans, se mettre en position fœtale.