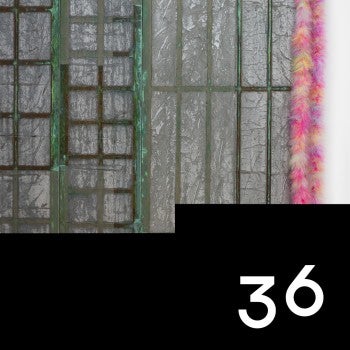« A » pour Am stram gram
Cette capacité à sauter d’une catégorie à l’autre et à refuser la fixité constitue un impératif éthique dans la pratique de cette artiste...
Ma première rencontre avec la pratique de Chloé Quenum fut marquée par une odeur prégnante d’eau de Javel. Alors qu’elle séjournait brièvement à Toronto pour une exposition à Mercer Union en 2012, j’observais l’artiste à l’œuvre – en plein air1 dans la cour jouxtant la galerie – travaillant à révéler une image abstraite à partir d’un tissu noir, par un procédé de réduction au chlore. Elle travaillait le textile inlassablement, le lavait, le manipulait jusqu’à faire apparaître un nouveau champ visuel. Il en résultait une sorte d’empreinte de soleil rouillée, charnue mais sereine, une peau tendue sur un cadre constitué de quatre panneaux tenant debout par l’entremise de leurs forces contraires. De cette tension naissait un paradoxe : cette surface nuancée évoquait-elle du marbre, de la chair ou des nuages roses ? En termes botaniques, c’est ce qu’on appellerait un spécimen inclassable. Refusant de se prêter à des réductions aussi binaires, l’œuvre témoigne d’une affinité avec la description que Roland Barthes offre du Neutre comme « tout ce qui déjoue le paradigme2 ».
À travers toutes ses expériences matérielles et recodifications d’objets, Chloé Quenum étire les limites de formes communes, mettant à l’épreuve les conventions mêmes qui régissent la manière dont nous les percevons et les nommons. Elle a recours pour ce faire à différentes stratégies, parmi lesquelles la répétition. Dans l’installation Am Stram Gram (2012), elle présente trois structures distinctes correspondant fondamentalement à la même forme, qu’elle plie ou pivote de telle sorte qu’elles permutent entre mobilier et architecture. Couché sur le côté, un paravent devient un banc ; entièrement dépliée et placée verticalement, la même forme devient un mur. L’œuvre emprunte son titre à une comptine composée d’une cascade de sons dénués de sens mais agréables à l’oreille, permettant dans les jeux d’enfants de déterminer qui engagera la partie. Sur le plan étymologique, une telle structure linguistique découle d’une tradition orale indécise. Aux origines incertaines, elle est sujette dans sa transmission à de multiples flexions, tant dans le temps que dans l’espace. Alors qu’en anglais a screen is a screen is a screen, en français, paravent et écran, bien que proches parents, restent bien distincts dans leur signification – l’un abrite du vent, là où l’autre capture la lumière pour produire des images cinématographiques. Sur la cloison de verre verticale de l’installation de Quenum, deux personnages sont projetés chantant Trois Petits Chats, un jeu de main qui consiste à répéter la dernière syllabe du dernier mot d’un vers pour former la première syllabe du premier mot du vers suivant. Cette structure est appelée « anadiplose », mot emprunté du grec signifiant « reproduire ». Par glissements successifs tout au long du chant, le chat éponyme devient tantôt chapeau de paille, tantôt bout de ficelle, ou encore lait de vache ou somnambule. Cette capacité à sauter d’une catégorie à l’autre et à refuser la fixité constitue en réalité un impératif éthique dans la pratique de cette artiste, fervente défenseuse de la migration des formes à travers différents contextes.
Nombre des œuvres de Quenum semblent plus à l’aise dans des environnements différentiels. Si Am Stram Gram occupait un espace situé à l’intérieur de la galerie, elle se réfractait également vers le monde extérieur, avec l’ajout d’une balancelle achetée dans le commerce que l’artiste avait placée sur un belvédère attenant à l’espace d’exposition. Par décret du cube blanc, les surfaces de verre dur des éléments sculpturaux occupant la galerie rejetent toute possibilité d’une halte chaleureuse, tandis que la balancelle extérieure invitait les visiteurs à s’asseoir et à regarder vers le panorama offert par la ville. Les œuvres de Quenum déjouent souvent les paradigmes en étant en deux endroits à la fois. Cette facilité à se déplacer entre des catégories strictes va de pair avec l’un des préceptes de Gloria Anzaldúa, proposant l’adoption d’une forme de conscience nouvelle et radicale en remplacement des restrictions imposées par la binarité occidentale. Anzaldúa écrivait : « La mestiza doit constamment sortir des formations habituelles ; passer de la pensée convergente et du raisonnement analytique qui tendent à utiliser la rationalité pour atteindre un but unique (un mode occidental), à une pensée divergente, caractérisée par un mouvement qui s’éloigne des schémas et des buts préétablis pour aller vers une perspective plus entière, qui inclue au lieu d’exclure3. » Pour Quenum, dépasser un tel raisonnement binaire demande d’habiter différemment les symboles existants, tant par un transcodage visuel consistant à examiner des motifs familiers et banals d’un œil nouveau et plus rigoureux qu’en jetant le trouble sur des dichotomies telles que durable/éphémère, intérieur/extérieur, ici/là, soi/autre.



Cette hybridation des formes est mise en avant dans Dune (2015), œuvre commandée par le Centre Georges-Pompidou comme élément de scénographie pour le festival Vidéodanse. Imaginez un skatepark entièrement drapé de reproductions de divers motifs de tapis issus de différentes régions et traditions. Mi-paysage, mi-aire de jeux, ce parcours tentaculaire de tapis empilés tissait un chemin de la scène à l’escalier, à travers un réseau de stations sur lesquelles les visiteurs pouvaient marcher ou se reposer. S’ils véhiculent parfois l’idée d’un repos tout en luxe et en volupté, de tels tapis, produits de la minutieuse mémoire musculaire de générations d’artisans, invitaient ici à une pratique plus active, voire athlétique. Formant un terrain accidenté, ils introduisaient une nouvelle syntaxe, une possibilité de faire interagir des systèmes graphiques préexistants. Par cet acte d’appropriation, les objets se trouvaient libérés de leurs régimes symboliques existants, se déchaînant sous la forme d’une proposition architecturale aussi inédite qu’alléchante. Tout comme le désert de leur titre, ils offraient eux aussi des pentes glissantes, sujettes aux mouvements soudains, à l’érosion graduelle et à des lignes changeantes, et affirmaient ainsi un statut transitoire imprégnant la plupart de l’esthétique de Quenum. De même, Circuit III, dont l’existence matérielle commença sous la forme d’une copie d’un tapis de Kachan, subissait une série de transformations, devenant au fil de ses divers transits un instrument de service. D’architecture mobile fonctionnelle, l’œuvre se muait en un navire itinérant, accueillant à son bord des possibilités telles qu’un espace de travail temporaire ou un tapis d’escalier. Par divers processus d’addition et de soustraction, Quenum manipulait une fois encore le textile comme s’il s’agissait d’une photographie couleur exposée à l’eau, l’émulsion détachée se transformant en flaques de pigments. Une œuvre témoin du caractère d’adaptabilité et de brassage qui est au cœur de sa recherche artistique.
« B » pour Botanique
Ce qui attire Chloé Quenum, ce sont ces aspects moins connus de la production culturelle, ces récits échappant au radar des discours officiels.
La différence entre le verre et le cristal, comme me le précisait Chloé Quenum, n’est qu’une question de plomb. Ce seul ingrédient est ce qui distingue l’ordinaire de l’opulent, et ce sont là des métaphores qu’elle aime à mélanger. Lors de nos conversations autour de l’installation La Grande Place (2019), elle qualifia les formes de ces pommes, poires, oranges, citrons, bananes, coings, figues et grappes de raisin de « banal devenu monstrueux4 ». Doit-on en déduire que la taxonomie crée des monstres ? Ou peut-être le court-circuit synesthésique est-il dû à la palette de couleurs hors du commun et aux étranges fioritures dont sont ornés ces fruits excentriques ? La « Grande Place » qui donne son titre à l’œuvre désigne un endroit de l’usine réservé aux artisans les plus qualifiés de la cristallerie. Les 111 fruits de cristal et de métal façonnés à la main composant son installation sont des « perruques », terme qui renvoie à leur statut clandestin. Cette production artistique furtive que les artisans créent pendant leur temps de pause et en dehors des heures de travail – tacitement reconnue comme sous-jacente au processus officiel – est prisée d’un marché ciblé de collectionneurs achetant hors licence des œuvres issues de l’usine. Par son installation, l’artiste met en avant une activité quotidienne qui se soustrait à la production industrielle pour se vendre sous le manteau, exposant cette pratique secrète à travers une corne d’abondance cristalline disposée sur des vitrines de verre illuminées. Chaque objet est un exemplaire unique fait main, un hapax legomenon du processus de fabrication. En redéployant les outils et matériaux existants à contre-courant de la production de l’usine, ces travailleurs à la chaîne en deviennent également des artistes bossant au noir. J’ai moi-même eu à une époque l’occasion de goûter à cette catégorie de production subversive, m’introduisant en dehors des heures de travail – pour mieux profiter des ordinateurs et imprimantes – dans une tour de bureaux avec un ami, employé de jour, poète la nuit. Le quartier financier devenait alors, l’espace d’un instant, notre studio volé. Était-ce ce caractère non autorisé qui donnait à la poésie que nous y écrivions plus de saveur ? Ce qui attire Chloé Quenum, ce sont justement ces aspects moins connus de la production culturelle, ces récits échappant au radar des discours officiels. Dans son travail, par ailleurs, elle use souvent d’agents métaphoriques prenant les traits de protagonistes botaniques.


Nos noms sont l’une des histoires les plus chargées qui nous soient attribuées.
Le titre de son œuvre Le Sceau de Salomon (2018) renvoie au nom d’une plante à fleurs qui, quand la feuille vient à tomber de son rhizome, conserve une empreinte ou cicatrice ressemblant à un sceau. Nom de fleur riche d’une longue tradition d’associations symboliques, il convient parfaitement à l’intérêt de l’artiste pour la façon dont les signes et des histoires recirculent à travers le langage. Point d’orgue de sa résidence à Te Whare Hēra en Nouvelle-Zélande, cette installation se composait de fleurs et de fruits non indigènes disposés au sol et suspendus dans l’espace, entourés d’images en mouvement et d’œuvres sonores. Comme toutes les fleurs coupées, elles subissaient un processus de préservation naturelle, jusqu’à totalement se dessécher. Si l’on conserve les fleurs séchées, c’est souvent pour leur valeur sentimentale, pour l’événement passé qu’elles nous évoquent. Ces plantes signalaient une présence déplacée, tout en créant dans l’espace de la galerie leur propre paysage, leur appel parcourant la distance qui séparait le domicile de l’artiste en France de sa résidence temporaire en Nouvelle-Zélande. Le passage est l’un des thèmes clés de cette œuvre, qui inclut des séquences vidéo filmées à divers endroits dans les différents fuseaux horaires que l’artiste a traversés. Plutôt que d’affirmer des frontières strictes et mettre l’accent sur le caractère étranger d’une telle flore, elle crée un espace interstitiel, un monde flottant situé aux confluences, où chaque territoire voit sa saison se mêler à celle de l’autre, tels deux cadres temporels superposés. Il ressort de la plupart des productions de Quenum un intérêt pour le renversement et le réarrangement des signes, des symboles et des matériaux. Désireuse d’atténuer les réductions qu’induit une parfaite classification des sujets selon des attentes fixes, elle favorise plutôt le convergent, l’ambigu et l’aléatoire. L’affirmation d’un tel espace d’hybridité soulève des enjeux tant politiques que philosophiques.
Lors de son séjour en Nouvelle-Zélande, elle anima un atelier intitulé « What’s your name? » (« C’est quoi, ton nom ? »), au cours duquel elle demandait aux personnes interrogées de parler de leur nom. Si les portraits vidéo qui en résultent n’ont encore jamais été exposés en public, Quenum a eu la gentillesse de me présenter ce projet en cours. Dans de nombreux exemples, le visage du sujet sort du cadre, seul le haut de son torse étant apparent. Quand il existe en revanche un lien plus intime entre l’artiste et le sujet, le visage de celui-ci apparaît, révélant davantage sur son caractère et ses manières. Chaque voix offre des indices sur l’âge, la culture et la personnalité. La gêne et la timidité, tout comme la joie et la fierté, sont autant d’émotions palpables dans ces portraits. Le fait de se nommer soi-même consiste à sélectionner l’image que l’on préfère et à la projeter dans le monde. Nos noms peuvent également refléter l’hybridité et un mouvement entre les continents, au même titre que la migration et l’hybridation des plantes. Chloé Quenum n’y fait d’ailleurs pas exception ; son nom de famille, très répandu au Bénin, se rencontre aussi en France, suggérant une relation découlant des échanges coloniaux. Nos noms sont l’une des histoires les plus chargées qui nous soient attribuées. Quiconque veut sonder mon origine ethnique va souvent me poser des questions sur mes deux noms de famille. Selon l’humeur, il m’arrive de répondre avec légèreté que je suis à moitié banane (la plus célèbre exportation de l’Équateur, d’où vient Robayo, le nom de mon père), mais que pour rester dans le monde végétal, il est plus approprié de citer la trajectoire de la pomme de terre, que l’on dit originaire des Andes mais qui a fait le tour du monde jusqu’à devenir une denrée alimentaire de base vitale en Irlande (où Sheridan, le nom de ma mère, est courant). Le fait que je porte ces deux noms témoigne à la fois de la collision entre hémisphère Nord et hémisphère Sud et du désir de revendiquer des lignées matrilinéaires. En choisissant les noms de nos enfants, ma sœur et moi nous sommes mises d’accord pour nous partager nos deux noms de famille, chacune en transmettant un en l’ajoutant à celui de son partenaire afin de créer pour nos enfants une nouvelle typologie. En posant à ses sujets la question What’s your name?, ce que l’artiste entend localiser, c’est précisément tout ce qui va relever de l’improbable, du fortuit et de l’inclassable dans notre manière d’habiter ces patronymes. Résistant activement à l’impératif ethnographique de trouver des points d’origine, elle préfère souligner la façon dont le langage est parfois pris de tremblements dans sa capacité à circonscrire l’identité.

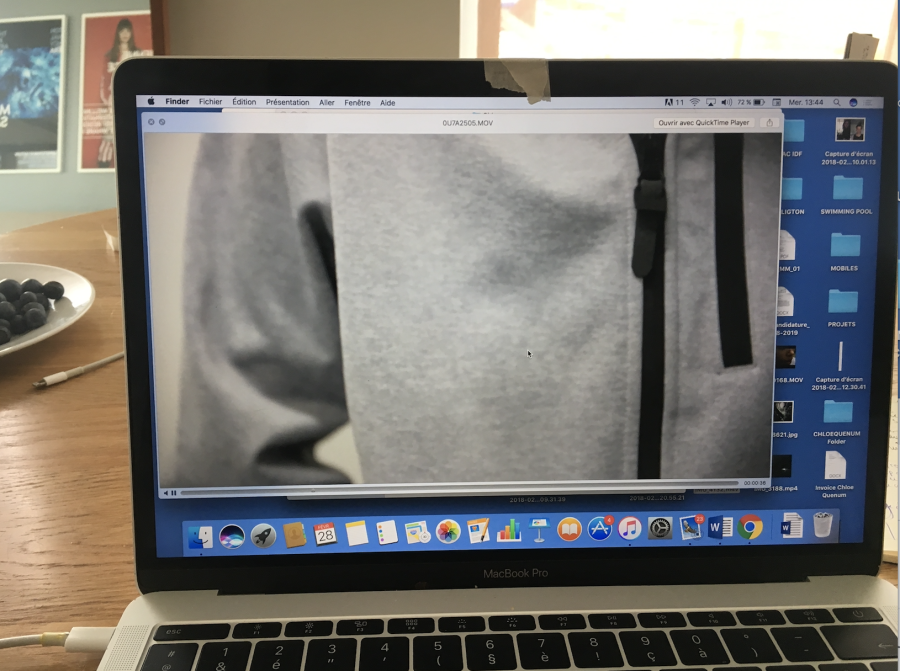
« C » pour Cuivre
La nature morte tridimensionnelle de Quenum met en scène une démonstration par la matière des cycles de vie et de mort.
De retour au pays après sa résidence à l’étranger, Quenum a présenté à Paris l’exposition Châtaignes (2018), comme un moyen de méditer sur son passage d’une temporalité, d’une langue et d’un paysage à l’autre. Exposition jumelle d’une dérive entre les continents, elle se compose d’une installation où quantités de fruits jonchent le sol de la galerie, improbables excédents provenant de différentes cultures qui auraient miraculeusement prospéré en intérieur. Si les châtaignes (en anglais chestnuts) du titre de l’exposition sont aujourd’hui associées à une spécialité française – les marrons glacés –, le châtaignier était en d’autres temps une culture de subsistance appelée « arbre à pain ». Sans doute là aussi en référence à leur surabondance, l’expression idiomatique an old chestnut désigne en anglais un adage tellement répété qu’il finit par être galvaudé. En cuisine, la châtaigne se révèle une adversaire coriace, difficile à libérer de sa coque dure à moins d’être parfaitement rôtie. S’inspirant pour ce projet de la pellicule protectrice caractéristique de la châtaigne, Quenum a appliqué à d’autres récoltes une nouvelle peau faite tantôt d’argile, tantôt de cuivre. Celles couvertes d’argile sont des fruits de saison issus de producteurs locaux, là où celles couvertes de cuivre sont des sarcophages permanents. Ces enveloppes de cuivre me rappellent une chaussure de bébé métallisée au bronze ayant jadis appartenu à mon père, memento mori de ses premiers pas. Chaussure comme fruit me rappellent à leur tour l’odeur du penny en cuivre, monnaie devenue aujourd’hui obsolète.
La nature morte tridimensionnelle de Quenum met en scène une démonstration par la matière des cycles de vie et de mort. Scellé dans du cuivre, le contenu revêt une dimension mystique. L’écorce d’argile étant vouée pour sa part à une décomposition plus rapide, elle se dessèche et se fissure jusqu’à s’ouvrir, libérant l’esprit final du fruit qu’elle emprisonne. Qu’adviendra-t-il de telles conserves ? Un archéologue du futur saura-t-il y discerner les contours de l’art contemporain ? Châtaignes présente également deux autres objets qui s’inscrivent en contrepoint : un vase en verre vide, censé normalement accueillir un bouquet, et un présentoir à fruits en métal fait à la main, originaire du Bénin. Intrigantes offrandes, réceptacles à richesses naturelles, ils se retrouvent ici vidés de tout contenu et posés à même le sol, obstacles obligeant le visiteur qui traverse l’espace à quelques délicats détours sur la pointe des pieds. Deux dessins au trait répétitifs représentant un cœur et une main reproduisent de mémoire des tatouages que l’artiste a observés lors d’un atelier où les membres du public étaient invités à dévoiler leurs marques corporelles. Sur l’un des murs opposés s’étend une vaste pièce de tissu sur laquelle sont brodées à la main des notes de terrain de l’artiste datant de l’époque de sa résidence. Par ces œuvres adjacentes, Quenum opère une transcription inverse : l’aiguille sur la peau devient l’encre sur le papier, qui devient l’aiguille sur le tissu, complétant ainsi une orbite caractéristique de ses stratégies de réinvention des signes par leur déplacement à travers différentes procédures.




Nombre des images de Quenum sont porteuses d’une certaine évanescence qui tient à l’instabilité même du cuivre et à sa tendance à changer de forme sous l’effet de l’oxydation. Circuit I (2014), par exemple, est le produit d’une lente réaction chimique entre une feuille de philodendron emprisonnée sous une plaque de verre et son châssis en cuivre. Au fur et à mesure que la feuille se désintègre, la réaction génère une empreinte fantôme proche du rayogramme. Quand une plante est exposée à la toxicité du cuivre, sa couleur commence par s’estomper, pour passer finalement du vert vif au jaune ou au brun. Le cuivre peut lui aussi se ternir et s’oxyder avec le temps. C’est ce qui fait d’ailleurs que dans cette œuvre tant le contenu que le contenant se retrouvent en proie à un processus de décomposition allant à l’encontre de l’impératif muséologique de conservation. Si l’artiste choisit ici le philodendron, c’est pour mettre en valeur une plante exotique aujourd’hui largement utilisée comme élément de décoration intérieure, au point d’être devenue un incontournable des séances photos commerciales. Augure (2014) met en scène une combinaison de feuilles transposées sur l’image photographique d’une main, couverte de ce qui semble être une poussière métallique. Serait-ce là aussi du cuivre, comme pour le processus de métallisation au bronze dans Châtaignes ? Cette paume tendue me rappelle l’œuvre de Richard Serra intitulée Hand Catching Lead (1968), dans laquelle celle de l’artiste est noircie par le contact répété avec le métal salissant. Dans Augure, marquer ainsi la main de poussière a pour effet d’accentuer le détail des lignes de la paume, lesquelles, mises en relief, surgissent en réseaux complexes. Si l’image invoque la pratique de la chiromancie – le fait de dire la bonne aventure en lisant les lignes de la paume de la main –, la complexité de la carte qui s’affiche va bien au-delà de toute possibilité de divination.
« D » pour Dérive
Dans Overseas (2020), Quenum centre son attention autour du seul cas de l’ananas, emblème de l’exportation de fruits tropicaux et de l’exotisme, synonyme de vacances à la plage, de piña coladas et de tiki bars. « Ananas » évoquera aux Canadiens ayant grandi dans les années 1980 le nom du fruit parlant qui accompagnait le spectateur dans une série de vidéos éducatives en français diffusées à la télévision. Se retrouvant dans un épisode face au panneau d’entrée du musée de l’Homme, le fruit demandait alors au gardien : « Mais où est le musée des fruits ?5 », une façon pour lui d’affirmer son statut d’être conscient et de demander reconnaissance en tant que sujet parlant. Dans cette exposition conçue tout spécialement pour Les Bains-Douches à Alençon, l’ananas parle également, mais à voix basse et par allusions subtiles. Quenum y offre sa propre version d’un musée des ananas, traçant les contours du fruit dans une série de peintures en trompe-l’œil appliquées à même le mur, observables à travers un œil sur pied intitulé Teardrop, dont les cils, pareils aux écailles d’un ananas, sont autant de crochets invitant à y pendre des vêtements. À la fois portemanteau de métal et appareil protophotographique, il offre des angles de vision et des possibilités de cadrage multiples pour les œuvres accrochées au mur. L’espace lui-même constitue une chambre d’écho de l’architecture et de la réfraction existantes, les fenêtres illusoires reflétant la forme des ouvertures réelles du mur d’en face. Les horizons sur lesquels donnent ces ouvertures imaginaires offrent un mélange déroutant d’échelles et de perspectives allant du gros plan au lointain – une main, le col d’une chemise, un jardin verdoyant, le mât d’un bateau. Avec cette série d’images, c’est l’idée même d’une perspective centralisée qui se trouve déstabilisée, au profit d’une forme d’observation distribuée ébranlant jusqu’aux fondements de toute contemplation qui se voudrait exotisante.



...la transmission peut-elle être plus circulaire que linéaire ?
Dans l’ensemble de sa pratique, Quenum desserre les liens entre les signes et les sources, rendant nouvelles des considérations formelles. Les signes extraits de contextes différentiels divers sont au cœur de l’exposition Élise, qui réunit Les Allégories (2016), Names (2016) et Protection (2016). Les Allégories est le fruit de ses recherches sur les motifs ornant les tissus au Bénin et au Togo. Portés en Afrique, ces textiles véhiculent des significations bien précises en fonction de leurs compositions graphiques. Transposés depuis leur contexte d’origine, ils réapparaissent ici enfermés dans du verre cathédrale teinté, qui est par définition texturé et semi-transparent. Il en résulte un nouveau système de signes témoignant de la longue tradition multimodale du wax, tissu traité à la cire maintes fois ballotté d’un point pivot à l’autre des routes commerciales coloniales. Ayant observé les techniques du batik lors de leur projet de colonisation de l’Indonésie, les marchands hollandais, une fois de retour aux Pays-Bas, en adaptèrent les concepts aux nouvelles méthodes de production industrielle dans l’espoir de revendre ces textiles manufacturés aux colonies. Si ces tissus de fabrication industrielle ne rencontrèrent pas en Indonésie le succès escompté, ils devinrent populaires dans les années 1880 en tant qu’exportation européenne vers l’Afrique de l’Ouest, où ils se forgèrent une identité à part, aujourd’hui irrévocablement associée au patrimoine africain. La culture matérielle de ces imprimés décrit en fin de compte un cadre complexe, un jeu de questions-réponses entre les goûts, les lieux et moyens de production et le commerce colonial. Inspirées de ces référents, les lignes deviennent des abstractions graphiques, apparaissant sous un nouveau jour en tant qu’éléments de plomb enchâssés dans ces fenêtres. Tout près des fenêtres se trouve Names, découpe de PVC bleu étendue au sol comme un pochoir, dont les incisions reproduisent une série d’idéogrammes hébraïques transformés. Sur ce mince miroir d’eau bleu sont déposés sept objets de verre soufflés à la main intitulés Protection, dont les formes sont dérivées d’un rébus découvert sur une calebasse datant du royaume du Dahomey. Leur transformation en verre ne fait qu’obscurcir un peu plus l’énigme. Exposées in situ comme un tout, Les Allégories, Names et Protection forment un régime symbolique à part entière, bien que cryptique. Ces vastes systèmes de signes tirés d’iconographies disparates sont mis en présence de nouvelles équivalences. En s’insérant dans leur histoire, Quenum propose d’interrompre le circuit, déclenchant par là même un questionnement : la transmission peut-elle être plus circulaire que linéaire ?



Il existe entre les œuvres de Quenum un fil directeur que l’on pourrait qualifier de « désamarrage ». Dans sa série Leeway (2013), des pièces de tissu blanc plaquées sous des cadres de bois foncé évoquent des voiles baissées, alors qu’il s’agit en réalité de hamacs pris sous des panneaux de verre. Comme les voiles au vent, les hamacs se balancent eux aussi, bien que sous l’action de nos corps. Cocons enveloppants invitant au repos, souvent associés au temps libre et aux siestes en extérieur, ces hamacs, une fois figés sur place, deviennent des objets d’art graphique dont l’immobilité évoque le linceul. Les cadres de bois font plus que remplir les simples fonctions d’exposition et de protection attendues d’un cadre photo. Hybride entre image et sculpture, Leeway présente des tiges de bois saillantes fuyant le cadre. Si certaines de ces extensions sortent du mur à angle droit, d’autres servent de tissus conjonctifs reliant entre eux les différents éléments de la série. Ces angles saillants ont-ils pour vocation de protéger, de la même façon que certains fruits ont développé au cours de leur évolution des épines afin de repousser les prédateurs ? Quenum nous offre là une énigme synesthésique de plus à démêler. Issu du domaine nautique, le terme leeway désigne en anglais la dérive latérale subie par un navire sous l’effet du vent et des courants naturels, qui le font dévier de sa course. La notion de dérive décrit donc parfaitement la façon dont l’ensemble de la méthode artistique de Quenum s’approprie et évoque une association avec les Situationnistes, qui prônaient la dérive6 comme antidote à l’ennui imposé par la culture marchande. Cela dit, là où eux voyaient dans la dérive un moyen de tracer les contours d’un environnement urbain, les œuvres de Quenum proposent pour leur part des chemins psychogéographiques qui ne sont pas rattachés à un lieu précis. Au lieu de cela, les trajectoires qu’elle suggère planent d’un fuseau horaire, d’une identification et d’une condition à l’autre. Pour citer encore Anzaldúa, « [l]a nouvelle mestiza s’en sort en développant une tolérance pour les contradictions, une tolérance pour l’ambiguïté. […] Non seulement elle nourrit les contradictions, mais elle transforme l’ambivalence en quelque chose d’autre7. » Comme toujours dans l’œuvre de Quenum, le spectateur est invité à faire fi de ses préjugés pour considérer le monde sous un jour nouveau. En anglais, to give someone leeway, c’est accorder à quelqu’un plus d’autonomie, se montrer indulgent envers sa divergence. Ainsi Leeway laisse-t-elle entrevoir la possibilité de naviguer ou d’agir entre les choses. La pratique à la fois calculée et généreuse de Quenum a cela de particulier qu’elle ne pose jamais de parcours véritable, jamais d’origine fixe, jamais de source définitive – seulement un réseau complexe de croisements provisoires et de conditions fluctuantes susceptibles d’être reconstituées à tout moment.
En français dans le texte (NdT).
Roland Barthes, Le Neutre : Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 31.
Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, San Francisco, Aunt Lute Books, 2e édition, 1999, p. 101, citée dans « La conscience de la Mestiza. Vers une nouvelle conscience », trad. de l’anglais (États-Unis) et de l’espagnol (chicano) par Paola Bacchetta et Jules Falquet, dans Théories féministes et queers décoloniales. Interventions Chicanas et Latinas états-uniennes – Les Cahiers du CEDREF n° 18, Paris, Université Paris Dideot, 2011, p. 78.
Conversation en vidéo avec l’artiste, 11 mai 2021.
Téléfrançais!, épisode 17, réalisé par David Moore, écrit par Ken Sobol, avec Stephen Brathwaite, Jacques Dell, Bob Dermer, Robyn Hayle, Nina Keogh, Byran Matheson, Amy McConnell, Noreen Young (Toronto : TVOntario), vidéo YouTube : www.youtube.com/watch?v=6Wh88Wryejg
En français dans le texte (NdT).
Anzaldúa, Ibid.