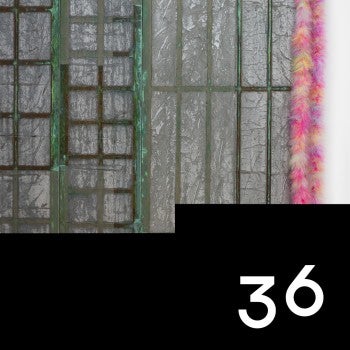Ce qui s’échoue sur le rivage…
Des piles, des sacs, des tas ; des pièces et un couloir où des tables et des bancs de fortune vacillent sous le poids et le remous des choses ; de vieux tissus, des fils, des formes en plastique, certaines fondues ou cassées, si le plastique peut se « casser » ; mais aussi des traces de matériaux organiques comme du riz, ou de ce qui fut organique, par exemple une peau de serpent ; glanés dans les rues de différentes villes ou achetés, dans des commerces légaux ou sans doute pas ; et, parmi cette collection de matériaux, une sculpture qui pend sans se distinguer complètement de ce qui la compose. Le fatras autour de cette sculpture finira-t-il par en faire partie ? Ou en a-t-il fait partie avant d’être ensuite retiré ? Faut-il y voir des fragments d’une pile de matériaux qui a dérivé loin de son rivage, trouvant un nouvel endroit où demeurer, à l’ombre de cette pièce à moitié achevée ?
J’ai rencontré ces matériaux en rendant visite à Julien Creuzet, chez lui et dans son atelier, situé au sein d’une communauté d’artistes à Fontenay-sous-Bois. C’était un beau 1er mai ; chaud à l’extérieur tandis que nous buvions du thé assis au soleil sur des bancs, frais à l’intérieur. Paris et d’autres villes de France se mobilisaient pour des mouvements sociaux. Nous étions légèrement fatigués, la nuit avait été courte pour tous les deux. J’étais pourtant impatiente de découvrir son lieu de travail, après avoir été captivée par son exposition multiforme au Palais de Tokyo quelques jours plus tôt1. D’où venaient les éléments qui composaient les sculptures, les tableaux, les vidéos, les textes, les pièces sonores – où Creuzet trouvait-il les morceaux de tissu, de plastique, les tuyaux métalliques, les fils, les éclairages LED et les autres détritus qui composent les échanges entre ses pièces agencées selon un brillant équilibre, et pourquoi ? Qu’est-ce qui nourrissait la dimension conceptuelle de son exposition ? Comment avait-il imaginé les liens entre les différentes pièces dans l’exposition – le jeu de leurs éléments physiques et acoustiques – et notre planète victime d’un climat posthumain ? Comment l’exposition se modifiait-elle selon la personne qui la traversait ? Dit simplement : où sommes-nous quand nous côtoyons ces fictions visionnaires et révolues ? Comment ses sculptures offrent-elles une perspective sur les devenirs passés et futurs ? Qui est ce nous quand nous nous tenons ici ?
J’ai commencé à poser ces questions alors que nous quittions le soleil pour nous diriger vers les deux pièces rudimentaires de son atelier exigu. À chaque pas, une chose en touchait une autre, se pressait contre mon coude, s’enfonçait dans mes fesses quand je m’asseyais ou dans les semelles de mes baskets quand je me tenais debout.
« Désolé pour le désordre », dit Creuzet.
...je me suis immédiatement retrouvée au bord d’un étourdissant déploiement de futurs potentiels.
Mais nous n’étions pas assis au milieu d’un désordre, et ce n’était pas non plus un miasme. Il n’y avait rien d’oppressant ni de désagréable dans l’atmosphère que beaucoup associent à un espace en désordre. L’atelier éveillait plutôt des possibles. C’est la première chose que j’ai consignée dans mes notes : comment, au lieu de me sentir mal à l’aise dans le désordre, je me suis immédiatement retrouvée au bord d’un étourdissant déploiement de futurs potentiels. Assise au milieu des piles, j’ai peut-être griffonné mes premières impressions en pensant à la profonde relecture d’Une Tempête par Aimé Césaire2. Qui définit la source de pollution dans l’atmosphère et la nature des créatures qui en émergent ? Les nantis de la terre ou ceux qui reçoivent tous les déchets rejetés vers le rivage ?
« Où as-tu trouvé toutes ces choses incroyables ? », ai-je demandé, enchantée par ce mélange de matériaux éclectiques. « Je ramasse moi aussi des choses dans la rue pour les petites icônes que je fabrique », ai-je expliqué. « Mais ma collection ne fait pas le poids face à toute cette richesse ! »
Creuzet m’expliqua que certaines choses viennent de bazars et qu’il en ramasse d’autres dans la rue. D’autres encore viennent de ses voyages. Toutes ont attiré son attention, mais pas pour une idée précise ou un projet qu’il avait en tête à l’époque.
« Bien sûr, il y en a certaines que je n’utiliserai peut-être jamais », médita-t-il.
Si je me suis sentie à l’aise dans son atelier, cela ne veut pas dire pour autant que mon expérience a été rassurante ou rédemptrice. Le monde dans son atelier n’était ni agréable ni désagréable ; ces catégories d’affects ne semblaient pas pertinentes. C’était comme si je me trouvais au milieu d’une énorme pile de faits concernant le monde contemporain. Comme si je voyais le monde depuis l’intérieur de ses décombres et déchets pendant que ces décombres et déchets se réorganisaient pour former un nouveau type d’être.
« Oui, ce sont des fictions, je crois », dit-il tandis que nous regardions certaines œuvres en cours de création qui pendaient du plafond et qui se désintégraient en partie sur le sol en béton. « Mais je m’intéresse aussi aux effets des changements environnementaux sur toute une série de choses.
Le riz, qui est une culture vivrière très gourmande en eau, disparaît parce que l’eau disparaît et ce ne sont pas tous les humains qui doivent s’adapter mais certains humains. Si la rareté du riz fait passer les prix de deux à six euros, c’est une catastrophe pour tous ceux qui en dépendent pour se nourrir. L’eau, le riz, le capitalisme génétique, les sacs en plastique qu’on utilise pour transporter la nourriture – j’utilise tous ces éléments pour communiquer l’opacité et les différences des humains, non humains, posthumains. »
Le travail de Julien Creuzet radicalise Lacan.
Plus je restais assise à l’écouter, plus j’appréciais la façon dont Creuzet avait assimilé et s’était approprié les discussions théoriques contemporaines sur l’enchevêtrement de l’existence. Il y a longtemps, Jacques Lacan a inventé le terme « extimité » en associant le ex d’extérieur et l’intimé freudien. Ceci afin d’exprimer l’étrange relation topologique entre l’intériorité psychique et l’extérieur. Au cœur de la subjectivité humaine se trouvait une boucle troublante – l’Autre est « quelque chose qui est entfremdet, étranger à moi, tout en étant au cœur de moi3. » Nous regardons fixement au-dehors afin de mieux comprendre notre être le plus intérieur. « Je suis ça », dit la femme en se regardant dans le miroir.
Le travail de Julien Creuzet radicalise Lacan. D’une part, dans la mesure où son art suggère que la substance matérielle interne de tous les êtres – pas seulement la vie psychique – est toujours radicalement extime. Les conditions de notre intégrité psychique et physique la plus intérieure se trouvent en dehors de nous. Parmi les matériaux empilés dans son atelier, glissant ou tombant des piles et parmi les œuvres qu’il était en train de coudre ensemble ou de séparer, on discernait cette étrange manière de donner à sentir un moi. D’autre part, ses œuvres nous enjoignent d’écouter et de naviguer à travers un monde d’êtres posthumains. Son atelier est un couvoir où ces nouveaux posthumains prennent forme en s’extirpant de tous les détritus et déchets de notre monde contemporain.
Dans leurs fragments et leur totalité, les œuvres de Creuzet ne deviennent pas tant des créations dont il serait l’auteur que des créatures hybrides qu’il a trouvées en train d’émerger dans ce qui a échoué sur son rivage. Si l’on s’en tient à la nomenclature conventionnelle de l’espace – les nations et les États, la terre et la mer, les colonisés et les colonisateurs –, ce rivage – ce territoire – est délimité et illimité. Délimité et illimité : c’est la coexistence de l’ouvert et du fermé qui l’intéresse.
« Je m’intéresse à la géolocalisation », dit Creuzet en employant ce terme pour décrire à la fois son processus artistique et ses intentions politiques.
Géolocalisation…
« Qu’entends-tu par géolocalisation ?
– Comme dans le cas du riz et de l’eau, à quel point les événements globaux liés au changement climatique peuvent avoir un impact local.
– Et inégal.
– Oui, bien sûr. Cela concerne la précarité de certains et ensuite de tous. »
Assis au bord de sculptures en cours de composition et de décomposition dans son atelier de banlieue, nous avons parlé de la territorialisation inégale du changement climatique global et de la toxicité du capital.
« Je cherche à créer une forme de temporalité et d’espace différente qui produirait une nouvelle manière de penser la géolocalisation. Peut-être un langage différent. »
J’ai promis à Creuzet qu’une des références intellectuelles évidentes de son œuvre ne deviendrait pas une obsession de ce texte : la poétique relationnelle d’Édouard Glissant et son concept de Tout-monde. Ce seul territoire de pensée ne suffit pas à contenir le travail de Creuzet qui rejoint une conversation internationale sur la condition posthumaine à une époque anthropocène ; la question du devenir plutôt que de l’être ; et les nouvelles formes de précarité dans le néolibéralisme. Mais pour comprendre les implications sociales de l’approche de la géolocalisation de Creuzet et le nouveau langage esthétique qu’il développe autour de ce concept, il semble important de commencer par mettre en relation ses objets relationnels avec la théorie caribéenne.
Si je devais écrire un essai académique, j’explorerais la riche lignée de penseurs de la Martinique et plus généralement des Caraïbes, parmi lesquels Aimé Césaire, C.L.R. James, Frantz Fanon et Sylvia Wynter. Mais le concept des trois relations que toutes les choses du monde entretiennent les unes avec les autres développé par Glissant – tout-monde (le monde dans son entièreté), écho-monde (le monde des choses qui résonnent les unes avec les autres), et chaos-monde (cette partie du monde impossible à mettre en ordre) – semble particulièrement pertinent pour le travail de Creuzet4. Selon Glissant, tout-monde renvoie à une forme singulière d’être-tout-ensemble qui est toujours influencée par l’écho-monde et le chaos-monde. Même si le monde entier nous inclut tous, ce n’est qu’à travers un « toi et moi » ou « nous et vous tous » (une deuxième personne du pluriel prononcée avec l’accent du sud des États-Unis) plutôt que le « nous » global. L’intérêt de cette autre manière de constituer l’unité d’un monde unique semble évident quand on voit la façon dont de nombreux universitaires, scientifiques et politiciens abordent la catastrophe imminente du changement climatique – nous vivons un moment historique ; notre fin n’est peut-être pas encore venue mais elle se rapproche. Nous ne pouvons nier que le changement climatique et les déchets toxiques du capitalisme sont un problème global ; notre problème. Mais là où il a déjà frappé et avec quelle force – ce qui a déjà été rejeté sur le rivage – ne l’est pas ; c’est un problème entre toi et moi.
C’est l’aspect fondamentalement relationnel de la puissance et de la politique mondiales qui a motivé l’engagement de Glissant avec ses amis Gilles Deleuze et Félix Guattari. Tous trois ont commencé « au milieu », là où vivent les figures du rhizome et du nomade5. Mais Glissant situe ce prémisse philosophique sur le territoire et dans l’histoire politiques du colonialisme. Le nomade, affirme Glissant, se décline selon une multiplicité de modes, les deux principaux étant le nomadisme circulaire et le nomadisme en flèche. Son approche quelque peu romantique des communautés indigènes sous-tend son concept de nomadisme circulaire. « Ainsi du nomadisme circulaire : il vire à mesure que des parts de territoire sont épuisées, sa fonction est de garantir par cette circularité la survie d’un groupe. Nomadisme des peuples qui se déplacent dans les forêts, des communautés arawaks qui naviguaient d’île en île dans la Caraïbe, des engagés, agricoles qui pérégrinent de ferme en ferme, des gens du Cirque tournant de village en village, tous mus par un mouvement déterminé où ni l’audace ni l’agression n’ont de part. Le nomadisme circulaire est une forme non intolérante de la sédentarité impossible6. » S’oppose à ce mode rhizomique le nomadisme en flèche (ou nomadisme envahisseur) du colonialisme européen. Les Huns, par exemple, ou les conquistadors ont perfectionné un « nomadisme envahisseur » dont le but était de « conquérir des terres, par extermination de leurs occupants7 ». Sorte de messagers aux avant-postes d’une épidémie galopante dont ils se pensent immunisés, « les conquérants sont la racine mouvante et éphémère de leur peuple8 ». Leurs adeptes s’enracinaient dans le paysage calciné, s’en proclamant propriétaires, le clôturant et le réifiant à travers une nouvelle forme de conquête – la conquête de la culture privée.
Glissant ne s’adressait pas seulement à Deleuze et Guattari mais tissait une relation entre eux et son professeur, Aimé Césaire, qui dans Discours sur le colonialisme affirmait que si « mettre en contact différentes civilisations est une bonne chose » la colonisation n’a jamais consisté à établir un contact, seulement à dominer les peuples, les terres et les choses9. En d’autres termes, Glissant mettait en relation la pensée philosophique et politique de Césaire, Deleuze et Guattari afin de créer un nouveau langage de l’espace, de la politique et de l’histoire.
Je griffonnais ces notes en écoutant Creuzet parler de l’arrivée de sa famille en France ; de l’économie politique des Caraïbes françaises ; de la répartition inégale des poisons industriels ; des différences entre les formes de revendications d’une identité noire aux États-Unis et en France. L’espace, la politique et l’histoire : moi et toi ensemble et je/nous ici et toi là-bas. Pendant cette matinée, nous avons parlé de la façon dont, oui, nous sommes tous de plus en plus confrontés à la précarité du capital néolibéral, à l’énormité du changement climatique, à la montée de l’intelligence artificielle. Mais nous n’y sommes pas tous confrontés de la même manière, au même degré ou avec le même avenir. Nous sommes situés par la géographie, l’histoire, le capitalisme, la race, le genre et le colonialisme, pour ne nommer que quelques technologies sociales.
« Lorsque j’étais en résidence à la Rebuild Foundation à Chicago, j’avais l’habitude de dire que je venais de la Martinique. Étant de la Martinique, je vis le fait d’être noir très différemment. C’est une partie de la France mais la France européenne est à 6 500 kilomètres. Et en France, contrairement aux États-Unis, l’idée d’égalité, de fraternité et de liberté rend parfois difficile de parler du fait d’être noir. C’est un cliché mais il existe. Je suis français parce que la Martinique est un département français et/mais je suis néanmoins martiniquais. Mes émotions viennent de la Martinique. J’ai grandi là-bas. Mais nous sommes aussi français, donc mes parents, mes oncles et une grande partie de ma famille sont venus travailler en France dans le cadre de la racisation des économies et des économies de la race. »
La France était confrontée à un profond conflit politique quant au fondement de la citoyenneté et de la territorialité françaises.
Embaucher des travailleurs français caribéens, notamment dans le domaine de la santé en France métropolitaine, convenait à plusieurs logiques politiques et économiques. Alors que les années 1960 ont été le théâtre d’une immigration plus ou moins laissée sans contrôle, des politiques plus strictes ont été mises en place au milieu et à la fin des années 1970. Il faut rappeler que cette même période a vu la montée de ce que nous appelons maintenant le néolibéralisme – une forme d’emploi flexible et précaire que Michel Foucault décrivait aussi comme une biopolitique et un capitalisme-anarchie dans ses cours du Collège de France (1972-1973) depuis Il faut défendre la société jusqu’à Naissance de la biopolitique. Les Caribéens ont servi les vues du nationalisme politique dans la mesure où des personnes comme les parents de Creuzet, qui n’étaient pas à strictement parler des migrants, pouvaient se voir imposer des conditions de travail flexibles, c’est-à-dire précaires, et des emplois moins bien rémunérés.
Comme le notent Stéphanie Condon et Philip Ogden, l’arrivée de la famille de Creuzet faisait plus largement partie d’une longue période de politique et d’économie de la migration caribéenne influencée par le succès de la lutte pour l’indépendance algérienne10. La France était confrontée à un profond conflit politique quant au fondement de la citoyenneté et de la territorialité françaises. Où était la France ? Qu’est-ce qui définissait un Français ?
Né en France en 1986, Creuzet a grandi en Martinique. Tandis que ses parents envisageaient d’émigrer en France pour travailler dans les services de santé, Condon et Ogden signalent que plus de 122 000 personnes nées en Guadeloupe et en Martinique vivaient en France en 1982, pour la plupart des immigrants plus jeunes ou d’âge moyen.
Assise avec Creuzet, entourée par ces monticules de déchets en guise de trésor, je ne pouvais pas m’empêcher de penser aux images d’un reportage de la BBC que j’ai lu en ligne en 2018 intitulé « Les Caraïbes envahies par une masse géante de déchets plastique ». Les journalistes sont des créatures rusées ; ils passent au crible les déchets à la dérive à la recherche de juxtapositions étonnantes. Dans ce cas précis, un fantasme américain et européen de « l’échappée caribéenne » dont on fait partout la publicité et une marée d’horribles coagulations, des préservatifs, de la ficelle, de vieux habits, des bouteilles d’eau en plastique, des bouteilles de Coca, et ainsi de suite. Au lieu de s’interroger, on s’indigne face au courant des marées.
Le travail de Creuzet ne néglige pas cette indignation morale mais ce n’est pas non plus ce qui le définit. En parlant, il embrassait l’histoire de ses affects et de son esthétique. (« Mes émotions viennent de Martinique. J’ai grandi là-bas. ») Mais il insistait aussi sur le fait qu’on ne peut comprendre cette histoire qu’en sondant les intersections étranges des passés et des futurs qui se superposent à un endroit.
Creuzet m’a généreusement fait écouter des pistes audio de son exposition au Palais de Tokyo ainsi que de nouvelles pièces sonores sur lesquelles il travaillait. « J’enregistre une nouvelle chanson pour le chlordécone. »
Je voyais à quoi il faisait référence car ma collègue à l’université de Columbia, Vanessa Agard-Jones, avait étudié les effets des pesticides perturbateurs endocriniens comme le chlordécone (ou Képone) sur le genre et la sexualité en Martinique11. L’entreprise américaine Allied Signal Company a commencé à produire du chlordécone dans les années 1950 dans son usine de Hopewell, en Virginie. Ce produit chimique a été interdit aux États-Unis et en France après un incident environnemental en 1970, mais des groupements de planteurs en ont entreposé en Martinique et en Guadeloupe. Le chlordécone a été interdit en métropole en 1990 mais sous la pression de ces puissants blancs locaux, békés, une disposition spéciale inscrite dans la loi a permis de l’utiliser aux Antilles jusqu’en 1993. Cet intervalle a augmenté les niveaux de pathologies physiques (le cancer de la prostate, par exemple) ainsi que les soi-disants anomalies (les naissances intersexes, par exemple). Et ces corps – nés en dehors du corps-avec-organes et se confrontant à une bionormativité angoissante – produisent en retour une politique qui se trouve au croisement matériel d’une vulnérabilité charnelle et de son héritage chimique.
J’ai parlé du travail de Vanessa à Creuzet parce que, comme les recherches de Vanessa, ses sculptures et installations me font penser à la fois à la répartition spatiale des terrains vagues précaires et aux créatures résilientes qui en émergent ; à la fois au fait que ces créatures ont déjà émergé des conditions injustes du Tout-monde et qu’elles pourraient bien être l’espèce qui succède à cette injustice.
De quel langage avons-nous besoin pour cet étrange nouveau monde qui n’est ni si nouveau ni si étrange pour de nombreuses personnes vivant déjà le long de ses rivages ?
Un nouveau langage des choses…
Le travail de Creuzet est riche d’une poétique du langage et du langage de la poésie. Pour pleinement saisir la géolocalisation de son « aquart-terrart » – les nœuds singuliers qu’il fait apparaître au sein des réseaux mondiaux et des géographies d’animaux et de choses humaines et non-humaines – il faut se plonger dans les nouveaux sons et langages des choses qu’il fait éclore.
J’ai écouté certaines de ces pièces sonores dans son atelier après avoir discuté, visité les piles, senti et touché l’espace. Les chansons agencent différentes langues (anglais, français, tchèque), différents genres et, s’il enregistre sa chanson du chlordécone, différents êtres.
« Comment choisis-tu la langue dans laquelle tu enregistres ?
– La langue dépend de l’endroit où je me trouve. Par exemple, quand j’étais à la biennale de Gwangju, j’ai écrit de la poésie en coréen. »
...les sculptures de Creuzet restaient des enchevêtrements posthumanistes de matériaux que bien des spectateurs humanistes trouveraient sans doute discordantes.
Mais à l’instar de l’ancrage émotionnel de son travail, les aspects poétique et acoustique des œuvres de Creuzet sont étroitement liés aux conditions locales qu’il connaît le plus intimement – tout en faisant référence aux histoires globales complexes et parfois paradoxales qui ont créé ces conditions. Je suis ça. C’est moi. Quels langages nous faut-il si nous devons habiter les relations internes que chacun entretient avec les autres au sein de notre condition actuelle posthumaine, néolibérale, néocoloniale ?
J’ai entrevu certaines réponses à ces questions dans l’exposition de Creuzet au Palais de Tokyo. Elle était bien mieux tenue que son atelier, chaque chose à sa place. Dans la galerie principale, les sculptures de Creuzet restaient des enchevêtrements posthumanistes de matériaux que bien des spectateurs humanistes trouveraient sans doute discordantes. Dans son travail, le posthumain est postorganique, polytechnique et esthétiquement hybride – son usage de matériaux organiques et inorganiques ne signale aucune différence hiérarchique ; il accorde le même statut à différentes technologies artistiques (la vidéo, la peinture, la couture, la gravure, la plomberie) ; et les déchets sont tissés dans tous les objets. Mais chaque sculpture avait son indépendance. Il était possible de distinguer une sculpture d’une autre alors même que chacune était un multiplexe de plans plats, d’objets verticaux et horizontaux fixes ou tournant légèrement, souvent assortis sur un écran plat d’une vidéo d’un danseur. J’ai observé les visiteurs se déplacer d’une œuvre à une autre, comme je l’ai moi-même fait. Les sols de la galerie étaient balayés. Le paysage sonore, riche, fascinant, constituait un supplément parfait au vieux sens de la déconstruction. Une des vidéos de Creuzet intitulée Head-to-head, hidden head, Light (2017) était diffusée dans une black box plus petite.
Toutefois la discipline spatiale imposée par l’institution n’a pas diminué l’expérience que j’ai vécue dans l’atelier surpeuplé de Creuzet ; elle marquait simplement une phase différente des êtres émergents que Creuzet produit ; elle a simplement peut-être changé où, et comment, un spectateur a perçu le clignotement entre l’opacité et la clarté de l’existence contemporaine. En ramenant leurs entrailles dans leurs sacs corporels, les œuvres signalaient et rejetaient la composition de leurs ancêtres perdus – l’harmonie bizarre de chaque pièce. Ici, un collage de tissus organiques et plastique, de vieux vêtements grossièrement cousus ensemble sur un établi d’un jaune vif ; là du papier, du tissu, une vidéo et tout ce qui pouvait s’accorder (ou non), enfermés dans une fine gaine en plastique et que rassemblaient de vulgaires tuyaux en aluminium ; et là-bas des éclairages LED, des dessins et des poèmes incorporés dans des cordes et des fils ; une réalité virtuelle qui conférait à toute l’expérience une atmosphère surréaliste.
L’intégrité évidente de chaque pièce et leur nature ouvertement posthumaine, postorganique font voler en éclats le langage et les catégories si essentiels à la connaissance occidentale : la vie et la non-vie, l’organique et l’inorganique, ce qui se meut et ce qui est mu. Qu’est-ce que l’intégrité si elle ne se définit plus comme « ne pas être gâché ou violé ; condition intacte ou inaltérée ; état d’origine parfait ; sain12 » ?
L’exposition de Creuzet au Palais de Tokyo était une expérience acoustique autant que visuelle.
Non pas que le langage en soit absent. Autour du principal ensemble d’œuvres montré au Palais de Tokyo se trouvaient des bancs industriels en pin sur lesquels étaient gravés des mots dans une police de caractère qui évoquait Hoefler, mais je ne suis pas typographe. Les visiteurs qui s’y asseyaient ou y posaient leurs sacs et appareils photo masquaient certains mots. La fonction de ces bancs était double : permettre aux gens de s’assoir et d’appréhender l’entièreté des œuvres, depuis les mots dans le bois et sur les murs, mais aussi de faire partie de l’installation. Les mots gravés dans le bois appartenaient à des généalogies dispersées et variées, ils semblaient sémantiquement évidents et, en fin de compte, à mes yeux, indécidables. Pinta – une tache ou une marque en espagnol, mais qui veut également dire scandaleux et imprudent, et qui désigne aussi une maladie de peau humaine causée par un spirochète impossible à distinguer de l’organisme qui provoque la syphilis et que l’invasion espagnole a amené en Amérique. Capitaine – un terme militaire français et un autre nom pour la perche du Nil. Aquart – que j’ai compris comme une poétique des océans. Paul Lemerle – dont j’espérais qu’il faisait peut-être référence à Félix Lemerle, le guitariste de jazz qui a composé Blues pour la fin des temps, mais, encore mieux, désigne probablement Paul Lemerle, le byzantiniste français. Perle – à la fois l’histoire de la perle asservie qui divise les Caraïbes, la plus grande tentative connue de fuite non violente dans les Amériques et les émeutes brutales menées par les blancs pro-esclavagistes qui ont suivi.
À première vue, certaines références semblaient revendiquer un sens clair. Clotilda – une goélette, qui fut le dernier navire négrier à amener des captifs depuis l’Afrique jusqu’aux États-Unis, arrivée dans la baie de Mobile en 1859 avec à son bord 110 ou 160 hommes, femmes et enfants d’Afrique de l’Ouest réduits en esclavage. Erika – la puissante tempête tropicale qui a touché les Caraïbes au début de l’automne 2015.
Mais quelle est l’intégrité de ces termes si on les considère comme des choses, et les choses comme des sortes d’êtres toujours en devenir, dont les entrailles sont à la fois à l’intérieur et en dehors d’eux ? Si les sculptures sont les organes internes de l’exposition et les planches sa peau, alors de cette peau transpirent des vérités à moitié digérées. Quand a navigué le dernier navire négrier ? Est-il faux de dire que l’esclavage noir existe encore, que l’esclavage martiniquais existe encore ? J’imagine que suggérer de telles choses n’est pas correct. Alors il nous faut peut-être un nouveau vocabulaire des choses. Quel est le nom et la forme du navire qui inverse la direction du trajet mais qui maintient en place les logiques raciales de captation du travail ?
Qu’y a-t-il entre la France comme idéal de liberté pour tous les humains et l’histoire de son intervention dans les Caraïbes noires ?
...des pièces sonores de Creuzet travaillent une zone intermédiaire hypnotique entre sens et affect.
Comme son approche du langage, la plupart des pièces sonores de Creuzet travaillent une zone intermédiaire hypnotique entre sens et affect. Sa vidéo dans la black box au Palais de Tokyo en est un bon exemple. Ce montage d’images provenant d’une encyclopédie des traditions et coutumes d’Afrique est du pur Creuzet, s’il est possible d’utiliser un tel adjectif pour un artiste aussi jeune. La caméra se déplace sur des images ethnographiques, son projecteur allumé les déformant afin de révéler les influences coloniales de cette forme de capture artistique. Ces images se mêlent à des scènes de musique électro-danse, produisant une poétique de l’oubli et du souvenir enregistrés. Sur une image, l’ombre d’une main parcourt les crédits ethniques d’une photo, les bandes Technocolor d’un vieux film tournent à l’arrière-plan. Et, par-dessus tout, une sorte de généalogie de ce qui se dissimule et se révèle :
Head-to-head, hidden head
Light, Head of Songhay
Light, Head of Jerma
Head-to-head, hidden head
Light, Head of Hausa
Head-to-head, hidden head
Light, Head of Moors13.
« Je m’intéressais à ce que les personnes présentes sur ces images faisaient le week-end ou un jour normal. Et je m’intéressais à la relation entre le mouvement et la purification – de la même manière que vous époussetez une imprimante pour obtenir une image nette, danser et bouger le corps le nettoie, le maintient en bonne santé pour un nouveau type de fertilité, d’histoire. »
Cette manière d’inscrire la politique, la théorie et l’esthétique caribéennes dans les géolocalités contemporaines comporte une seconde portée que j’ai déjà évoquée, à savoir une forme de temporalité à l’œuvre dans sa pratique sonore et visuelle qui se sert de devenirs passés et futurs pour remanier une approche sensorielle immersive. Quant à la fin du monde, Creuzet rejoint de nombreux autres artistes insistant sur le fait que pour les misérables de la Terre, la fin est venue et revenue et revenue encore bien des fois. Sur ce point, les singularités de la généalogie de Creuzet incorporent et se déplient en dehors d’une politique et d’une esthétique spécifiques du posthumain. Le posthumain parcourt la terre depuis longtemps. Écoutez la lutte de l’Ogoni Ken Saro-Wiwa contre le désastre froid et cruel du pacte politico-économique passé entre Royal Dutch Shell et l’État nigérian. Écoutez sa fille, Zina Saro-Wiwa, qui explore par des biais artistiques les conditions néocoloniales des économies et des politiques alimentaires contemporaines14. Écoutez Will Wilson, photographe diné qui a grandi dans la nation navajo et dont le travail interroge les héritages extimes psychiques et matériels des tests et infrastructures nucléaires. Il s’agit selon ses propres termes, d’« une série d’œuvres intitulée Auto Immune Response, autour de la relation chimérique entre un homme postapocalyptique diné (navajo) et l’environnement terriblement beau mais toxique qu’il habite15 ».
Nous sommes restés assis dans son atelier, écoutant différentes compositions sonores au milieu des être sculpturaux provisoires et des piles de matériaux récupérés qui pourraient devenir un de leurs éléments internes si tant est, comme le fait remarquer Creuzet, qu’ils survivent.
« Je ne sais pas si je vais continuer à travailler sur certains ou bien les défaire à nouveau. »
Je n’avais pas l’impression de regarder ou d’écouter des métaphores du temps, de l’histoire humaine, de l’histoire caribéenne, mais plutôt d’être dans l’environnement actuel, bien que fictif, dont certains êtres plus que d’autres font déjà partie, plastique, corde, fil, clips vidéo intégrés et images griffonnées à moitié claires. Une jouissance mélancolique emplissait l’espace, ni apocalyptique ni rédemptrice. Simplement là. Simplement vraie. Pas moins politique pour autant.
Intitulée Les lumières affaiblies des étoiles lointaines les lumières à LED des gyrophares se complaisent, lampadaire braise brûle les ailes, sacrifice fou du papillon de lumière, fantôme crépusculaire d’avant la naissance du monde (…) c’est l’étrange, j’ai dû partir trop longtemps le lointain, mon chez moi est dans mes rêves-noirs c’est l’étrange, des mots étranglés dans la noyade, j’ai hurlé seul dans l’eau, ma fièvre (…) l’exposition a été présentée du 20/02 au 12/05/2019.
Aimé Césaire, Une Tempête, Le Seuil, Paris, 1969.
Jacques Lacan, Le Séminaire, Tome VII, L’Éthique de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1986, p. 87.
Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990.
Dont on trouve une représentation célèbre dans Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux : capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1980.
Édouard Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 24.
Idem.
Ibid, p. 26.
Voici la citation complète : « J’admets que mettre les civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien ; que marier des mondes différents est excellent ; qu’une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s’étiole ; que l’échange est ici l’oxygène, et que la grande chance de l’Europe est d’avoir été un carrefour, et que d’avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d’accueil de tous les sentiments en a fait le meilleur redistributeur d’énergie. Mais alors, je pose la question suivante : la colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ? Ou, si l’on préfère, de toutes les manières d’établir le contact, était-elle la meilleure ? Je réponds non. » Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Éditions Présence Africaine, 1955, p. 66.
Voir Stéphanie A. Condon et Philip E. Ogden, « Emigration from the French Caribbean: the Origins of an organized Migration », Journal of Urban and Regional Research, 15.4.1991, p. 505-523.
Vanessa Agard-Jones, « Spray. Commonplaces: Itemizing the Technological Present », Somatosphere, mai 2014.
Oxford English Dictionary, seconde édition, 1989.
Julien Creuzet, Head-to-head, hidden head, 2017.
Nomusa Makhuby, « The Poetics of Entanglement in Zina Saro-Wiwa’s Food Interventions », Third Text, 2018, p. 176-199.