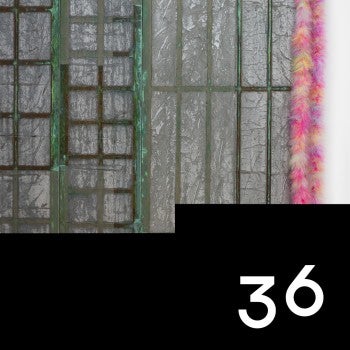Bertille Bak, vit et travaille à Paris. Elle développe depuis plus d'une décennie une pratique centrée sur l'observation des sociétés, la compréhension de l'organisation entre les individus, la mise en évidence de leurs histoires personnelles et collectives, de leurs traditions et folklores, de leurs hobbies et révoltes. Travaillant en collaboration avec des groupes communautaires, elle construit des récits entre fiction et documentaire où la poésie et les utopies usurpent la simple évaluation d'une situation ou d'un site.
Un cri jaillit de l’obscurité. Puis un appel, suivi par d’autres, se succédant. Des voix humaines, semble-t-il, se rejoignent pour s’élever en chœur. Glapissements, chants, cris ou jappements semblent surgir de tous côtés. Un vacarme emplit l’air et le délimite, l’enfermant, comme une bête piégée dans les bois. L’obscurité se dissipe, et le film s’ouvre sur le visage d’un jeune homme. Il ferme un œil, comme s’il grimaçait, puis cligne des yeux à plusieurs reprises. Il porte une casquette de baseball orange vif, la caméra se fixe sur lui, en gros plan. Une autre coupe, et un autre homme, portant une casquette de chasseur en fourrure, avec des rabats d’oreilles, apparaît à l’écran, affichant la même grimace. Coupe de nouveau, suivie d’un autre gros plan sur un autre homme similaire, cependant plus âgé. La caméra opère un zoom arrière, et on aperçoit les trois hommes assis sur un banc dans un champ enneigé. Forment-ils une famille ? Ont-ils froid ? Qu’attendent-ils ? Ils portent les mêmes vêtements étranges, une sorte de tablier en peau d’ours avec une garniture orange vif. Ils se tournent, brandissent respectivement trois fusils, arment leurs canons et visent quelque chose situé hors cadre. Des cornes de brume retentissent tandis que le générique apparaît à l’écran, il s’agit d’un film de Bertille Bak, Le hameau, tourné en 2014 dans un village alpin de chasseurs. Du moins, c’est ce que je crois comprendre.
Tout au long du film, le public est témoin, comme des mouches sur un mur, d’autres scènes de la vie de ces personnes. Nous assistons à un festin, des plaisanteries et d’autres scènes quotidiennes sans doute banales pour eux, mais vraisemblablement pas pour nous. Nous observons par exemple deux hommes couper des sabots prélevés sur un tas de membres de sangliers. Préparent-ils ces parties animales pour la réalisation d’une soupe ? Ou pour fabriquer des porte-bonheur ? Quelques instants plus tard, un homme saisit un appareil artisanal. Celui-ci s’apparente à une sorte d’extension que l’on pourrait fixer sur une paire de chaussures normales ; cependant, l’homme fixe l’un des sabots coupés sur cette semelle de chaussure en forme de sabot. S’agit-il d’un crampon pour la neige, ou d’autre chose encore ? J’en déduis plus tard qu’il sert à déposer des traces d’animaux comme autant de leurres afin d’attirer, de détourner ou éventuellement d’induire en erreur des proies, ou du moins c’est ce que je crois.
...doit-on s’intéresser à l’effet d’une œuvre d’art sur le public pour découvrir son pouvoir éthique, voire socialement opportun ?
Bien que Le hameau s’apparente à une tendance croissante dans l’art contemporain de ces dernières années vers une sorte de film-essai observationnel, ici en mode didactique minimal (catégorie à laquelle Lydia Ourahmane et Jumana Manna pourraient également répondre), le film n’est pas d’un documentaire au sens traditionnel du terme. Peu de détails nous sont fournis, et pas davantage de contexte. Ni voix off, ni intertitres, ni interviews ou autres, à l’exception de quelques interventions magiques réalistes de la part de la réalisatrice — par exemple, une ligne orange clignotante de type science-fiction ajoutée à la scène en post-production, qui m’aide à déduire que le chasseur dessinait comme une fausse piste avec ses chaussures mécaniques en forme de sabots.
Nous, public, devons surtout épier leurs actions et tirer nos propres conclusions sur l’identité de ces personnes et, par conséquent, nous demander pourquoi nous regardons ce film. Pour nous divertir ? Pour ajouter à notre connaissance ? Ou pour nous découvrir une sorte de lien avec ces individus ? Ou encore, est-ce à des fins d’activisme, par exemple pour défendre les communautés isolées et préserver leur mode de vie en créant des liens entre elles et le monde extérieur ? Cela soulève une question de nature relationnelle : si l’art peut remplir une certaine fonction sociale, doit-on la mesurer en observant uniquement l’œuvre d’art en tant que telle, c’est-à-dire en portant un jugement esthétique sur ce qui est formellement présenté dans l’œuvre elle-même ? Ou doit-on s’intéresser à l’effet d’une œuvre d’art sur le public pour découvrir son pouvoir éthique, voire socialement opportun ? Quelle est donc l’utilité morale de l’art narratif en général et, plus spécifiquement, quelle éthique proposent des œuvres telles que celles de Bertille Bak, artiste qui, comme dans le cas du hameau ainsi que dans plusieurs autres films, présente non seulement la vie rurale, mais aussi la vie des mineurs, des membres de la communauté rom et d’autres personnes traditionnellement en marge de la société ?
Dans son essai de 1996, intitulé « L’artiste comme ethnographe ?1 », l’historien de l’art américain Hal Foster a formulé une critique de ce qu’il appelle le « tournant ethnographique » dans l’art contemporain. Selon Foster :
Je m’intéresse plutôt à l’émergence d’un nouveau paradigme structurellement similaire à l’ancien modèle de « l’auteur comme producteur » dans l’art progressiste de gauche : l’artiste comme ethnographe. Au sein de ce nouveau paradigme, l’objet de la contestation reste pour l’essentiel l’institution artistique bourgeoise-capitaliste (le musée, l’académie, le marché et les médias), ses définitions discriminatoires de l’art et de l’artiste, de l’identité et de la communauté. Mais le sujet de la solidarité a changé : désormais c’est au nom de l’autre (culturel et/ou ethnique) que l’artiste engagé se bat le plus souvent. Aussi subtil qu’il puisse sembler, ce glissement d’un sujet défini en termes d’identité culturelle est significatif. Il faut pourtant repérer les parallèles entre ces deux paradigmes car des postulats de l’ancien modèle productiviste persistent, parfois de façon problématique, dans le nouveau paradigme ethnographique. Tout d’abord l’idée que le lieu du changement politique est également celui du changement artistique, et que les avant-gardes politiques situent les avant-gardes artistiques et, dans certaines circonstances, s’y substituent. […] Le deuxième postulat veut que ce lieu est toujours ailleurs, dans le domaine de l’autre — dans le modèle du producteur, où l’altérité est de nature sociale, il s’agit du prolétariat exploité ; dans le paradigme de l’ethnographe, où elle est culturelle, il s’agit du postcolonial, du périphérique, du sous-culturel opprimé — et que cet ailleurs, cet exclu, est le point d’appui d’Archimède à partir duquel la culture dominante sera transformée ou du moins subvertie. Selon le troisième postulat, l’artiste qui n’est pas considéré comme socialement et/ou culturellement différent ne peut avoir qu’un accès limité à cette altérité transformatrice et, inversement s’il est considéré comme différent, il y a automatiquement accès. Conjuguée, ces trois hypothèses pourraient bien mener l’artiste ethnographe à l’écueil du « paternalisme idéologique » dénoncé par Benjamin2.
Foster poursuit :
Ceci est typique du scénario quasi-anthropologique. Peu des principes ethnographiques qui régissent la relation entre participant et observateur sont respectés, encore moins critiqués, et la participation de la communauté est très limitée. Presque naturellement, le projet dérive d’une collaboration vers une forme de remodelage de soi, de la prise de distance de l’artiste en tant qu’autorité culturelle vers une reconstruction de l’autre sous un déguisement néoprimitiviste3.
Au cœur de l’argument de Foster on retrouve l’idée que l’institution artistique est le principal moteur de ce « tournant ethnographique », qui, pour employer un langage plus contemporain, initie une forme de « performativité » dans laquelle une œuvre d’art devient un instrument par lequel, au mieux, une élite prétend parler au nom des personnes marginales, et, au pire, prétend que cela vient atténuer leur détresse. Si la critique émise par Foster demeure valable pour d’innombrables œuvres d’art institutionnalisées, le travail de Bak ne correspond pas au scénario qu’il propose.
Issue elle-même d’une communauté de mineurs de fond, il n’est pas surprenant que Bak ait produit plusieurs films avec des communautés similaires ; elle ne parle pas en leur nom, elle parle avec elles. Dans le cas de communautés qui ne sont pas les siennes, Bak passe plus d’un an à leurs côtés afin de documenter leur vie, contrairement à l’artiste imaginé par Foster. Pourtant, l’affirmation de Foster selon laquelle « la participation de la communauté est très limitée » reste valable pour cet auteur typique qui n’a pas pu bénéficier d’un véritable accès, ainsi que pour presque l’ensemble du public de n’importe quel film. Il ne serait pas non plus juste d’avancer que n’importe quel membre d’une communauté est susceptible de la représenter dans son ensemble. Cela soulève la question suivante : est-il même vrai qu’un accès étendu à une communauté puisse jamais légitimer une position d’autorité ?
Quoi qu’il en soit, la critique de Foster, qui se présente comme une question rhétorique, cache une préoccupation plus importante que la question de l’artiste en ethnographe, à savoir l’hypothèse « productiviste » selon laquelle le site de la transformation artistique est celui de la transformation politique. Cette « hypothèse » est pour ainsi dire vraie si l’on considère que « la politique » est définie de manière étroite comme une forme d’agent instrumental qui opère un « véritable changement » dans le monde, avec des résultats mesurables, qu’ils soient économiques, sociaux ou autres. Peut-être qu’au lieu de penser que la dimension « politique » de l’art narratif ne peut être prouvée que par une relation de cause à effet — dans laquelle le fait de regarder un film sur telle ou telle communauté entraîne un changement, pour le meilleur ou pour le pire, au sein de cette même communauté — nous devrions plutôt envisager l’idée selon laquelle l’art initie un changement personnel, voire interpersonnel, chez le spectateur ou la spectatrice. Ou encore, formulé autrement, l’art produit une notion différente de la « politique » qui dépasse la simple signification normative de la gouvernance.
On peut avancer que l’art aide les gens à donner sens à leur propre existence. Savoir ce que quelqu’un ou quelqu’une d’autre a vécu peut s’avérer instructif pour votre propre expérience, en particulier lorsque cette expérience est nouvelle. L’art, pour le formuler autrement, aide les gens à prendre connaissance non seulement de la vie des autres, mais aussi de leur propre existence. Prenons par exemple la lecture d’une œuvre de fiction ; pour les besoins de l’argumentation, considérons un livre que j’ai lu dans les premiers jours de la pandémie de covid-19, Le Décaméron.
Suite à une intense vague de peste qui venait de déferler sur Florence en 1348, l’écrivain et poète italien Giovanni Boccaccio écrit Le Décaméron. Ce recueil de contes est constitué d’une « histoire-cadre » dans laquelle sept jeunes femmes et trois jeunes hommes se réfugient dans une villa isolée pour pratiquer pendant deux semaines ce que l’on appelle aujourd’hui la « distanciation sociale », à l’écart d’une ville ravagée par la peste. Ce qui suit est un jeu : à l’exception des journées, réservées aux corvées, chaque personne est priée de raconter une histoire par nuit, de sorte qu’au cours des dix jours, cent histoires seront racontées pour passer le temps. Le fait est qu’il existe un contexte plus étendu qui dépasse le cadre même de cette mise en scène des divertissements sociaux.
Une pandémie ravageait Florence, et les liens sociaux s’effaçaient ; selon Boccace, « ce fléau avait implanté une telle terreur dans le cœur des hommes et des femmes que les frères abandonnaient leurs frères, les oncles leurs neveux, les sœurs leurs frères [...] pères et mères refusaient d’allaiter et d’assister leurs propres enfants ». Tout comme alors, nous vivons une époque marquée par un fléau invisible qui met tout le monde en danger. Et si les récentes découvertes médicales nous aident à combattre le virus en tant que tel, une grande sagesse nous parle depuis le passé. Boccace lui-même est un survivant, et si sa prescription d’isoler le corps est toujours valable, son idée de rendre l’esprit joyeux en période de grand malheur est plus que jamais d’actualité. Contrairement aux interminables reportages sur les effets du coronavirus sur le corps ou sur ce que l’on peut faire pour lutter contre ces menaces, ce que je retiens du Décaméron, c’est qu’un groupe a fait naître un élan de solidarité en réponse à une grande vulnérabilité, et que le livre nous apprend comment faire face aux circonstances actuelles en partageant nos histoires les uns et les unes avec les autres. Il s’agit bien sûr de fiction, mais cette manière d’apprendre peut-elle être étendue aux représentations artistiques de personnes vivantes ?
Alors qu’il tentait de répondre à la question de la pertinence sociale de l’art narratif au-delà du simple compte rendu des faits, le philosophe américain et spécialiste du cinéma Noel Carroll a écrit ce qui suit :
C’est une chose de dire que les routes de Mumbai sont massivement surchargées, c’en est une autre de recevoir une description détaillée d’incidents qui viennent l’illustrer, dépeints avec émotion et perspicacité. La première présente le fait et la seconde en suggère la saveur. La première vous dit que les rues sont encombrées, la seconde vous donne une idée de ce qu’est en réalité cet encombrement. Le critique éthique, ou du moins certains critiques éthiques, répondent donc aux sceptiques en admettant en premier lieu que la connaissance propositionnelle disponible dans l’art est souvent triviale ou n’est que platitude ; l’art ne rivalise pas avec la science, la philosophie, l’histoire ou même le journalisme pour ce qui est de fournir un « savoir de ». Mais ce n’est pas le seul type de connaissance qui existe. Il y a aussi la « connaissance de ce que serait un tel ou une telle » […] De plus, ce type de connaissance est particulièrement pertinent pour le raisonnement moral. L’imagination a sa place dans l’examen des différentes directions que peuvent prendre le cours de l’action.
Prenons le temps de réfléchir. Carroll note que l’art narratif n’est pas simplement un moyen de décrire les faits attachés à une situation, c’est également un moyen d’ouvrir sa perception au ressenti de ces conditions. De plus, il s’agit tout autant de produire une image contextuelle suscitant ces émotions. Au lieu d’invoquer l’empathie, c’est-à-dire la capacité à projeter ses émotions dans celles d’autrui, Carroll propose de présumer une capacité spéculative différente permettant d’envisager « différentes directions que peut prendre le cours de l’action ».
À partir de ses « Conférences sur la philosophie politique de Kant », la philosophe et politologue allemande Hannah Arendt offre une vision antérieure de cette capacité projective :
Le penser critique n’est possible que là où les points de vue de tous les autres sont ouverts à l’examen. C’est pourquoi le penser critique, qui est pourtant une affaire solitaire, ne se coupe pas de « tous les autres ». Il poursuit assurément son chemin dans l’isolement, mais, par la force de l’imagination, il rend les autres présents et se meut ainsi dans un espace public potentiel, ouvert à tous les points de vue ; en d’autres termes, il adopte la position du citoyen du mode kantien. Penser avec une mentalité élargie veut dire qu’on exerce son imagination à aller en visite4.
Comme Carroll, Arendt invoque l’imagination comme un moyen d’accéder au point de vue d’un autre afin d’envisager le monde à travers ses yeux ; cependant, Arendt l’adopte comme un moyen de faire progresser la pensée critique. Son idée de la projection ne consiste pas à ressentir ce que « quelqu’un d’autre ressent », mais à essayer de penser ce que quelqu’un d’autre pense afin de savoir pourquoi il prend les décisions qu’il prend. Cette méthode ne vise pas à justifier ses actions, mais à comprendre pourquoi une certaine ligne de conduite a été adoptée préférablement à une autre. En écho à Carroll, cela permet d’imaginer de quelle manière les autres agissent, mais cela laisse également la possibilité de considérer comment une autre ligne de conduite aurait pu être simultanément adoptée. Plus que la seule empathie, la « mentalité élargie » d’Arendt présente une forme de pensée représentationnelle qui dessine une image, une sorte de « tableau du monde », pour ainsi dire, à partir de la vie des gens, afin que quelqu’un ou quelqu’une d’autre puisse essayer d’imaginer leur vision du monde.
[Bak ouvre] une fenêtre sur leur vie, ce qui me permet de pénétrer dans leur monde au sens figuré ; c’est une manière de mettre « en rapport ce qui est sans rapport »
Le « jeu est la chose », cependant, plus que de simplement capter la conscience du public, la théâtralité de l’art narratif lui présente une scène dans laquelle non seulement il peut comprendre un état des choses, mais également réfléchir à la façon d’agir en son sein, si ce n’est le changer. Selon le philosophe français Jacques Rancière :
La politique consiste à interpréter ce rapport, c’est-à-dire d’abord à en constituer la dramaturgie, à inventer l’argument au double sens, logique et dramatique, du terme, qui met en rapport ce qui est sans rapport5.
Revenons maintenant à nos chasseurs alsaciens. Il est vrai qu’avant de regarder le film j’ignorais leur existence ; cependant, apprendre qu’ils existent ne fournit guère plus qu’un constat. En évitant les têtes parlantes ou un narrateur omniscient, je ne peux pas non plus dire si leur situation a vraiment quelque chose de particulier, si ce n’est qu’elle est différente de la mienne. Ce que fait Bak, c’est ouvrir une fenêtre sur leur vie, ce qui me permet de pénétrer dans leur monde au sens figuré ; c’est une manière de mettre « en rapport ce qui est sans rapport ». Mais dans quel but ?
Ainsi que je l’ai formulé plus haut, le travail de Bak peut facilement être considéré comme une forme d’entreprise ethnographique, dans laquelle l’artiste s’intègre à une communauté donnée, l’observe, participe à ses activités, puis filme et édite ces activités afin que d’autres puissent les découvrir dans les musées, les galeries et autres institutions du monde de l’art. Mais l’observation seule ne permet pas de comprendre tout ce qui se passe, et il existe donc ici davantage qu’une forme de méthodologie ethnographique.
En plus de la vue, les gens perçoivent le monde par des moyens non visuels, par exemple en ressentant le poids d’un tablier en peau d’ours ou d’ailleurs, de quelle manière l’utilisation de divers outils, comme un sur-sabot, entraîne une compréhension incarnée du paysage. Dans Le hameau, nous voyons un jeune homme courir à quatre pattes en se faisant passer pour une sorte de chien. À son tour, il s’adresse à un groupe de chasseurs comme le ferait un chien, mais ces chasseurs lui disent qu’il n’y arrive pas tout à fait, « tu dois être plus fier [sic] », lui conseille un chasseur.
Dans un autre film, Transports à dos d’hommes (2012), nous voyons deux hommes, membres de la communauté rom, s’entraîner à jouer de l’accordéon dans la remorque d’un campement, en banlieue parisienne. Cependant, au lieu d’utiliser un métronome pour garder le rythme, leur collègue utilise une carte du métro parisien, percée de lumières clignotantes, pour mesurer le temps dont dispose chaque joueur entre deux arrêts de train. La répétition est encadrée par un haut-parleur qui diffuse un enregistrement du son du métro en mouvement pour compléter une sorte de simulateur de train afin que les joueurs affinent leur jeu d’artistes de train. Et bien que je puisse déduire tout cela de ce que la caméra de Bak me montre, l’absence de voix off propose une compréhension incarnée de leur travail, de sa rigueur et de ses pressions.
En écrivant sur Leviathan, documentaire américain réalisé en 2012 à bord d’un chalutier par Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel, du Sensory Ethnography Lab de l’Université de Harvard, le critique de cinéma français Cyril Neyrat note que l’histoire du cinéma est « la conquête du perceptible liée à une aventure de la visibilité6 ». En d’autres termes, le cinéma, bien qu’immersif, se limite aux seuls médiums audio et visuel, et est donc enfermé dans une lutte permanente pour surcompenser son incapacité à offrir au public une expérience sensorielle pleinement intégrée en amplifiant ces deux médias disponibles. Tandis que Taylor et Paravel, comme de nombreux documentaristes contemporains qui travaillent sur la nature, emploient des moyens technologiques de plus en plus performants, tels que la fixation de caméras miniatures sur des drones en mer pour rendre des visions hyperréalistes du type « fish eye » de ce qui était jusqu’à présent invisible pour les gens dans la vie quotidienne, pour rendre apparent son rôle de réalisatrice et rappeler au public que tout ce qu’il regarde est une construction, Bak a recours à des effets spéciaux en post-production, comme la ligne orange clignotante dans Le hameau, ou l’utilisation de flashs lumineux, tel que d'un pistolet à rayons pour augmenter le simulateur des musiciens dans Transports à dos d’hommes. Cette distanciation manifeste se démarque radicalement de la tendance du documentaire sensoriel contemporain, qui dissimule le fait que la conscience accrue produite par les nouvelles technologies est elle-même un artifice. Ce faisant, les films de Bak se détournent de toute prétention démonstrative véridique sur ses sujets, ce qui, je crois, explique pourquoi elle évite généralement d’employer d’autres dispositifs de cadrage habituellement utilisés dans les documentaires, comme la présence d’une voix narratrice. Reste à voir si ce geste l’autorise à prendre suffisamment de « distance critique », mais cela permet d’attirer l’attention sur le fait que si les films de Bak documentent des communautés ils ne sont, et ne seront toujours, qu’une représentation parmi d’autres.
L’ethnographie est un domaine qui suscite des inquiétudes quant à la malversation, et la proximité du travail de Bak et d’autres cinéastes avec cette discipline soulève la question suivante : leur travail est-il éthique ? Je ne peux pas répondre à cette question ; cependant, je crains qu’un tel dilemme ne provienne pas d’un engagement avec les œuvres d’art elles-mêmes, mais d’un mouvement plus large dans le discours artistique, parallèle à la critique approfondie de Foster sur l’artiste productiviste en tant qu’ethnographe, selon lequel un « bon » art politique devrait en quelque sorte fournir des « livrables » quantifiables. Mais peut-être est-ce là poser la mauvaise question ? L’art, si l’on peut dire, « construit des mondes » comme un moyen d’examiner le nôtre ; c’est à vous, et non à l’artiste, si vous le souhaitez, de faire de ces autres mondes votre réalité, que ce soit sur le plan personnel ou interpersonnel. À ce titre, pourquoi ne pas apprendre d’un film, ou de toute autre œuvre d’art, ce que vous pouvez, au lieu de l’aborder comme un problème ? Et si ces nouvelles connaissances vous incitent à voir davantage, à apprendre plus, ou même à faire plus, faites-le… Je me tiendrai à vos côtés.
Hal Foster, « The Artist as Ethnographer? », The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1995, [trad. franç. : « Portrait de l’artiste en ethnographe », in Le Retour du réel : situation actuelle de l’avant-garde, Bruxelles, La Lettre volée, 2005.
Ibid.
Ibid.
Hannah Arendt, Juger. Sur la philosophie politique de Kant, Points, Le Seuil, 2017.
Jacques Rancière, La Mésentente, Éditions Galilée, 1995.