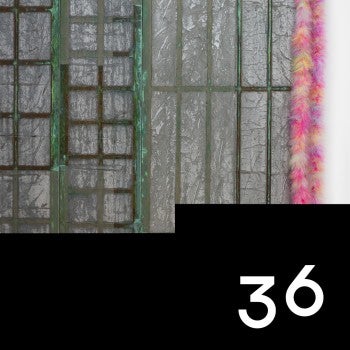Pour une mémoire défectueuse: l’oralité et la météo dans le travail de Katinka Bock

Démangeaisons
« J’ai envie d’imaginer ce projet et sa tranquillité comme pouvant être régulièrement dérangés par l’agitation du monde extérieur, ses irritations, ses insatisfactions. » Ainsi écrivait Katinka Bock dans un e-mail adressé à douze de ses amis en juin 2019, les invitant à contribuer à un journal qu’elle pensait publier en collaboration avec Thomas Boutoux et Clara Schulmann dans le cadre de son exposition Tumulte à Higienópolis présentée à Lafayette Anticipations à Paris. L’idée consistait à installer une salle de rédaction dans l’espace d’exposition – avec un comité éditorial composé d’élèves, d’étudiants et de jeunes personnes –, et à concevoir puis imprimer chaque édition sur place, en une journée.
Dans cette exposition, Katinka Bock avait installé une sculpture de grande taille construite avec les plaques de cuivre qui, à l’origine, formaient le dôme du Anzeiger-Hochhaus de Hanovre. Quand les plaques du dôme ont été remplacées, l’artiste a réussi à les récupérer. Ces anciennes plaques étaient restées à l’extérieur pendant près d’un siècle, s’oxydant et tournant au vert avec des teintes vert-de-gris tout en s’émaillant d’éraflures et d’empreintes faites par des pattes d’oiseaux, des événements météorologiques ou des fragments de bombes de la Seconde Guerre mondiale. Katinka Bock est attirée par les objets qui ont vécu ; des surfaces qui portent les marques du temps et de leur exposition aux éléments. Quand elle a appris que le Anzeiger-Hochhaus avait autrefois accueilli les bureaux de plusieurs grands journaux allemands, elle a décidé de transformer son exposition en une salle de rédaction, pour tenter d’y intégrer en temps réel les traces que laisse le contact avec le monde – « les démangeaisons de l’époque ».
Katinka Bock cherche souvent des manières de travailler avec le « dedans-dehors » (outside-in and inside-out) des expositions et de leur environnement (pour reprendre les termes de son e-mail de 2019) – même si parfois l’intervention prend une forme plus subtile. Pour réaliser son œuvre For your eyes only, parte pelo todo (2019), elle a laissé pendant quatre mois vingt mètres de tissu bleu sur le toit de l’Edifício Copan d’Oscar Niemeyer à São Paulo, afin que l’exposition aux éléments extérieurs (le soleil, le vent, la pluie, la pollution) y dépose une patine qui pourrait ensuite être apportée à l’intérieur. Elle envoie parfois ses pièces dans le monde. Plusieurs sculptures ont été immergées dans des étendues d’eau – comme Conversation suspended (2018), qui est restée au fond de l’estuaire de la Clyde en Écosse pendant neuf mois, ou Junimond (2017), qui a été déposée dans l’océan Atlantique, près du bassin d’Arcachon, pour une durée indéterminée. Pour son projet Zarba Lonsa en 2015, elle a organisé des échanges avec des commerçants d’Aubervilliers, dans le nord-est de Paris, afin que certains de ses objets en céramique se retrouvent présentés parmi les marchandises des magasins du quartier des Quatre-Chemins. À plusieurs occasions, Katinka Bock a mis en place un dispositif pour récolter l’eau de pluie à l’extérieur de ses expositions, acheminant l’eau grâce à un tuyau qui traversait l’espace, comme un petit morceau de météo invité à perturber le sanctuaire hermétique de l’espace d’exposition.
Temps d’exposition
Katinka Bock photographie pendant des moments d’« apnée » ... ces instants où l’on retient son souffle...
Der Sonnenstich (Insolation) (2023), l’exposition de Katinka Bock à la Fondation Pernod Ricard, se concentre sur une dimension particulière de sa pratique de ces dix dernières années : ses photographies. L’artiste ne se considère pas comme une photographe à proprement parler, mais depuis des années, parallèlement à sa pratique de sculptrice, elle prend des photographies avec un Pentax K2 35mm des années 1970 qui lui a été offert par son grand-père. Les sujets de ses photographies sont variés : les oreilles d’un âne ; des ombres ; des feuilles d’arbres ; des cuillères ; des boucheries, surtout en fin de journée, quand on lave le sang qui s’est répandu dans la vitrine ; une cheville marquée d’un motif après une période passée dans l’herbe ; des vêtements qu’on a retirés et laissés chiffonnés par terre ; un minuscule crabe au fond d’une tasse à café où le marc semble attendre une séance de caféomancie ; un moment complètement immobile quand une sauterelle a atterri sur l’épaule de quelqu’un qui se fige pour ne pas la déranger.
Les aspirateurs reviennent souvent. De vieux aspirateurs abandonnés dans la rue devant des immeubles à Berlin et à Paris, qui attendent que quelqu’un passe et les emporte. Des aspirateurs dans des espaces d’exposition, que Katinka Bock photographie pendant des moments d’« apnée », comme elle les appelle, ces instants où l’on retient son souffle, quand l’exposition est installée mais n’a pas encore ouvert ; il faut passer l’aspirateur une dernière fois avant d’ouvrir les portes et de laisser l’exposition respirer. Quand j’ai visité l’atelier de l’artiste à Paris, je lui ai demandé ce qui lui plaisait tant dans les aspirateurs. « As-tu déjà ouvert un aspirateur pour regarder dans le sac ? », s’est-elle enthousiasmée. « C’est un portrait tellement précis et intime d’un moment et d’un lieu ; on peut le lire comme une archive1. »
Quand des corps entrent dans le cadre des photographies de Katinka Bock, ils sont souvent rendus anonymes. La plupart du temps, son appareil photo ne s’intéresse qu’à des détails de parties du corps en gros plan – surtout les mains, les pieds et le cou. S’ils ne sont pas laissés hors cadre, les visages se détournent généralement de l’objectif, ou bien ils sont masqués par d’autres parties du corps ou des objets trouvés. Quelqu’un se cache derrière ses longs cheveux ; une autre personne disparaît derrière la crêpe tentaculaire tout juste cuite qu’elle tient devant son visage. Dans les photographies de Katinka Bock, les objets offrent un monde d’abris et de refuges improvisés, ainsi que des possibilités d’extensions prothétiques qui renégocient les frontières du corps de façon ludique.
Aucun mot
Les photographies de Katinka Bock peuvent être exposées, mais – comme pour ses objets sculpturaux – la galerie ne représente pour elles qu’un site possible, temporaire. Si vous rencontrez une photographie de Katinka Bock dans un espace d’exposition, elle a probablement déjà eu une vie dans le monde extérieur, car une grande partie de la pratique photographique de l’artiste réside dans son approche expérimentale de la diffusion. La plupart des photographies montrées dans le cadre de Sonnenstich sont d’abord parues dans les publications One of Hundred de Katinka Bock, une série toujours en cours de journaux autopubliés plus ou moins régulièrement depuis 2013, en collaboration avec le designer graphique Louis Lüthi. Chaque One of Hundred est tiré à cent exemplaires. Ils sont toujours au format A3, agrafés, et aucun texte n’accompagne les photographies. Aucun titre, aucune légende, aucun nom, aucune date, aucun numéro de page, aucune information sur le copyright, aucun détail sur la date et le lieu de publication. Cette initiative est autofinancée et les journaux ne sont jamais vendus, ce sont des cadeaux que l’artiste offre à des amis et à des personnes qu’elle rencontre.
Katinka Bock ne tient pas de registre de distribution des One of Hundred, et elle ne se souvient pas avec exactitude de ce qu’elle a donné ni à qui. Si un destinataire de l’une de ces publications souhaite en savoir plus, l’artiste peut éventuellement lui parler de la sélection des photographies ou du contexte du projet, mais elle ne s’oblige pas à le faire. Parfois elle réalise une édition en parallèle ou en réponse à un projet précis. Le premier One of Hundred rassemblait des photographies d’un sol en béton – avec toutes les traces de contacts et d’exposition portées par sa surface – dans un lieu où Katinka Bock exposait. D’autres éditions sont nées d’un travail de recherche particulier, comme le temps passé par l’artiste à observer et interagir avec les espaces publics de l’Edifício Copan. Le One of Hundred que je préfère compile toute une documentation autour du projet Zarba Lonsa, avec des photographies de ses énigmatiques objets en céramique nichés au milieu des marchandises dans des magasins d’Aubervilliers (parmi lesquels un magasin de vêtements, une bijouterie, une boucherie, une boulangerie, une épicerie, une quincaillerie, un opticien, un magasin de matériel électronique et un autre d’articles de mariage).
Toutefois, il n’est pas nécessaire de connaître le contexte des photographies de ces publications. En les présentant comme des images autonomes, sans aucun texte pour les accompagner, Katinka Bock les expédie dans le monde en ayant conscience qu’elles peuvent exprimer différentes choses à différents moments, pour différents publics et dans différents contextes. « Je m’intéresse à ce qu’une forme de distribution orale peut rendre possible2 », me dit-elle. L’écrit risque de river les images à des associations figées ; en son absence, des significations alternatives pourront éclore. La personne qui a reçu un journal One of Hundred se souvient peut-être de ce que Katinka Bock lui a dit, ou s’en souvient vaguement ; dans les blancs de la connaissance, d’autres informations et de nouvelles associations peuvent circuler oralement et se développer.
Une forme de distribution orale
...ce qui est appris par coeur peut vivre à travers une mémoire collectivement incarnée.
On tient pour acquis que l’écrit est plus fiable et se conserve mieux que la parole transmise oralement. On nous encourage à coucher les choses par écrit afin de les rendre plus officielles, plus légitimes, plus stables, plus réelles. Mais certaines circonstances attirent l’attention sur le caractère éphémère de l’écrit et la possible résilience de l’oralité. Faisons un détour … Dans la Russie soviétique, un groupe de poètes s’était attiré les foudres du régime. Incapables de publier leur travail par les biais officiels, ils ont dû trouver d’autres manières de faire circuler et d’archiver leurs poèmes, et il s’est avéré que l’oralité offrait un lieu de stockage plus sûr que l’imprimé. Publier multipliait les risques d’être surveillé, victime de chantage et exilé. Quand les choses étaient écrites, elles pouvaient être censurées, modifiées, détruites – mais lorsque ce groupe d’amis mémorisait par cœur le travail des uns et des autres, poèmes et poètes étaient gardés relativement en sécurité.
Sans possibilité de passer par l’impression, ces poètes ont repensé leur dépendance supposée à son égard. « M. n’a pas besoin de l’invention de Gutenberg3 », disait Anna Akhmatova de son ami de toujours Ossip Mandelstam, exilé pour sa poésie mais dont l’œuvre est restée vivante grâce aux cœurs et aux langues de ses amis. Lydia Tchoukovskaïa racontait comment Akhmatova écrivait ses propres poèmes sur des petits bouts de papier pour que les visiteurs les récitent et les mémorisent, avant de les réduire en cendres. « C’était comme un rituel », écrit Tchoukovskaïa. « Les mains, les allumettes, un cendrier. Un rituel beau et amer4. » Contre l’idée selon laquelle l’oralité est plus fugace que l’écrit – ses paroles plus susceptibles d’être perdues ou déformées –, cette image d’Akhmatova brûlant les bouts de papier nous rappelle que l’écrit est parfois étonnamment vulnérable et éphémère, tandis que ce qui est appris par coeur peut vivre à travers une mémoire collectivement incarnée.
Vert-de-gris
Ces poètes russes persécutés et la façon dont ils ont confié leur poésie à la mémoire est un point sur lequel la philosophe et autrice de théâtre Hélène Cixous est souvent revenue. Dans sa pièce intitulée Voile Noire Voile Blanche (1994), Cixous affirme que l’archive constituée oralement ne fait pas seulement figure de substitut pour des époques où l’écrit est trop dangereux – l’oralité a bien plutôt sa propre manière de fonctionner ; sa propre matérialité et son propre rythme ; ses propres ressources épistémologiques. Selon l’interprétation de Cixous, en apprenant et en récitant le travail des uns et des autres, ces amis poètes commencent à brouiller les valeurs de possession individuelle soigneusement délimitée et de qualité d’auteur. Dans une scène de Voile Noire Voile Blanche qui commence quand Akhmatova perd sa carte d’identité, l’incertitude se développe autour de l’origine d’un poème qu’elle et Nadejda Iakovlevna Mandelstam connaissent toutes deux par coeur. Akhmatova est persuadée que ce poème, Une larme, est le sien. « Je me souviens de chaque vers perlant dans chacune de mes veines5 », dit-elle. Mais Nadejda assure qu’Une larme est d’Ossip Mandelstam. Akhmatova est d’abord indignée, puis elle finit par admettre que, peut-être, « [sa] mémoire… n’est plus [sa] mémoire6. » Un peu plus loin, Nadejda suggère que l’origine d’un poème n’est jamais vraiment identifiable. « Qui sait, dit-elle à Akhmatova, “Larme” est peut-être un peu née de vous avec Ossip7. »
Cixous affirme qu’une forme d’intersubjectivité – et même une intercorporalité – se développe à travers ce groupe d’amis. « Ils mémorisaient leurs poèmes, se donnaient du souffle, faisaient battre leurs coeurs », écrit-elle. « Ils se prêtaient oreille, s’offraient leur propre sang8. » Dans la scène décrite ci-dessus, on pourrait attribuer la confusion qui surgit entre les poètes quant à la question de savoir à qui appartient quoi à un défaut de l’archive orale ; sans trace écrite, il est plus difficile de répartir la propriété et le statut d’auteur selon un même modèle. Mais ce flou constitue aussi une source de soulagement – un moyen de libérer les poèmes des limites de l’auteur individuel bien identifié en les ouvrant à l’abondance de la relationnalité. Quand l’Akhmatova de Cixous s’inquiète de ce que son intériorisation du poème de Mandelstam comme étant le sien puisse être un signe de folie, Nadezhda suggère que « c’est peut-être l’amour qui déborde9 ».
Même si Katinka Bock décide d’exclure l’écrit de ses publications One of Hundred au profit des possibilités de la diffusion orale, il est évident qu’elle se démarque à maints égards de cet exemple : contrairement à ces poètes, elle ne travaille pas dans un contexte de censure totalitaire et de persécution politique. Mais que l’oralité soit ou non une nécessité vers laquelle on se tourne, comme un moyen de survie, elle implique de renoncer à tout désir de contrôle indiscutable et d’accepter que les choses ne resteront pas liées aux intentions initiales de l’autrice. Alors qu’une exposition physique de photographies existera pendant un temps donné à un endroit précis, l’espace-temps de l’imprimé est bien plus indiscipliné, et Katinka Bock aime l’idée que ses publications puissent vivre une seconde vie en circulant par-delà les limites de ce qu’elle connaît ou contrôle, vers des futurs indéterminés.
Tous ces journaux sans mots, où ont-ils atterri, et qu’ont-ils accompli au fil du temps ? L’un d’eux a-t-il été regardé lors d’un long voyage en train, ou peut-être laissé accidentellement sur le quai ? Un autre a-t-il été rencontré au milieu de la nuit près d’une lampe qui éclaire mal, ou emporté en haut d’une colline et étendu au soleil, les pages envahies de fourmis ? Fourré dans un bagage à main, parcouru rapidement au petit déjeuner, oublié sur une étagère et retrouvé des années plus tard, quand vient le temps de déménager ? La personne qui déménage se souvient-elle qu’il s’agissait d’un cadeau de Katinka Bock ? Souhaite-t-elle traiter la publication comme un objet d’art et la conserver dans un état impeccable, ou acceptera-t-elle les marques du temps et d’exposition qui affluent sur sa surface (les couleurs qui s’estompent, le papier journal qui devient de plus en plus cassant) ? Abandonnera-t-elle son édition de One of Hundred, ou se servira-t-elle de certaines pages pour emballer des cadeaux ? Se souvient-elle correctement, ou avec inexactitude, de détails particuliers concernant les images ?
La déesse de l’oubli
Je crois que cette statue était une sorte d’hommage à l’oubli...
J’ai visité l’atelier de Katinka Bock à Paris au milieu du mois d’août. Octobre touche maintenant à sa fin, et je pense garder un souvenir assez net de certaines choses, mais beaucoup sont devenues troubles. Je me souviens que nous avions prévu d’aller déjeuner au café Le Zéphyr, à Belleville, mais quand nous sommes arrivées nous nous sommes rendu compte qu’il était fermé pendant les vacances d’été. La ville était tranquille, chaude, et les arbres débordaient de feuilles d’un vert vif du plein été. À présent, deux mois et demi après, là où je me trouve les feuilles des arbres perdent tout leur vert. Quand la lumière du soleil est abondante, les arbres produisent de la chlorophylle pour accompagner la photosynthèse, mais quand l’été prend fin, la chlorophylle s’en va et les feuilles commencent à dévoiler les jaunes et rouges vifs qui étaient là tout du long, tapis sous le vert brillant.
Je n’arrête pas de penser à une sculpture qui se trouvait dans l’atelier de Katinka Bock le jour où nous nous sommes rencontrées. Une silhouette grandeur nature moulée en bronze – verte avec des teintes vert-de-gris (la nuance que produit le cuivre contenu dans le bronze quand il est exposé aux éléments) – se tenait derrière nous tandis que nous regardions une autre pièce. Sa présence était calme et intense, mais nous n’en avons parlé que très brièvement, juste avant que je parte, et ma mémoire des détails est confuse. Je crois que cette statue était une sorte d’hommage à l’oubli... J’envoie un e-mail à l’artiste pour lui demander de me rafraîchir la mémoire. Était-ce une statue de Léthé, la déesse grecque de l’oubli et du pardon, qui était associée à la rivière Léthé, la rivière des souvenirs perdus ? Pas tout à fait, mes souvenirs n’étaient pas exacts. Elle m’explique que la sculpture s’appelle Amnésie. Elle n’est pas Léthé, mais elle est bien censée incarner l’oubli.
Katinka Bock a joint à son e-mail des photos pour que je puisse regarder ce monument à l’amnésie (un mot issu du préfixe négatif « a » et de « mnésie », qui caractérise la mémoire). Il ne s’agit pas vraiment d’un monument ; la matérialité du bronze et l’armure de la silhouette évoquent la monumentalité, mais l’intérieur est creux, son corps est un vaisseau et elle ne commémore rien d’autre que la valeur de l’oubli. Elle n’a pas de destrier triomphant, pas de piédestal pour la magnifier, pas de position permanente dans l’espace public, et – comme pour les photographies de l’artiste dans les journaux One of Hundred – aucune légende ou cartel n’atteste son importance. « J’aime vraiment quand l’information se perd, me dit Katinka Bock. J’aime l’espace que libère le fait de ne pas savoir. Oublier peut rendre d’autres modalités du souvenir possibles... Oublier nous offre une chance de refaire les choses, mais différemment. »
Conversation avec l’autrice, 14 août 2022.
Conversation avec l’autrice, 14 août 2022.
Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, Souvenirs, t. I, traduit du russe par Maya Minoustchine, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2012, p. 478.
The Penguin Book of Russian Poetry (introduction), 2015. The Akhmatova Journals. Volume I. 1938-1941, Evanston, Northwestern University Press, 2002.
Hélène Cixous, « Voile Noire Voile Blanche / Black Sail White Sail », in New Literary History, Printemps, vol. 25, n° 2, 1994, p. 222-354, p. 264.
Ibid, p. 264.
Ibid, p. 268.
Hélène Cixous, Readings: The Poetics of Blanchot, Joyce, Kafka, Kleist, Lispector and Tsvetayeva, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991, p. 116.
Hélène Cixous, « Voile Noire Voile Blanche / Black Sail White Sail », art. cit., p. 266.