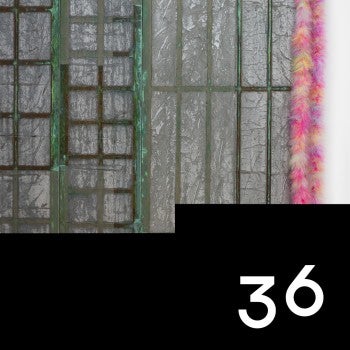T-shirt usé et expression de l'indicible
![Mélanie Matranga, Reset again and again, 2015. Canapé, moules, thé vert, café. Vue de l'exposition, 反复 [FANFU], Palais de Tokyo. Photo: Aurélien Mole.](/sites/default/files/styles/wide/public/textwork/pdt-2015-meauelanie-matranga-120-e1573214746612_0.jpg?itok=y3B0pOf0)
1.
« J’ai décidé de traiter les mots et les histoires comme des vêtements, comme des t-shirts ordinaires. Mes personnages portent cette histoire. Il était important pour moi qu’ils communiquent, même s’ils ont conscience que leur dialogue n’est qu’un artefact. » — Mélanie Matranga, entretien à la SCHIRN Kunsthalle, Francfort, 18 juillet 20171
Je porte ces mots. J’aimerais qu’ils soient faits sur mesure, bien coupés, élégants. J’aimerais les porter avec une légère insouciance, la grâce qui accompagne une confiance radieuse, une santé alerte et une conscience allégée. Mais ces mots sont d’occasion, la plupart ont été trouvés à la casse, j’en ai volé d’autres à de meilleurs que moi, et aucun ne peut être considéré comme m’appartenant en propre. Ils sont usés et tachés, malhabiles et maladroits, ce qui ne correspond pas à ce que je veux vraiment dire. J’ai tissé des histoires, j’agis comme s’il s’agissait d’une personne. Ces mots échouent dès lors que je les enfile.
Ils ne sont même pas faits de laine ni de coton, de soie ou d’organdi, de fourrure ou de polyester. Ils sont faits de papier. Découpé en piles d’une perfection sans faille et d’un format uniforme, le papier idéal est fragile et temporaire. Il est fait pour être marqué, facilement taché, noirci par un jet. Dès que je les porte, ils se déchirent. Ils se tachent à chaque fois. Et ils sont tellement fragiles. Un bébé pourrait les faire s’effondrer, une braise en suspension les réduirait en cendres, pleurez sur ces mots et ils s’effacent, le baiser frais de la pluie les dissout en un rien de temps. Je continue pourtant à les porter. Achetés dans le cadre économique que nous, humains, construisons, faits de commerce et de sens, je les porte pour révéler qui je suis, mais également pour me protéger.
![Vue de l'exposition Mélanie Matranga, 反复 [FANFU], Palais de Tokyo (21.10 2015 – 10.01 2016). Photo: Aurélien Mole.](/sites/default/files/styles/half/public/galleries/pdt-2015-meulanie-matranga-109-e1554292736734.jpg?itok=1JiLH-Kr)


... je suis trop lâche pour me passer de mots.
Uniquement vêtu de ces mots de papier, je sors. La lumière les traverse. La brise aussi. Pendant la journée, ils sont un déguisement, un costume pour convaincre les autres que je suis davantage que de la viande, que je suis à ma place parmi eux, que je suis rassurant et gentil, ou fort et puissant, ou attirant et sexy, ou capable et professionnel. L’ensemble pourrait se désintégrer en réponse à un murmure bien placé, à un mouvement dévoyé, à un éternuement. La nuit, je rassemble mes histoires au plus près, je les enroule autour de moi comme une couverture, une prière, et je frissonne encore. Je pourrais me vêtir de davantage de silence, mais je suis trop lâche pour me passer de mots. John Cage a dit un jour : « Je n’ai rien à dire et je le dis, c’est tout ce que j’attends de la poésie.2 » Pour aussi peu que j’aie à dire, j’éprouve une urgence à le faire. Je ne suis pas suffisamment courageux pour affronter le silence nu, du moins pas encore. À travers eux, j’essaie de me connecter aux autres et pourtant je sais qu’ils sont dans le même temps la raison de notre séparation.
Tellement enveloppé que je suis dans l’apparence, je manque la plupart du temps à lire les autres.
Même dans l’intimité de l’intimité, je porte encore ces mots. Même s’ils sont en lambeaux et tachés, abîmés par le temps et déchirés suite à une mauvaise manipulation ; ils sont la seule monnaie que je pense posséder et je les dépense donc sans discontinuer. Et toujours et encore, ils échouent. Bien que leur échec me tienne à l’écart de celles et ceux que j’aime le plus, un mince espace nous sépare. On peut presser nos corps. Bien que séparés, on ne peut que se rapprocher. À travers ces minces gaines de langage, nous pouvons sentir la chaleur de l’autre, et même après, s’emmêler dans les membres de l’autre, aussi intimement que peuvent l’être deux corps. Peu importe le nombre de fois où je dis – nous -, je sais que je fais face à mes rêves seul. Du moins parfois, nous pouvons faire des rêves solitaires ensemble.
L’ineffable est littéralement ce qui est inexprimable, un sentiment que je suis dans l’incapacité d’exprimer avec des mots.
« Ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. » — Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (1921)3
Et c’est peut-être une bonne chose que ces mots soient si minces. Qu’ils échouent. Même si c’est la seule magie que je possède, j’aime lorsque ma lumière brille à travers ces couches de langage, malgré moi. Aussi maladroit que je sois, mes mots et mes histoires sont la forme dans laquelle je vis, et je suis reconnaissant lorsque les autres me voient à travers eux.
Comme les vêtements, les mots et les histoires révèlent la forme de notre corps, non seulement ce qui peut être touché et vu, mais aussi ce qui ne peut l’être. Une aura qui s’épanouit par moments, emplit les pièces et les vies, faisant de notre vie la meilleure possible, une vie qui puisse toucher les autres. Au-delà de ce qui nous semble essentiel, nos histoires sont des tentatives pour exprimer qui nous sommes aux autres, quel rôle nous jouons dans le drame que nous nous jouons quotidiennement. Ils nous permettent d’être timides en public, de nous montrer et de ne pas nous montrer simultanément.
Le papier neuf n’est qu’une promesse fragile de ce qui pourrait être.
2.
J’assemble ces mots maintenant pour essayer de vous faire voir et ressentir ce que je ressens. Pour vous montrer ce que j’ai vu et comment je l’ai vu. Pour que vous me voyiez et pour que nous puissions être connectés d’une manière ou d’une autre, moins seuls grâce à cet essai, de là où j’écris à là où vous lisez.
« J’emploie des structures émotionnelles plutôt que structures formelles […]. J’emprunte des chemins aussi alambiqués que ces structures pour exprimer quelque chose sans jamais en être vraiment capable. » — Mélanie Matranga à l’occasion de son exposition au Palais de Tokyo, en 20154
J’essaie ainsi d’évoquer l’architecture insaisissable et émotionnelle de l’artiste Mélanie Matranga. Des chemises vides en papier deviennent des lanternes pour des boules de lumière, comme autant d’âmes suspendues au-dessus des meubles ; et, bien que façonnées pour contenir notre corps, elles en sont incapables puisqu’elles sont biscornues et très fragiles. Des t-shirts surdimensionnés épinglés sur un mur, taillés dans des tissus et des tapis teints, mettent en évidence la forme des passages fantomatiques. Les drames cinématographiques mettent en scène des amants qui se rencontrent et qui souvent ne communiquent pas (le capitalisme est parfois le tiers malvenu de ce ménage à trois). Nous pouvons considérer des choses comme certaines, la texture des tissus qui tombent des plafonds, mais il s’agit moins de choses que de moments. La tension temporelle entre l’intimité et l’aliénation, entre notre moi privé et nos projections publiques.




Malgré leur intimité, elle ne peut pas lui faire confiance non plus.
Dans la première vidéo de la série créée par Mélanie Matranga pour la Frieze Art Fair de Londres, en 2014, From A to B Through E, un couple s’allonge sur un lit au milieu de la foire en construction, des cabines à moitié voilées sous la canopée de tentes blanches, des ouvriers en veste jaune se balancent à l’arrière-plan. Une jeune femme essaie d’exprimer ses sentiments au sujet de l’économie alors que son amant enfile distraitement ses vêtements, comme s’il était seul, se préparant à aller travailler. Elle lui dit :
J’ai lu hier dans le journal un article à propos de l’économie, de ce qui se passe dans le monde, de la manière dont l’économie est sérieusement foutue, et ça me rappelle les relations, tu sais ? Tu penses que tout va bien et tu fais confiance aux politiciens et aux personnes qui savent comment fonctionne l’économie et puis un jour, juste comme ça, c’est fini et tu réalises que tu ne peux faire confiance à personne.5
Mais… il n’écoute pas. Malgré leur intimité, elle ne peut pas lui faire confiance non plus. Certaines personnes tentent de communiquer sur les similitudes entre l’économie et l’amour, dans un lit, une intimité improbable dans l’espace commercial. Quel que soit le lien qu’ils ou elles établissent avec leur corps, c’est un échec. « De A à B » signifie simplement de l’un à l’autre, ainsi que l’a exprimé clairement Andy Warhol dans son livre emblématique The Philosophy of Andy Warhol: From A to B and Back Again. Avec l’ajout de Mélanie Matranga « en passant par E », il semble qu’il nous faille passer par l’économie qui nous embourbe tous, par les systèmes des échanges et du champ des significations qui régissent et colorent l’ensemble de nos relations, que cela nous plaise ou non. La vidéo passe dans la scène suivante à l’homme précédemment filmé qui fume tranquillement dans un autre espace de la foire en construction, un ouvrier britannique s’approche et lui demande une cigarette. Notre amant distrait s’excuse, marmonne une série d’explications peu sincères. Son manque de générosité d’une scène à l’autre est évident.
Dans son film érotique You (2016), le couple et ses désaccords rendent impossible le « nous » de l’amour, se fondant à nouveau dans le désir et la séparation du « toi ». Très souvent dans le travail de Mélanie Matranga, la nature des relations humaines s’enracine dans nos costumes et nos environnements, la difficulté à entrer en contact dans le temps et l’espace dans lesquels nous existons. Dans la scène d’ouverture, un homme modestement vêtu et une femme se disputent, entourés de draps et de murs d’un blanc éclatant. Elle porte un t-shirt « Metallica » qui s’estompe (le t-shirt de groupe pour certaines catégories de populations figure une expression de soi) et il ne porte qu’un boxer en tartan. Bien que partageant clairement une intimité, leur relation n’est guère enviable. À la scène suivante, un autre homme parle à une femme différente d’une voisine, une femme plus âgée sur laquelle il aurait fantasmé lorsqu’il était petit. Dans la vignette suivante, les couples se mélangent et la femme de la première scène baise avec l’homme de la seconde au-dessus des toilettes. Le mélange se poursuit alors que la femme qui a entendu l’histoire de la voisine désirée la transmet en état d’ébriété aux autres, y compris à l’homme de la première scène. (On entend une chanson lointaine, vous pouvez sentir la fumée, presque humide qui les entoure, le garçon l’ignore mais notre auditrice le caresse chaleureusement, lui chuchote des compliments, avec une affection sensuelle.) Dans le tableau final, trois des personnages finissent au lit ou à une fête. Si cela semble un peu alambiqué, c’est uniquement parce que l’amour et le corps, les amitiés et les humains sont désordonnés.
Ces personnages, dans toute leur intimité, conservent toujours une distance, une aliénation l’un par rapport à l’autre, une difficulté à entrer en contact. Même le sexe semble affamé et mécanique plutôt que créateur de liens. Nous percevons toujours ces sensations d’intimité et de désunion, mais la plupart des personnages et des acteurs et actrices de Mélanie Matranga sont jeunes. Nous ne ressentirons jamais ce profond désir de connexion, et la solitude totale de son échec, aussi clairement que dans notre jeunesse. C’est alors que nous les endossons tous les deux. Le désir profond et l’aliénation totale sont enlacés et imprégnés d’hormones. Ainsi, dans ses films de toute évidence et de manière plus atmosphérique dans ses installations, Mélanie Matranga crée des structures où coexistent ces deux polarités. Comme le texte qui accompagne son exposition au Palais de Tokyo le décrit si bien, ses installations sont « des lieux où les personnes se sentent seules ensemble6».
3.
Le titre de son exposition à Paris au printemps 2018, Sorry, est un tendre aveu d’échec (d’échange, d’amour, ou de tout le reste) et une requête embarrassée pour le plus simple des pardons. Pardon. Plusieurs de ses titres, à l’instar de celui-ci, impliquent un échec ou une trahison entre deux personnes. Deux pièces de son exposition au Palais de Tokyo, 反复 ([fanfu]), viennent à l’esprit : I prefer we stay friends, 2015, et Finally we cannot stay friends, 2015. Ces deux œuvres sont des regrets fantomatiques, trempées dans du silicone blanc, entremêlées de rideaux faits de filets. La première est une chaise en métal inutilisable drapée de tissu et ornée de fausses fleurs brisées qui s’apparente à un autel. La seconde, un cocon doux, drapé et refermé par une bâche. Toutes annoncent avec une touche poétique la vulnérabilité et la distance.
Mais ces échecs relationnels auxquels elle fait allusion tout au long de son travail sont doux, et pour son exposition à High Art, cette tentative de demander pardon formulée en un seul mot semble, dans sa brièveté, en quelque sorte à la fois facile et sincère. Ce Sorry reflète l’ambiance que l’on retrouve tout au long de l’exposition. L’intérieur impeccable des premières pièces de la galerie semblait presque spectral avec ses moulures blanches ornées, un énorme calendrier des phases de la lune divisait l’espace principal s’étendant du sol au plafond, des drapeaux en tissu noir avec chacun une sphère lunaire blanche s’avançant dans l’obscurité des ténèbres de la nouvelle lune. Des vêtements en tissu blanc à proximité : une robe, un soutien-gorge, une chemise, accrochés au plafond avec des cordes blanches et une armature de métal blanc, l’une des trois pièces de l’exposition intitulées My Shape (2018). De l’autre côté de la pièce, six chemises suspendues en une pyramide inversée, bras tendus, le bas jaune foncé, le haut blanc, intitulé Sunset (2018). Une porte mène à ce qui ressemble à une salle de bains, mais en y regardant de près on s’aperçoit que les toilettes ne sont pas raccordées, il s’agit seulement d’un accessoire, assorti d’une pile d’exemplaires des Cahiers du Cinéma et d’un haut-parleur, relayant des histoires de la vie quotidienne racontées par une série de voix jeunes. Des dessins figuratifs d’un autre artiste, t5 (des œuvres d’autres artistes apparaissent régulièrement dans les installations de Matranga ), et plus loin, une chambre noire à faux plafond. D’autres phases de la lune, ici des cercles blancs sur des vêtements noirs et d’autres vêtements suspendus, l’un en tissu de Thèbes (souvent employé pour la tapisserie) et l’autre en papier, des lumières cachées à l’intérieur des deux avec un entrelacs de fils électriques, encore intitulés My Shape (2018). Le tissu d’ameublement dans lequel ont été taillés les vêtements tresse de nombreux réseaux de signification : la peau souple qui recouvre l’architecture dure, les revêtements de meubles, tous deux faits pour façonner notre corps, la minceur des corps trop facilement objectivables, les deux manières que nous avons d’exprimer qui nous sommes à nous-mêmes et aux autres.




Tels sont les éléments factuels de l’exposition, finement dessinés. La sensation est néanmoins différente, quelque chose de plus insaisissable. De doux. La douceur des vêtements et des corps manquants pour les remplir, la douceur du temps raconté à travers les phases de la lune et non par les horloges, la douceur des ombres, la distance suave mais infranchissable qui nous sépare. L’intimité se fait fermeture, en passant des grandes premières pièces de la galerie à travers la curieuse salle de bains, des accessoires jusqu’aux confins sombres d’une pièce au plafond suspendu. Changer la forme de la pièce modifie votre relation à votre corps dans l’espace, ainsi qu’avec les choses que vous rencontrez dans cette pièce. Quelque chose de physique et de solitaire, mais pas nécessairement de fonctionnel. Ces vêtements ne sont pas destinés à être portés, les toilettes ne doivent pas être utilisées (malgré les magazines et la pile de rouleaux de papier toilette sur son réservoir). Le mouvement entre les deux est étrange, passer par une salle de bains, même si elle n’est qu’accessoire, procure une sensation étrange, la neutralité blanche à moulures des galeries d’art par rapport à celle des salles de bains, toutes deux d’un blanc éclatant.
Après avoir visité l’exposition, je suis retourné à la vie des rues de Paris, pour m’asseoir, parler et fumer avec l’artiste et nous avons évoqué les intersections entre la vie et le travail. Il n’existe pas d’histoire littérale à raconter au sujet de l’exposition, du type ceci représente cela, et peut-être que l’art ne devrait pas offrir de lectures aussi faciles. Mais je me retrouve avec ces choses, cette richesse de références, et surtout une sensation, et lorsque je regarde l’ensemble du travail de Mélanie Matranga, qu’il s’agisse de films où des couples se disputent au lit ou de mystérieux vêtements vides, de lanternes en papier menant à des vêtements en papier, de tissus de tapisserie façonnés en tenues nous conduisant jusqu’à de beaux meubles, je ressens cette sensation et, comme tout auteur, je suis ici à vouloir mettre ce sentiment en mots, le placer contre mon corps avec ses difficultés et ses joies. Je me sens mieux en dehors des descriptions littérales, même lorsque j’essaie d’obtenir des faits aussi solides. Ce n’est pas seulement une aura méditative, les faits sont véritablement enracinés dans les choses, les sons et les images.
4.
... les corps appartiennent à l’ici et maintenant, avec leur incapacité à véritablement se connecter.
L’art est toujours la tentative d’un artiste de communiquer : un sens de l’esthétique ou de la valeur émotionnelle, une force politique ou une rigueur conceptuelle. Lorsque des auteurs comme moi écrivent à ce sujet, nos mots sont conçus à la fois comme un moyen pour vous de voir par procuration l’art que nous rapportons, mais aussi toutes les choses qui ne peuvent être vues. Les bruits de la rue que nous avons empruntée pour nous y rendre, le sentiment d’anticipation en pénétrant par les portes de la galerie, les millions d’autres choses que nous avons vues, entendues et vécues qui peuvent révéler avec sensibilité les nuances de ce que signifie être humain dans un temps et un lieu définis. Outre l’histoire de l’art qui l’a précédée et le contexte de l’époque dans lequel l’artiste que nous voyons a créé son exposition, il y a bien sûr des faits. Que Mélanie Matranga soit née en France en 1985, qu’elle ait exposé à Karma International à Los Angeles en 2016 et au Palais de Tokyo à Paris en 2015, mais ces faits ne sont que des crochets sur lesquels nous posons nos observations, sentiments et pensées. Je peux vous donner les noms des expositions, dans des langues étrangères à leur lieu exposition (反复[fanfu] pour le Palais de Tokyo), ou dépourvus de mots et simplement constitués de symboles (• – • pour une exposition récente à la Villa Vassilieff). Avec les titres de ses pièces comme lonely pleasure (2016) ou emotional not sentimental (2015), et quelque chose de l’esthétique de l’artiste.
Et à travers ces faits, un sens commence à émerger, mais aucun d’entre eux ne contient à lui seul le sentiment véhiculé par son travail. Le sens de la méditation poétique et de l’urgence émotionnelle, le sentiment qu’il se passe quelque chose de sexy, mais moins lié à la titillation qu’au frisson de l’intimité, les corps appartiennent à l’ici et maintenant, avec leur incapacité à véritablement se connecter. Un sentiment d’étrangeté quotidienne, familière et elliptique. Ces meubles, ces lits recouverts de silicone, vous rappellent en quelque sorte des choses humbles que vous auriez pu posséder, dépourvues de toute saccharine nostalgique, elles puisent dans une certaine perte de mémoire et dans le lent passage du temps.



En observant les vêtements non portés accrochés dans l’exposition de Mélanie Matranga à High Art, j’ai pensé à mes propres vêtements usés, à ce que j’essaie de dire à travers eux. Je considère ces mots de papier comme des vêtements, leur faillibilité et leur familiarité, et la manière dont je les porte pour essayer de vous communiquer quelque chose d’insaisissable au sujet de cette artiste singulière. On veut briller mais on veut aussi se cacher et Mélanie attrape cette dualité en tension. La chaleur de nos tentatives et la solitude de leurs échecs. Avec une force palpable et une grâce éthérée, Mélanie Matranga capture la lutte de ce qui peut et ne peut pas être dit, ainsi que les corps à partir desquels nous les formulons, la manière dont ces deux aspects construisent une identité, une existence, une histoire. Et comment ces histoires, nos histoires peuvent toujours venir emplir un t-shirt usé.
John Cage, Lecture on Nothing, 1949. https://seansturm.files.wordpress.com/2012/09/john-cage-lecture-on-nothing.pdf
From A to B Through E est disponible sur https://vimeo.com/108881068




![Mélanie Matranga, Reset again and again, 2015. Canapé, moules, thé vert, café. Vue de l'exposition, 反复 [FANFU], Palais de Tokyo. Photo: Aurélien Mole.](/sites/default/files/styles/half/public/galleries/pdt-2015-meauelanie-matranga-120-e1573214746612.jpg?itok=mIBwwRsN)
![Vue de l'exposition Mélanie Matranga, 反复 [FANFU], Palais de Tokyo (21.10 2015 – 10.01 2016). Photo: Aurélien Mole.](/sites/default/files/styles/half/public/galleries/pdt-2015-meauelanie-matranga-116-e1554293490740.jpg?itok=b7KrtmI5)
![Mélanie Matranga, Fortune Light, 2015. Lampe en papier japonais, enceintes, cables. Vue de l'exposition, 反复 [FANFU], Palais de Tokyo. Photo: Aurélien Mole.](/sites/default/files/styles/half/public/galleries/pdt-2015-meauelanie-matranga-089_0-e1554293970974.jpg?itok=e4euN78E)